

Matthias Wirz / Adaptation: Carole Pirker
Le 27 novembre, le pape Léon XIV se rendra en Turquie, où il sera reçu par le patriarche œcuménique Bartholomée Ier. Il visitera avec lui Iznik, anciennement appelée Nicée. Cette ville, située à 90 km à vol d’oiseau au sud-est d’Istanbul, a accueilli en 325 le premier concile œcuménique de l’histoire de l’Église.

Le concile de Nicée, qui s’est tenu sous l’empereur Constantin (272- 337), a fixé la date de Pâques pour l’ensemble de l’Église. Il a aussi rejeté l’«hérésie arienne» qui concevait une hiérarchie entre Jésus et Dieu. Mais, selon Marie Chaieb (voir encadré), c’est surtout le Credo chrétien, qu’il a fixé pour la première fois par écrit, dont on fête cette année les 1700 ans.
En quoi le concile de Nicée est un événement majeur pour le christianisme?
Marie Chaieb: Parce qu’il a marqué le début d’une série de grands conciles œcuméniques qui avaient vocation à inviter la totalité des évêques pour se mettre d’accord sur la formulation de la foi. C’est un événement majeur car les évêques y ont fixé le Credo chrétien, une confession de foi commune qui sera complétée plus tard au concile de Constantinople (381), et qui deviendra le Credo valable jusqu’à aujourd’hui pour tous les chrétiens.
Quelles Églises sont représentées à ce premier concile?
La plupart des Églises de la partie orientale de l’empire de l’Empire romain (27 avant J.C. – 476 après J.C.). Il y avait très peu d’évêques venant de sa partie occidentale. Pour ces derniers, c’était un très long voyage, ce qui explique qu’ils étaient en minorité. Même l’évêque de Rome s’était fait représenter par des légats (ambassadeurs du Saint-Siège, ndlr).
Dire qu’il y avait la totalité des évêques de l’époque est donc exagéré…
Effectivement, il n’y a jamais eu la totalité des évêques à chacun des conciles, mais l’intention était de manifester une unanimité dans le choix de la formulation de la foi.
On a longtemps ignoré où se trouvait le site qu’iront visiter Léon XIV et le patriarche Bartholomée Ier…
C’est juste, mais selon les sources, le Concile s’est tenu dans le palais de l’empereur Constantin. On n’est pas loin de la ville de Nicomédie, qui était une capitale de résidence impériale.
Parce que c’est lui qui a convoqué ce Concile, et non le pape de l’époque?
Absolument, au IVᵉ siècle, il était impensable de distinguer les questions religieuses et politiques. En 325, le christianisme était devenu une religion d’État.Il est donc logique que l’empereur convoque ce Concile, car il est le garant de l’ordre public. La question de la foi, très disputée, créait des remous, voire des émeutes et l’empereur Constantin voulait pacifier la situation.
« Au IVᵉ siècle, il était impensable de distinguer les questions religieuses et politiques. »
La concorde religieuse était donc essentielle à la stabilité de l’Empire romain…
Le fait que tout le monde soit d’accord sur la formulation de la foi participait à la paix publique.
Suivez le voyage du pape en Turquie et au Liban
D’un point de vue logistique, réunir à Nicée 300 évêques pendant trois mois représente toute une infrastructure à mettre en place…
On peut parler d’au moins 300 évêques, mais on ne dispose pas de chiffre exact, puisqu’il n’existe pas d’acte du Concile. Quelques décennies après le Concile, l’évêque Hilaire de Poitiers (300 – 367) parle de 318 évêques, mais ils étaient probablement plus nombreux, parce que les délégations devaient être formées de plusieurs membres. On imagine une logistique assez incroyable de plus d’un millier de personnes. Il fallait donc un palais impérial pour nourrir, loger, et prendre soin de toutes ces délégations.
« On peut parler d’au moins 300 évêques, mais on ne dispose pas de chiffre exact. »
Et c’est donc la première fois que le Credo du christianisme y est mis par écrit?
Oui, mais depuis les origines, les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour en avoir des traces écrites, on sait que ce symbole accompagnait le baptême. Les chrétiens n’ont donc pas attendu Nicée pour professer leur foi. Il est important de le préciser. Mais il est vrai qu’on a mis pour la première fois par écrit la confession de foi, par un choix réfléchi et commun, parce qu’il y avait un danger de glissement vers la théologie d’Arius.
Une théologie qui a donné ce qu’on a ensuite appelé l’hérésie de l’arianisme…
Oui, Arius (voir encadré), un prêtre d’Alexandrie, avait commencé à prêcher et ses disciples étaient convaincus que le Fils de Dieu n’était pas aussi Dieu que le Père, alors que le Credo du concile de Nicée se focalise justement sur lui, le Fils de Dieu. Très ancrée dans le judaïsme, la communauté religieuse d’Arius voulait préserver la transcendance du Père, et maintenir le Fils dans un écart respectueux par rapport à lui. Selon Arius, la conception de la Trinité est un peu en escalier: on a le Père tout en haut, le Fils qui est un peu en retrait, et puis l’Esprit Saint, qui est une émanation du Fils, qui est encore moins Dieu que le Fils.
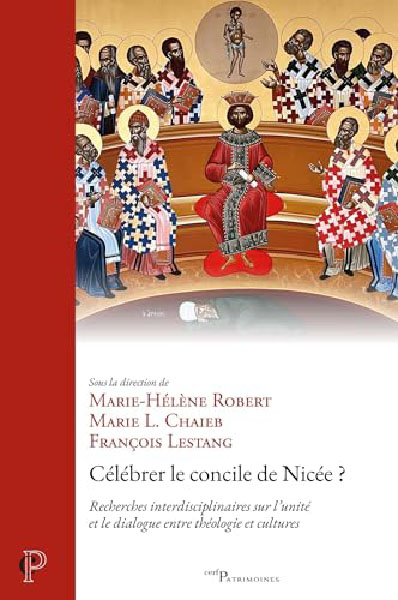
Et comment ont réagi les participants?
Les Pères du concile de Nicée ont cherché à rééquilibrer cette Trinité en escalier, en s’appuyant sur les Écritures, la tradition des communautés, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et sur la vie de l’Église. Arius ne voulait pas forcément faire dissidence, mais le débat a ensuite crispé les positions et l’Église catholique frappera finalement d’anathème ceux qui disent que le Fils de Dieu est d’une autre substance ou d’une autre essence que le Père.
On va donc rejeter ceux qui professent que le Fils de Dieu serait inférieur au Père?
Oui, et c’est une première. Ils ne sont plus reconnus comme faisant partie de la communion de foi. Ainsi, on voit apparaître dans le Credo du concile de Nicée le terme grec d’homoousios. Il est utilisé pour décrire le Fils comme étant de la même essence que le Père, une notion clé de la doctrine trinitaire, et c’est une véritable bombe: on choisit un terme philosophique qui ne figure pas dans la Bible! Les évêques s’étant montrés unanimes dans son adoption, il est intégré dans la profession de foi du Concile, que chacun va ensuite ramener dans son diocèse. Il s’agit de formuler au plus juste la foi commune.
Comment a été reçu ce Credo de Nicée par les fidèles?
Certains ont eu du mal avec ce terme d’homoousios. Il y a eu un moment d’adaptation non négligeable. On s’est aussi rendu compte en professant ce Credo qu’il était un peu court sur l’Esprit saint. Certains fidèles ont posé de très bonnes questions à leurs évêques, en disant: «Si je crois en l’Esprit saint, est-ce à dire que le Père a deux fils?» Il a donc fallu compléter sa formulation, jugée insuffisante. Les choses se sont ainsi mises en place dans le va-et- vient entre les fidèles et la réflexion théologique. Au Concile suivant, en 381 à Constantinople, ce Credo a évolué vers ce qu’on appelle le Credo de Nicée-Constantinople. Celui-ci apporte une formulation de foi trinitaire complète et équilibrée et reprend le style narratif que nous connaissons aujourd’hui dans le Credo, plus proche du style littéraire biblique.
Vous avez parlé de «symbole de Nicée» en parlant du Credo de Nicée. Que signifie ce terme?
Le mot grec symbolon correspond à la partie visible et que l’on va expliciter, pour dire le cœur de la foi. Il est employé très tôt dans le christianisme pour parler de la profession de foi lors du baptême. À Nicée, il a été l’objet de débats parmi les évêques. A peine les évêques avaient-ils formulé ce symbole de foi que celui-ci posait de nouvelles questions une fois rentrés dans leurs différents diocèses. Il a donc fallu remettre l’ouvrage sur le métier lors du concile suivant. Cela fonctionne donc par échanges.
On a recours à un mot qui ne vient pas de la Bible. C’est un peu faire marier la foi chrétienne avec une rationalité philosophique du monde grec païen…
Oui, c’est pour ça que c’est très exceptionnel. Il faut chercher les racines du concile de Nicée dès le IIᵉ siècle, avec des gens qui ont su utiliser les outils de la culture de leur temps pour formuler la foi. Parce que celle-ci est aussi imprégnée des usages de l’époque. Voir les évêques rassemblés choisir ce terme de symbolon, c’est aussi une invitation à formuler la foi à notre époque, avec des mots qui peuvent être des bons véhicules dans nos cultures d’aujourd’hui.
Mais ce recours à la philosophie grecque, est-il accessible à des chrétiens qui vivent dans d’autres milieux culturels et parties du monde, en Extrême-Orient ou en Afrique par exemple?
Cette question a en effet causé beaucoup de débats. Il faut arriver à tenir à la fois l’héritage du concile de Nicée avec un grand respect, en tenant compte de l’importance de cette première profession de foi commune, et en même temps savoir l’adapter dans le langage d’aujourd’hui. C’est un équilibre qui est à chercher à chaque génération, ce n’est jamais fini. La célébration du concile de Nicée est une invitation à dire la foi dans nos mots, sans oublier cet héritage.
Retrouvez l’entretien dans l’émission «Babel» sur RTS Espace 2, puis en podcast sur rts.ch/religion/babel, ou via l’App Play RTS.
Est-ce que le concile de Nicée est le symbole d’une époque où l’Église était moins divisée qu’aujourd’hui?
On peut considérer le Concile de Nicée comme un trésor commun, que l’on peut surtout se féliciter de pouvoir célébrer ensemble. Ce qui va être le cas lors de la visite du pape Léon XIV avec le patriarche Bartholomée Ier. C’est un moment où l’on va revisiter nos racines communes. Sur le plan œcuménique, c’est fort comme anniversaire.
On parle cela dit d’un concile œcuménique dans le sens étymologique du terme, un concile qui rassemble les évêques de la terre entière.
Ce terme fait partie des mots dont l’histoire et le contenu changent au fil du temps. Le mot œcuménique qui est employé dans l’Antiquité a une valeur avant tout géographique. Ce n’est que par la suite qu’il va se connoter de cette idée de foi commune, portée par une profession de foi élaborée ensemble. On peut donc dire que l’on célèbre aujourd’hui un concile œcuménique dans tous les sens du terme.
> Célébrer le concile de Nicée?, sous la direction de Marie Chaieb, François Lestang et Marie-Hélène Robert, Editions du Cerf, 2025.
Une théologienne des Pères de l’Église
Marie Chaieb est spécialiste de théologie patristique (doctrine, écrits et vie des Pères de l’Église), qu’elle enseigne à l’Université catholique de Lyon. En tant que chercheuse, elle a publié plusieurs livres sur les Pères de l’Église, ainsi qu’une série de commentaires sur l’œuvre d’Irénée de Lyon (122-200). Ses travaux portent aussi sur les théologiens d’avant le premier concile de Nicée et sur la théologie de l’inculturation. Elle se passionne pour l’émergence des communautés chrétiennes, les grandes problématiques du christianisme et l’histoire des doctrines dans l’antiquité tardive. CP
L’hérétique du concile de Nicée
Prêtre chrétien d’Alexandrie (250 – 336), Arius enseignait que Jésus, bien qu’étant une créature supérieure, n’était pas de la même substance que Dieu le Père. Sa doctrine, connue sous le nom d’arianisme, a été condamnée lors du concile de Nicée en 325, car elle était considérée comme une hérésie qui mettait en péril la doctrine de la Trinité. Arius et ses partisans ont refusé de signer le Crédo final et ont été exilés par l’empereur Constantin. Cette querelle a contribué à définir le symbole de Nicée-Constantinople, la confession de foi chrétienne promulguée lors du concile de Nicée de 325 et complétée lors du concile de Constantinople de 381. CP
Rédaction
Portail catholique suisse
https://www.cath.ch/newsf/marie-chaieb-nicee-nous-invite-a-formuler-la-foi-a-notre-epoque/