Arié Alimi: «Les messages fondamentaux du judaïsme sont violés»
Comment dépasser les fractures issues du conflit israélo-palestinien? Sommé de choisir entre ses différentes identités, c’est à cette question que tente de répondre l’avocat français Arié Alimi, dans son dernier essai Juif, français de gauche, dans le désordre (Ed. La Découverte).
Carole Pirker
Connu en France pour son engagement contre le racisme et les violences policières, l’avocat Arié Alimi (voir encadré) est membre dirigeant de la Ligue des droits de l’homme et compagnon de route des gauches radicales. Dans son essai, il témoigne du déchirement qui est le sien face au conflit israélo-palestinien.
En tant que juif, il est attaché à Israël, mais en tant que Français de gauche, anticolonial et antiraciste, il l’est tout autant à l’émancipation et à l’égalité entre les peuples. Dans cet essai, il tente de réfléchir à la manière d’articuler ses engagements et ses différentes identités, sans en renier aucune. Une réflexion à la fois politique et personnelle, stimulante et courageuse.
Quel est votre rapport au judaïsme?
Arié Alimi: Il a beaucoup évolué. Je suis né dans une famille dite traditionaliste, c’est à dire religieuse, mais sans plus. On se réunissait en famille élargie pour Shabbat et on mangeait kasher. Le vendredi soir, on allait à la synagogue, mais surtout pour les grandes fêtes et pour Kippour (la fête la plus sacrée du judaïsme, aussi appelée le Jour du Grand Pardon, vndlr). En revanche, mes parents m’ont envoyé dans une école religieuse juive, à Sarcelles et à cette époque-là, c’est moi qui ai tiré ma famille vers plus de religiosité. Cela dit, mon parcours personnel m’a fait évoluer, puisque aujourd’hui je ne crois plus en Dieu, mais je mange toujours kasher. C’est assez particulier puisque j’ai conservé certaines pratiques du judaïsme, même si je ne suis plus croyant.
Pour quelles raisons avez-vous abandonné la foi juive?
En raison de rencontres et de réflexions personnelles, et aussi par la découverte de la philosophie, avec des questionnements auxquels j’ai dû répondre. À 18 ans, j’étais à Jérusalem, dans la ville la plus spirituelle au monde, et j’ai rencontré une femme qui m’a demandé si je croyais en Dieu. Je ne m’étais jamais véritablement posé la question parce que pour moi, la croyance était une évidence. Ce questionnement a commencé à nourrir mon esprit et mes tensions. Et je me suis dit à ce moment-là que j’avais moins de raisons de croire que de ne pas croire. J’ai donc fait le choix de ne plus croire. J’ai en revanche conservé une culture, des traditions et une spiritualité juive. On peut parler plutôt d’agnosticisme.
«J’ai donc fait le choix de ne plus croire. J’ai en revanche conservé une culture, des traditions et une spiritualité juive.»
Qu’est-ce qui a déclenché cette prise de distance?
Mes parents ont passé une grande partie de leurs vacances en Israël, pour la bonne raison qu’une grande partie de ma famille avait atterri en Israël. Quand j’avais 17 ou 18 ans, mon objectif était de m’y installer et de devenir Israélien. J’étais chaque été sur place, parce que je préparais mon Alya (le fait, pour un Juif, d’immigrer en Israël, ndlr). Comme tout est fermé le samedi, jour de Shabbat, j’avais pris l’habitude d’aller dans la vieille ville, la ville arabe palestinienne, et de me rendre dans le souk pour y boire un café, juste derrière la porte de Damas. Et je me suis mis à discuter avec le patron du café, qui a commencé à me raconter sa vie.
Une vie, j’imagine, bien différente de celle des juifs…
En effet, il a commencé à me dire qu’il avait toujours été là, de génération en génération, mais qu’il était considéré comme un étranger sur sa propre terre. Moi qui étais encore étranger sur la terre dont je voulais faire partie, j’en ai ressenti un très grand choc. Il me racontait les discriminations qu’il vivait. Il avait été chauffeur de taxi et avait dû arrêter cette profession, parce que les réglementations administratives compliquaient énormément son travail. Il était donc devenu patron de café. Et le sentiment de non-appartenance qu’il me confiait a creusé en moi une forme de brèche dans la réalité israélienne.
Dans quel sens?
Il y avait une discordance terrible entre ce qu’il me racontait et les valeurs de ma culture française faite d’égalité, d’universalisme et du principe de laïcité, une culture qui ne faisait pas de différence entre les confessions. Moi qui suivais des études de droit, ce que je voyais de la réalité israélienne, où l’on a plusieurs cartes d’identité en fonction de sa religion, était quelque chose que je n’arrivais pas à saisir, ni à admettre. J’ai donc dû choisir entre cette identité sioniste fictive et mon identité franco-juive. Et j’ai alors choisi de ne plus devenir citoyen israélien. C’est à ce moment-là que j’ai renoncé à mon identité sioniste.
Pourtant, vous ne vous dites pas antisioniste?
Non, car je considère qu’Israël a un droit à exister. En revanche, je suis extrêmement critique concernant l’évolution de la politique israélienne, à l’égard du colonialisme en Cisjordanie, et du non-respect du droit international et notamment des résolutions de l’ONU qui faisaient un partage entre la Palestine et Israël. Donc je ne peux pas me dire antisioniste, au sens où je ne conteste pas l’existence de l’Etat d’Israël.
«Je suis extrêmement critique concernant l’évolution de la politique israélienne, à l’égard du colonialisme en Cisjordanie.»
Vous devenez avocat en 2001 et en 2014, vous défendez lors d’un procès une personne accusée d’actes antisémites. Que se passe-t-il à ce moment-là?
On me demande de défendre deux jeunes gens interpellés dans le cadre d’une émeute à caractère antisémite, à Sarcelles, ma ville de naissance. C’est donc avec ma robe d’avocat que je les défends, sans imaginer les conséquences que cela pourrait avoir. Beaucoup de personnes avaient été interpellées. Des magasins juifs mais aussi une pharmacie, des tabacs et une épicerie avaient été brûlés. Une confrontation s’était produite entre deux jeunes juifs, stationnés devant la synagogue pour la protéger, et des personnes qui avaient participé à cette émeute, qui était en réalité liée à une manifestation en soutien à Gaza.
En 2014, Israël avait lancé l’opération Bordure protectrice, c’est ça?
Quelque 2000 civils avaient déjà été tués dans le cadre de bombardements israéliens, et cette manifestation avait été interdite tardivement par la mairie et la préfecture. Il y a eu pour cette raison une incompréhension et cela a viré en émeute antisémite. Je défends donc ces deux jeunes gens et en sortant du tribunal, je me retrouve pour la première fois de ma vie devant une herse de caméras et de micros, et on me demande: «Maître, comment s’est passé l’audience?» Je me retrouve sur les écrans de télévision et les gens de Sarcelles, tout comme ma famille et des proches se demandent pourquoi moi, jeune juif de Sarcelles, je défends deux personnes qui participent à une émeute antisémite. Je peux comprendre leurs interrogations, mais je ne m’attendais pas à la violence que cela a entraîné. Car il s’est agi d’une forme d’exclusion, ce qu’on appelle «herem», en hébreu.
La peine de bannissement…
J’ai perdu énormément d’amis, j’ai été insulté, injurié, menacé par des membres de la communauté juive. Ma famille a aussi été menacée, parce que la communauté juive commençait à subir une augmentation de l’antisémitisme et qu’elle ne pouvait pas comprendre qu’il n’y ait pas de solidarité de tous ses membres contre un ennemi commun: ceux qui soutenaient la cause palestinienne, cette figure de l’arabe, du musulman, du jeune des quartiers populaires qui était en train de se cristalliser dans les esprits et qui créait deux camps, à l’aune de la situation israélo-palestinienne.
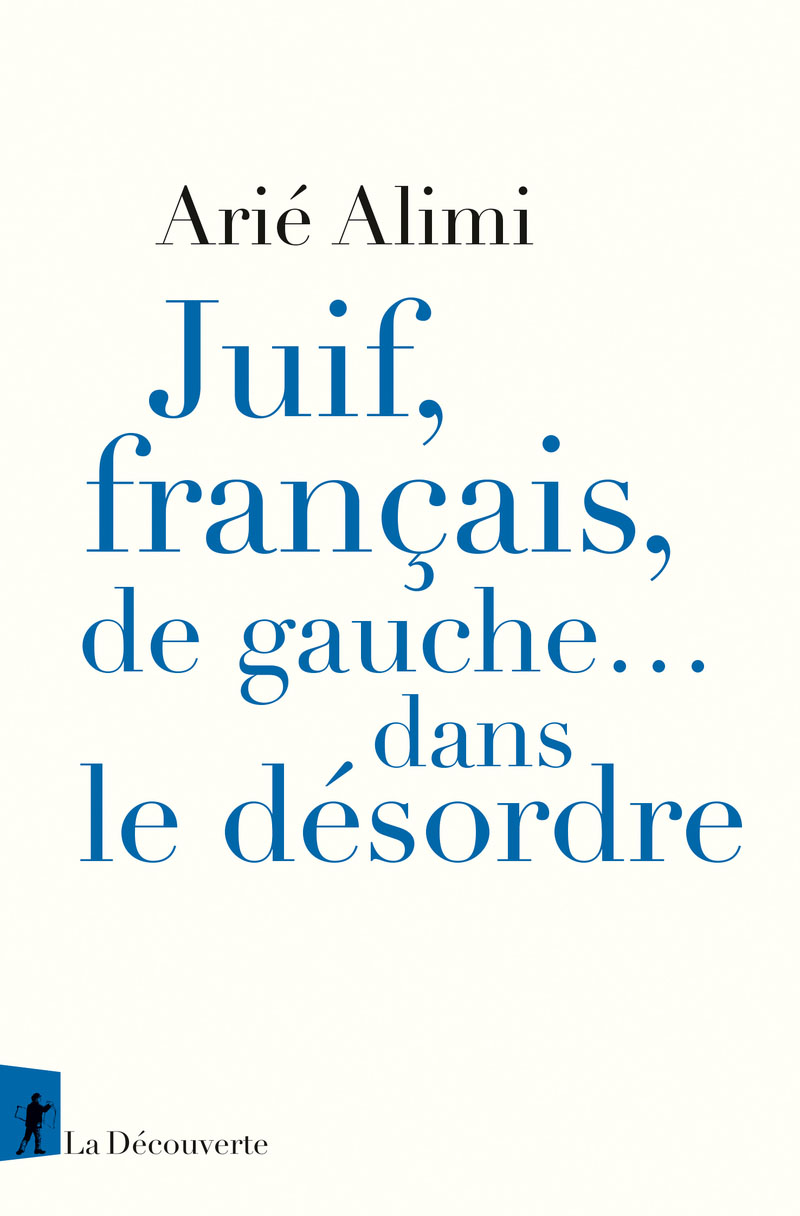
Et c’est là que la famille politique de la société civile de gauche vous ouvre les bras?
Oui, mon positionnement d’avocat m’avait mis dans une situation de conflit d’identité. Même s’il n’y a à priori pas de difficulté à défendre des personnes ayant participé à des manifestations à caractère antisémite, cette tension interne m’a orienté vers la nécessité d’une forme de catharsis. Pour la première fois de ma vie, j’écris un texte sur le club de Mediapart et le lendemain matin, je suis réveillé par une succession de notifications et quelques heures plus tard, par l’appel d’un journaliste qui s’appelle Edwy Plenel (cofondateur, en 2008, du site d’information Mediapart, ndlr), que je ne connaissais pas et qui m’invite pour parler de ces conflits que je vis.
C’est là que tout a commencé…
Oui, en tout cas ma vie publique. J’ai été accueilli par une autre communauté, celle de toutes les gauches, des écologistes, des féministes, des antifascistes, des anarchistes. Une succession de figures que je ne côtoyais pas à cette époque et qui ont senti que cette bascule pouvait peut-être aussi nourrir leur réflexion. De mon côté, j’avais aussi besoin d’une autre famille parce que j’étais exclu de ma propre famille confessionnelle. C’est à ce moment-là que je suis devenu un avocat militant. J’ai rejoint la Ligue des droits de l’homme et conjugué ce combat avec celui sur les violences policières.
J’avais aussi besoin d’une autre famille parce que j’étais exclu de ma propre famille confessionnelle.»
Et puis survient le 7 octobre 2023. Comment est-ce que vous le vivez?
Face au cataclysme que représente cette tuerie de masse pour les Israéliens et les communautés juives à travers le monde, je ressens un choc face aux réactions de certains parmi les gauches dont je me sens le plus proche. Ils mettent en équivalence l’occupation en Israël et en Palestine depuis 1948, que je combats et dénonce, et ces attaques. Comme si pour certains, pas pour tous je précise, elles en étaient la conséquence et que cette violence contre des civils se justifiait historiquement. Je me suis toujours senti proche du peuple israélien, parce que je suis juif, mais aussi un humaniste convaincu. Viser et tuer des civils, avec une volonté de rendre publique cette horreur, constitue pour moi une fracture interne profonde. Et constater qu’on ne peut plus se réclamer de cet humanisme m’a semblé être une fracture également par rapport à ce camp des gauches.
Parce qu’on vous a au fond sommé de choisir votre camp…
Oui, là encore, on m’a renvoyé, comme ce fut le cas en 2014, à mon identité juive humaniste en me disant que je n’étais pas vraiment un militant décolonial, et qu’il me fallait accepter la mort comme seule manière d’y arriver. Et si je ne l’acceptais pas, je ne faisais plus partie de ce camp ! J’étais même un traître.
Comment vous avez réagi?
Je me suis exprimé publiquement, en me prenant encore plus d’injures, parce que je devenais un traître public. Mais le sentiment qu’on me renvoyait de trahison était beaucoup plus faible que le sentiment d’horreur que je ressentais face au meurtre de masse. Je n’avais pas de difficulté à réarticuler mes différentes identités pour penser ce moment et ce conflit. La question était et reste de savoir si tous les moyens sont bons pour arriver à l’émancipation et à l’autonomie d’un peuple qui subit le joug colonial. Certains pensent que oui, moi je pense que non. Je me réfère à des expériences historiques de décolonisation, comme l’apartheid sud-africain. Considérer qu’un acte terroriste visant des civils est un acte de résistance est une erreur profonde, car il faut selon moi intégrer une question morale dans l’action décoloniale.
Découvrez l’entretien complet dans le podcast de l’émission radio «Babel»,
sur rts.ch/religion/babel, ou via l’App Play RTS, sur smartphone.
Vous l’écrivez dans votre livre, le judaïsme sera décolonial ou ne sera pas. C’est un message audible pour la communauté juive?
Non, ce n’est pas du tout un message audible. Mais peut-être est-ce un message qu’il faut marteler. Car lorsqu’on en revient aux fondamentaux du judaïsme, on se rend compte que la situation politique actuelle viole les messages fondamentaux du judaïsme.
Selon vous, les textes sacrés du judaïsme auraient permis d’éviter la confrontation entre Israéliens et Palestiniens. À quels textes faites-vous référence?
Une pluralité. Je crois que la composante humaniste créée par le message du judaïsme est fondamentale. Je pense au Yovel, par exemple, le terme hébreu pour «jubilé», qui consiste à restituer la terre puisque la terre n’appartient pas aux hommes. Tous les 50 ans, elle revient à Dieu. Et si l’on reprenait l’esprit de cette institution, on pourrait se dire que cette terre pour laquelle se battent les Israéliens et les Palestiniens est une terre commune universelle et qu’elle devrait peut-être donner lieu à un autre traitement. Je pense aussi à «Ahavat Yisrael».
Ce message du judaïsme qui signifie aimer son prochain comme soi-même, et qui est devenu le message premier du christianisme, est un message fondamental qui devrait conduire à ne pas tuer l’autre, à ne pas l’opprimer. Ce sont ces messages universels du judaïsme qui devraient conduire l’Etat d’Israël à respecter ses fondamentaux, ce qui permettrait peut-être d’aller vers une pacification.
Comment voyez-vous la suite de votre engagement?
Je poursuis plus que jamais mes engagements, en essayant de créer du lien entre ceux qui se crispent dans des identités idéologiques figées, voire dogmatiques, d’un côté comme de l’autre. J’essaye de continuer à dialoguer avec les uns et avec les autres, pour casser les blocs et pour casser les narratifs collectifs et personnels. (cath.ch/cp/bh)
Juif français de gauche, dans le désordre, Arié Alimi, Ed. La Découverte, 2024, 144 p.
Un avocat militant
Avocat français et membre de la Ligue des droits de l’Homme, Arié Alimi naît le 16 juin 1976 à Sarcelles, au nord de Paris, d’un père algérien et d’une mère tunisienne. Il grandit au sein de la communauté juive séfarade, mais se revendique depuis l’âge de 18 ans athée, tout en respectant les prescriptions alimentaires de la religion juive. Il a récemment salué la reconnaissance officielle de la Palestine par la France (22 septembre 2025). CP




















