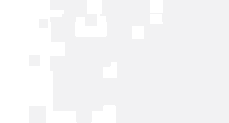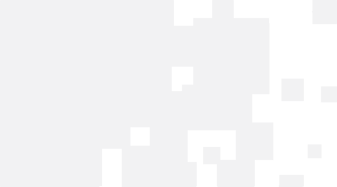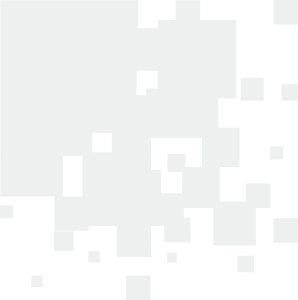Alain Dieckhoff: «La mondialisation a favorisé l’évangélisme et le salafisme»
Si la pratique religieuse continue à diminuer, les mouvements religieux radicaux, eux, ont le vent en poupe. Comment comprendre cette évolution? Est-elle un symptôme de la crise de la modernité? Un danger pour la démocratie? L’analyse du sociologue Alain Dieckhoff. Il a dirigé l’ouvrage Radicalités religieuses. Au cœur d’une mutation mondiale (Ed. Albin Michel).
Carole Pirker / RTS Religion
Catholicisme identitaire, évangélisme, salafisme, bouddhisme militant ou judaïsme ultra-orthodoxe… Depuis une quinzaine d’années, le religieux revient en force sur la scène internationale, surtout sous ses formes radicales. Pour comprendre cette mutation et dresser une cartographie mondiale de ces radicalités religieuses, Alain Dieckhoff (voir encadré) a réuni l’expertise de 17 spécialistes, dont l’historien Denis Pelletier et le politologue Olivier Roy.
Un large éventail d’exemples dans les mouvements juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes et hindouistes permettent de saisir les différents types de radicalité, leur articulation avec le nationalisme et leur rapport à la violence, tout comme les variantes culturelles, politiques et géographiques de ce nouveau phénomène.
Vous expliquez qu’aujourd’hui, sous diverses latitudes, des fidèles, des hommes religieux et des responsables politiques mobilisent la religion pour se protéger d’un monde séculier vu comme menaçant, mais aussi pour mettre en œuvre des stratégies de conquête ou reconquête religieuse. Avez-vous des exemples?
Alain Dieckhoff: oui, par exemple, l’inauguration par le président Trump d’un bureau de la foi à la Maison-Blanche après son retour au pouvoir en janvier 2025. C’est le Premier ministre Narendra Modi, en Inde, qui se baigne dans les eaux du Gange à l’occasion d’un gigantesque pèlerinage, en février 2025. Ce sont aussi des rabbins de l’armée israélienne qui donnent un contenu sacré à la guerre menée par Israël à Gaza, alors qu’en face, le Hamas justifie ses propres actes, y compris le terrorisme, au nom de l’interprétation djihadiste de l’islam. Ces quelques exemples récents montrent que la religion est présente aujourd’hui beaucoup plus qu’elle ne l’était il y a 30 ans.
Pourtant, et les études le montrent, on assiste à un déclin des pratiques et des croyances. Pourquoi ces radicalités religieuses reviennent-elles en force? C’est paradoxal, non?
Sur la question des pratiques et des croyances, plus spécialement en Europe, ce phénomène, en effet, se poursuit. Mais, d’un autre côté, la rétractation du religieux dans l’espace privé, que l’on pensait aller de pair avec la sécularisation, ne se vérifie pas. Au contraire, il y a une nouvelle présence de la religion dans l’espace public, y compris dans des pays qui peuvent être sécularisés sur le plan des pratiques et des croyances. C’est un phénomène nouveau, massif et imprévu, et il prend souvent la forme de cette radicalité religieuse.
«La rétractation du religieux dans l’espace privé, que l’on pensait aller de pair avec la sécularisation, ne se vérifie pas.»
On s’imaginait que la modernité allait marginaliser le religieux. Or, vous le dites, on observe au contraire sa recomposition. A quel type de radicalité assiste-t-on?
Il y a deux modalités qu’il est vraiment important de distinguer: la radicalité piétiste et la radicalité activiste. Si toutes deux réclament une pratique rigoureuse et exigent de leurs fidèles un respect scrupuleux des normes religieuses, elles se distinguent aussi. La radicalité piétiste va en effet demander une très grande intransigeance religieuse. C’est par exemple le cas de l’ultra orthodoxie juive, de certains groupes chrétiens qui constituent des communautés qui se séparent le plus possible de la cité séculière qui les environne, et c’est aussi le cas en islam du salafisme. Mais au-delà de cette exigence de rigueur religieuse, qui va de pair avec un séparatisme social assumé, il n’y a pas de projet politique. Ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir.
Contrairement, donc, aux radicaux activistes…
En effet, les activistes veulent non seulement prendre le pouvoir mais imposer leur vision du monde à l’ensemble de la société, croyants et non croyants. Ils sont évidemment plus menaçants pour ceux qui ne sont pas croyants, que les radicaux piétistes qui vivent à part, avec une sorte de mur de séparation symbolique, et parfois même réel, qui les sépare de la cité séculière.
«Les activistes veulent non seulement prendre le pouvoir mais imposer leur vision du monde à l’ensemble de la société.»
Et qui trouve-t-on parmi les radicaux activistes?
C’est le cas des sionistes religieux en Israël et de ceux qui se réclament de la mouvance des Frères musulmans. On peut aussi penser à certains groupes évangéliques, en particulier aux États-Unis, mais aussi à des catholiques, un élément nouveau qui n’était pas attendu.
Donc, plus que jamais, le religieux se trouve mêlé au politique. Est-ce un danger pour la démocratie?
Oui, parce que cette mutation est évidemment inconciliable avec la tolérance religieuse qui devrait exister dans les sociétés modernes, où la pluralité religieuse devrait être la norme. Donc à l’inverse, si on veut lier l’État à une religion, celle en général de la majorité, on rentre presque inévitablement dans une logique discriminante vis-à-vis des autres groupes religieux. C’est donc un danger pour le vivre ensemble, en tous les cas dans les sociétés modernes.
Mais existe-t-il des contre-feux par rapport à cette mutation?
Les contre-feux doivent être en partie politiques. L’impératif, en tous les cas dans les sociétés démocratiques, est de continuer à défendre et à redonner une nouvelle vigueur au modèle démocratique fondé sur la tolérance. Mais aujourd’hui la tâche est ardue, car ce modèle démocratique est en crise. Il n’est pas contesté uniquement par les radicalités religieuses, mais en partie par elles. D’autant plus lorsque celles-ci sont prises en charge par des partis politiques, en particulier les partis populistes, dont certains défendent un identitarisme chrétien.
L’autre contre-feu, qui lui aussi est une flamme un peu vacillante, est la mobilisation du religieux pour prôner le dialogue, la tolérance et l’œcuménisme. Mais dans les sociétés occidentales, cette modalité plus ouverte du religieux, à l’instar du christianisme social des années 70 et 80, est aujourd’hui bien plus affaiblie.
Est-ce que cette mutation est un symptôme de la crise de la modernité?
Clairement oui, dans les sociétés les plus développées, la modernité est allée de pair avec une montée de l’individualisme. Elle a conduit à ce que l’on appelle en sociologie l’anomie des sociétés, c’est-à-dire une sorte d’atomisation préjudiciable au vivre ensemble. Le religieux bien trempé et affirmé prétend répondre à ce vide et redonner un sens au collectif. Par ailleurs, la modalité du collectif, porté jusque-là par le politique sous la forme de la défense de l’État-nation, est en crise aujourd’hui. Les mouvements populistes, qui prétendent redonner du sens au collectif, s’en sont emparé, en s’alliant parfois avec certains groupes religieux radicaux qui veulent, eux aussi, redonner un peu un sens au collectif.
La modernité est donc vécue comme une menace pour ces nouveaux courants intégristes ou fondamentalistes…
Oui, et aussi comme une impasse. La modernité qu’on envisageait à la fin des années 1980 avec la chute du communisme, par une sorte de diffusion généralisée à la fois de l’économie de marché et du libéralisme n’a pas fonctionné. Il n’y a pas eu de diffusion générale du modèle libéral individualiste et d’enthousiasme autour de lui. C’est au contraire plutôt la désillusion.
Donc cette crise est là, il n’y a pas de doute, avec des entrepreneurs religieux ou politiques qui proposent leur réponse. Dans certains pays, ils ont du succès. C’est par exemple le cas aux États-Unis, avec une droite conservatrice et des groupes religieux protestants et catholiques qui font alliance avec elle, tous unis contre une modernité qu’ils considèrent être dans une impasse, et qui l’est objectivement en un certain sens.
Vous citez le cas de l’intégrisme catholique à la Mgr Lefebvre, qui véhicule une vision où le catholicisme a vocation à occuper une place privilégiée dans l’État et dont certains adeptes se retrouvent au sein du Rassemblement national. On voit bien ce glissement entre religion et politique.
Oui, absolument. Il est indéniable que l’on a dans le courant traditionaliste de Mgr Lefebvre et de ses disciples une vision catholico-nationale, qui était par exemple en vogue sous l’Espagne franquiste et qui existe aujourd’hui dans certains courants extrêmes aux États-Unis, avec une demande très claire de refondation de la nation américaine comme nation chrétienne et un gouvernement qui serait établi sur la loi biblique. Là aussi, on est vraiment dans la politisation de la religion.
«Dans des sociétés historiquement catholiques, la minorité des pratiquants a tendance à vouloir affirmer un catholicisme très fort.»
L’historien Denis Pelletier explique que le catholicisme est devenu ce qu’il appelle une «minorité globale». Quelles sont les conséquences de ce nouvel état de fait?
En effet, il est presque partout présent dans le monde, mais aussi presque partout minoritaire. En Afrique et en Asie, en raison de la présence bien plus massive d’autres religions, en Europe et en Amérique, du fait de la sécularisation. Denis Pelletier montre que le catholicisme n’a jamais été autant globalisé qu’au XXᵉ siècle, alors qu’il est devenu minoritaire dans les pratiques. C’est cette situation paradoxale qu’il met en lumière. Beaucoup de Français, par exemple, sont d’origine catholique, mais très peu aujourd’hui le sont dans la pratique. Dans des sociétés historiquement catholiques, la minorité des pratiquants a tendance à vouloir affirmer un catholicisme très fort. Parce qu’elle veut se défendre d’un monde perçu comme hostile et comme n’étant pas porteur de sa foi.
Les deux mouvances qui ont le plus profité de la mondialisation sont le salafisme et l’évangélisme. Comment expliquer leur dynamisme?
En effet, la mondialisation a favorisé l’essor de l’évangélisme et du salafisme. Leur dynamisme tient au fait qu’ils proposent une modalité religieuse largement déconnectée des cultures locales. Autrement dit, le salafisme, par exemple, demande une pratique rigoureuse, mais indépendamment de la culture d’accueil: vous pouvez pratiquer le même type d’islam que vous soyez à la Mecque ou à Bamako. C’est la même chose pour l’évangélisme. S’il est historiquement beaucoup plus développé en Amérique du Nord, originellement sous la forme du néo pentecôtisme, il peut s’exporter, en particulier en Afrique, parce qu’il est, lui aussi, assez largement détaché de ce substrat culturel. Autrement dit, on peut être évangélique aussi bien à Chicago qu’à Abidjan ou ailleurs.
Quel est le rapport de ces mouvements religieux radicaux à la violence?
Il est très variable. Ces dernières années, dans le monde du christianisme au sens large, la violence a été relativement limitée, hormis celle qui a pu s’exprimer par exemple aux États-Unis dans certaines attaques contre des cliniques pratiquant des interruptions volontaires de grossesse. Dans le monde juif, la violence existe en Israël. Elle n’est pas le fait des ultra-orthodoxes, mais des sionistes religieux qui sont dans une logique de confrontation avec les Palestiniens. Étant en Cisjordanie le fer de lance de la colonisation dans les territoires occupés, ils sont dans une logique de violence assumée. On a aussi le cas de l’islam, un univers religieux très complexe et diversifié, il faut le souligner. Le mouvement du djihadisme salafiste, qui s’est développé dans une frange extrême de l’islam salafiste, revendique aussi la violence, tant dans les sociétés musulmanes qu’à travers des attentats aux États-Unis ou en Europe.
Retrouvez l’entretien dans l’émission radio «Babel», sur RTS Espace 2,
en podcast sur rts.ch/religion/babel, ou via l’App Play RTS, sur smartphone.
Depuis 25 ans, soit depuis les attentats du 11 septembre 2001, on tue toujours plus au nom de la religion. Si on prend l’exemple de l’islam, on dénombrait 2194 attentats entre 1979 et 2000, et 56’413 entre 2013 et 2024, selon une étude de la Fondation pour l’innovation politique, un laboratoire d’idées français. Comment comprendre ces ressorts religieux de la violence?
Ils tiennent au fait que les religions peuvent être interprétées de façon très différente. C’est un point qui me paraît vraiment important. Aucune religion n’est violente ou pacifique en soi. Cela dépend des contextes et des moments historiques. Toute religion peut, à certains moments, verser dans la violence. Le meilleur exemple est celui du bouddhisme, une religion à priori pacifique qui n’engendre pas de violence. Mais en fait, si. La violence existait au Sri Lanka de la part de certains moines bouddhistes et elle est aujourd’hui très forte dans le Myanmar. Des moines bouddhistes y prônent une violence directe pour défendre ce qu’ils appellent le bouddhisme comme religion, mais aussi l’État et la race birmane. C’est une sorte de conglomérat où religion et nation sont mêlés. Le but est de se protéger contre ce qui est perçu comme une menace insidieuse, qui vient en l’occurrence de l’islam, des fameux Rohingyas qui sont aux frontières du Bangladesh.
«Aucune religion est violente ou pacifique. Cela dépend des contextes et des moments historiques.»
Un autre cas où religion et nation sont mêlées est celui des États-Unis. On y assiste à la montée d’un mouvement nationaliste chrétien, avec un Donald Trump qui prétend incarner une mission providentielle. Comment ces radicalités religieuses s’articulent-elles avec le concept de nation?
Cela dépend du type de radicalité. La radicalité piétiste est en général plutôt détachée du référentiel national. En revanche, la radicalité activiste fonctionne très bien avec le cadre national. C’est évident pour les sionistes religieux, puisqu’ils réfléchissent dans un cadre national, celui de l’État d’Israël. Selon eux, le territoire israélien doit être plus large que celui de l’État souverain créé en 1948, d’où leur implication très forte dans la colonisation de la Cisjordanie. Mais c’est vrai aussi de toutes les formes d’identitarisme chrétien aujourd’hui. Ils s’inscrivent dans un cadre national: le nationalisme chrétien aux États-Unis ou le nationalisme chrétien à la mode Orban en Hongrie. En fait, le lien entre populisme et nationalisme chrétien est très fort dans beaucoup de cas de figure. (cath.ch/cp/bh)
Radicalités religieuses. Au cœur d’une mutation mondiale, sous la dir. d’Alain Dieckhoff, Ed. Albin Michel, 2025, 343 p.
Un spécialiste de la politique israélienne
Né le 9 décembre 1958, Alain Dieckhoff est un sociologue, chercheur et enseignant français, directeur de recherche au CNRS spécialisé dans la politique et la société contemporaine d’Israël. Il enseigne à l’Institut d’études politiques de Paris. Il a dirigé entre 2012 et 2013 le département de science politique de l’Institut d’études politiques de Paris et de janvier 2014 à décembre 2023 le Centre de recherches internationales. Son champ de recherche principal porte sur la politique, la société contemporaine et les transformations de l’État en Israël. Il travaille également sur les mutations du nationalisme contemporain. CP