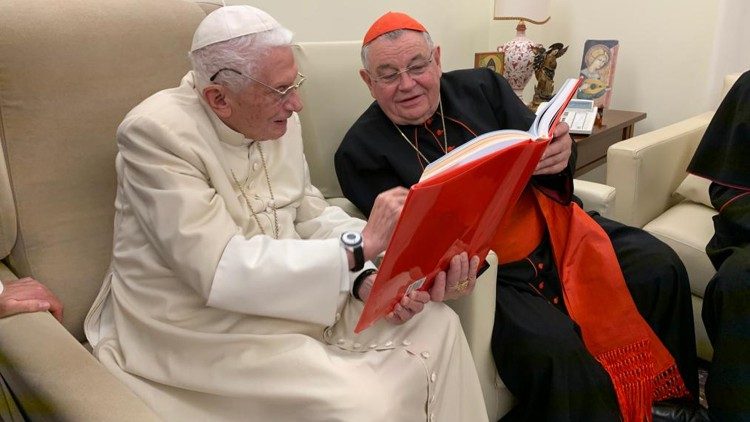Guillaume Dezaunay: «Les questions économiques sont centrales dans la Bible»
Peut-on lire l’Évangile comme une sorte de manifeste communiste? Cʹest lʹavis du jeune philosophe catholique français Guillaume Dezaunay. Selon lui, la Bible appelle à dépasser la logique mortifère de l’appropriation et même à construire un autre régime économique. Il le développe dans Le Christ rouge (Ed. Salvator).
Matthias Wirz / Adaptation: Carole Pirker
«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent» (Mt 6, 24). À travers de nombreuses paraboles, l’Évangile ne se prive pas de critiquer l’asservissement par l’argent et s’oppose à la propriété comme jouissance exclusive, de même qu’il rejette le pouvoir perçu comme maîtrise d’autrui. Selon le Christ, nos biens et nos statuts ne nous appartiennent pas vraiment mais sont des dons à partager.
C’est ce que Guillaume Dezaunay appelle «la force révolutionnaire de l’Évangile». Dans Le Christ rouge, ce professeur de philosophie (enc. 1) au ton vif et incisif nous en livre une lecture politique et percutante.
Est-ce que le Christ était un communiste avant l’heure?
Guillaume Dezaunay: oui, même si le mot peut être un peu effrayant, je dirais qu’il est communiste dans le sens où il refuse l’appropriation privative des biens. Il y a énormément de paraboles économiques dans l’Évangile qui vont dans cette direction. Elles consistent à dire qu’il y a un problème lorsqu’on s’approprie les biens pour soi-même et pour son profit. Le Christ est communiste dans ce sens qu’il affirme que les biens sont à tous, pour tous, et que celui qui cherche à les garder pour lui et son profit personnel est injuste.
Donc, l’Évangile appelle à la révolution?
Dans un certain sens, oui, mais il n’appelle pas à une révolution violente, plutôt à un renversement des valeurs. Celles que les hommes placent habituellement en haut, à savoir la gloire, l’honneur, le pouvoir et la possession. L’Évangile fait l’éloge de valeurs inverses. Il dit: «heureux les pauvres», «les derniers seront les premiers», les prostituées méritent d’être traitées avec dignité et les étrangers d’être accueillis. En outre, la plupart des paraboles sont remplies de figures économiques: des intendants, des marchands, des gens endettés, des responsables d’entreprises, etc. Les questions économiques sont donc centrales dans la Bible. Je me demande dès lors pourquoi l’Église parle autant de morale sexuelle et si peu de morale économique.
«La plupart des paraboles sont remplies de figures économiques: des intendants, des marchands, des gens endettés.»
Le christianisme passe donc à côté de sa vocation?
Je le pense, oui, car tout l’Évangile est une charge contre l’hypocrisie et c’est terrible de me dire que parfois, le lieu où je vois le plus d’hypocrisie, c’est à l’église, notamment sur la question de la pauvreté (enc. 2). Il suffit de rentrer dans une église pour se sentir mal à l’aise. Parce que vraiment, il n’y a que des textes qui disent: «Heureux les pauvres». Si l’on regarde l’assemblée, ce sont globalement des riches, qui pratiquent parfois un mépris de classe que je connais bien, puisque je viens, moi aussi, du milieu de la bourgeoisie catholique. Je crois que les chrétiens doivent lutter contre l’appropriation privée du monde et faire en sorte qu’il y ait des structures de partage des richesses plus efficaces. Cela me paraît central.
En faisant une lecture trop spirituelle ou spiritualiste, on neutralise finalement la force que ces textes peuvent contenir?
Absolument. Il y a selon moi deux risques à une lecture trop spiritualiste: celui de sombrer dans l’imaginaire et aussi de faire de la religion une sorte d’opium, alors qu’on doit travailler sur la mise en œuvre du règne de justice, qui commence dès ici-bas!
Selon vous, on peut aussi traduire le sens de l’amour par le mot justice…
C’est une question vraiment importante, parce qu’il me semble que l’amour dont parle l’Évangile vise toujours la mise en œuvre de la justice. Il s’agit toujours de réintégrer dans la société des gens qui en sont exclus ou qui y sont dominés. Le sens de la justice serait selon moi l’insertion sociale de tous dans une unité où chacun trouve sa dignité, et l’amour évangélique, un amour qui rend possible la justice.
«L’Évangile fait constamment l’éloge de la gratuité.»
L’Évangile est un évangile de la gratuité. Le Christ serait rouge de colère face à nos appétits mercantiles…
Absolument! L’Évangile fait constamment l’éloge de la gratuité. Il contient une seule scène de réelle colère du Christ, celle où il chasse les marchands du temple. Cette figure du marchand du temple a pour lui quelque chose d’assez horrifiant lorsqu’elle empiète sur le sacré, c’est-à-dire les plus fragiles. L’Évangile nous dit: «ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement». Il va contre notre tendance appropriative, très ancrée en nous. L’Évangile est une proposition pour lutter contre cette tendance, pour réinstaurer en nous et entre nous l’esprit de gratuité, pour y trouver la joie du partage.
Et donc la propriété privée n’existe pas, selon l’Evangile?
C’est la proposition d’interprétation que je fais des paraboles des intendants. Finalement, personne n’est réellement propriétaire, puisque le statut donné aux hommes est celui d’intendant. Il n’est pas le propriétaire. Ce qu’il a reçu n’est pas vraiment pour lui, mais pour servir d’autres gens. Dans un certain sens, la propriété n’existe pas. Les Pères de l’Église, aussi, disaient que si tu ne donnes pas quelque chose à un pauvre, toi qui es riche, ce n’est pas que tu as manqué de générosité envers lui, mais que tu l’as volé, parce que ce que tu as n’est pas à toi, mais à lui. Il y avait cette idée très forte que ce que l’on possède est pour tous.
Vous citez le philosophe anarchiste français du XIXᵉ siècle, Pierre-Joseph Proudhon, pour qui la propriété, c’est du vol. En quoi est-ce mal de s’approprier quelque chose reçu par héritage, un don reçu de nos parents?
Cette formule est polémique, mais si je dis l’esclavage, c’est du meurtre, personne ne s’opposera à cette phrase. Mais lorsque je dis que la propriété, c’est du vol, tout le monde dira que je suis un fou furieux, particulièrement dangereux. Proudhon savait que sa formule était très provocatrice, mais elle est finalement assez proche de celle des Pères de l’Église.
Découvrez l’entretien complet dans l’émission radio Babel du 26 mai 2024
Vous écrivez que le capitalisme peut être qualifié de «structure de péché». C’est une affirmation forte…
Je ne suis pas le premier à l’affirmer. Des papes l’ont fait avant moi, même s’ils parlaient plutôt du capitalisme libéral et très dérégulé. Il suffit de regarder ce qu’il se passe quand on a envie d’effectuer un travail utile, comme améliorer les objets qu’utilisent les gens, pour un ingénieur. Or, à l’intérieur du système capitaliste contemporain, les personnes de bonne volonté se retrouvent à faire parfois n’importe quoi, voire à devenir néfastes. L’ingénieur produit des fois des objets dont on n’a pas besoin ou développe des applications dont le but est de rendre les gens addicts, parce qu’il est dans une entreprise capitaliste dont le but est de s’enrichir. Un infirmier va maltraiter des patients car il n’a pas assez de temps pour bien s’en occuper. Ils se retrouvent malgré eux bloqués dans ce système. Dans ce sens-là, le capitalisme est une structure de péché, car des gens de bonne volonté se retrouvent malgré eux à faire du mal. Et on est beaucoup dans ce cas-là…
Selon vous, l’Évangile contient une charge contre l’appropriation privative et la maîtrise des autres. On touche donc aussi à la question du pouvoir.
Absolument, notamment avec cette phrase très explicite dans l’Évangile: «Ne vous faites pas appeler Maître, ne vous faites pas appeler Père.» L’appropriation concerne souvent l’appropriation des biens, mais le pouvoir peut aussi devenir l’appropriation des volontés des personnes. Souvent les deux vont de pair, parce que l’argent est une forme de pouvoir. Ainsi, l’appel évangélique à la désappropriation est aussi un appel à ne pas mettre la main sur les autres, sur leur liberté et leur volonté. Le Christ demande souvent aux gens ce qu’ils veulent et refuse de leur imposer quoi que ce soit. Il a un respect perpétuel de leur volonté, un amour particulier pour les fragiles sans pouvoir. Si j’étais provocant, je dirais que l’anarchie est un mot qui, dans l’esprit de beaucoup, signifie le chaos. Mais ce n’est pas le sens que leur donnent les intellectuels anarchistes. Selon Proudhon, l’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir. En fait, cela ne me paraît pas si loin de l’expression «règne de Dieu». (cath.ch/mw/cp/bh)
Le Christ rouge, Guillaume Dezaunay, Ed. Salvator, 2023, 170 p.
1/ Un catholique tendance rouge révolutionnaire
Professeur agrégé de philosophie, Guillaume Dezaunay a grandi en Charente et enseigne cette discipline dans un lycée à Metz, au nord de la France, ainsi qu’en maison d’arrêt. Ce catholique trentenaire a publié en 2018 un premier roman, La mort est un problème à résoudre (Ed. Balland). Avec Le Christ rouge (Ed. Salvator),il propose une exégèse subversive et politique des Évangiles. CP
2/ Une religion de riches parlant de pauvreté
«L’Eglise catholique me paraît une religion de riches parlant de pauvreté avec des trémolos dans la voix sans convaincre grand monde, une force réactionnaire lisant chaque dimanche des textes révolutionnaires sans s’inquiéter outre mesure de la déflagration que cela devrait déclencher dans le cœur des fidèles et dans les structures sociales.» Guillaume Dezaunay, Le Christ rouge CP