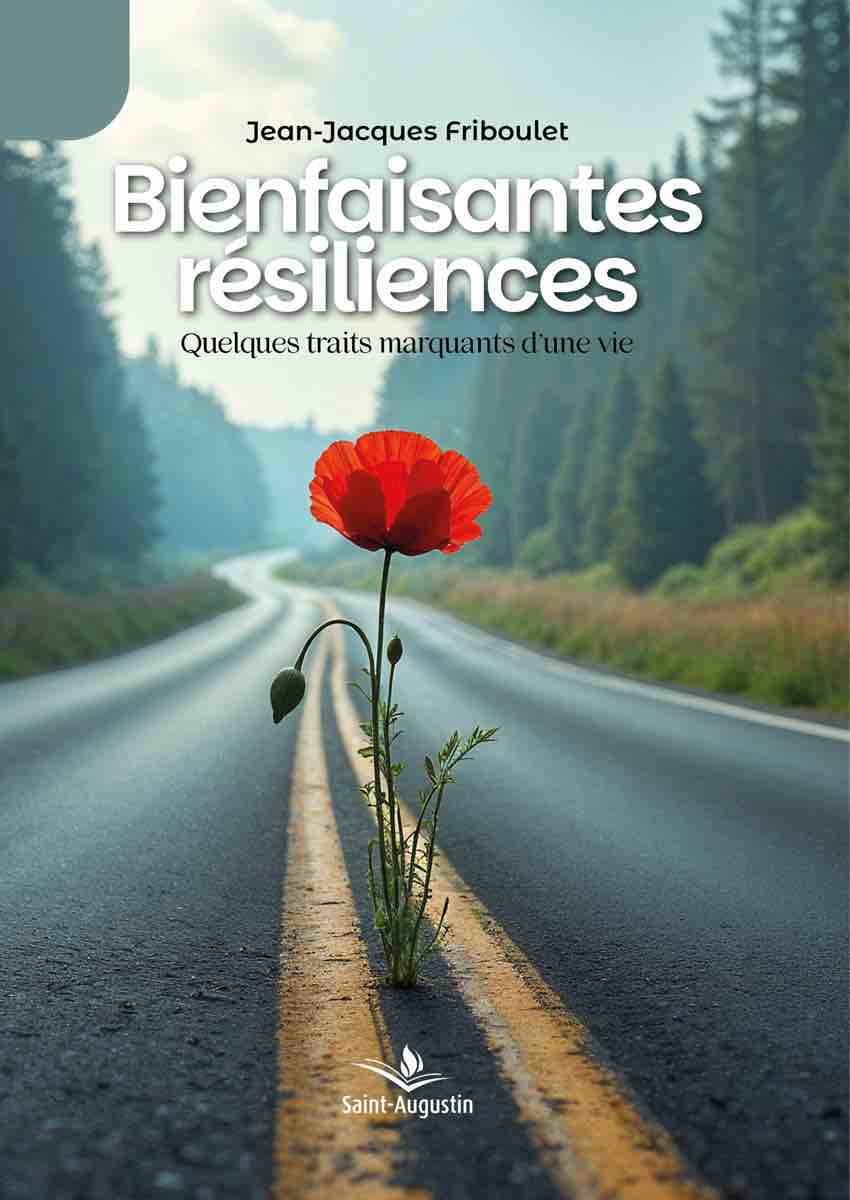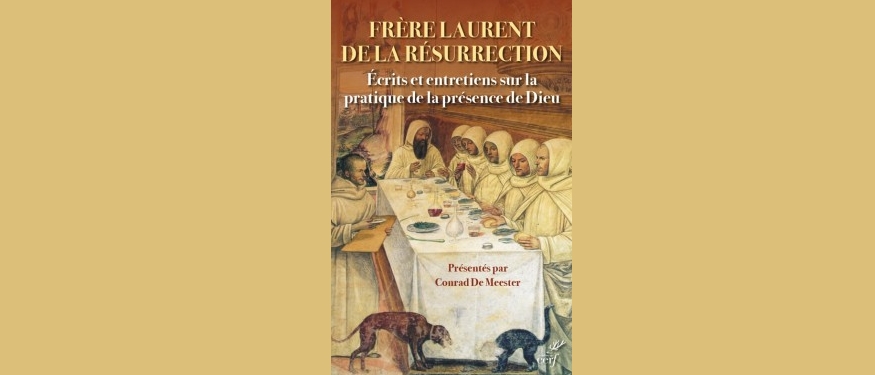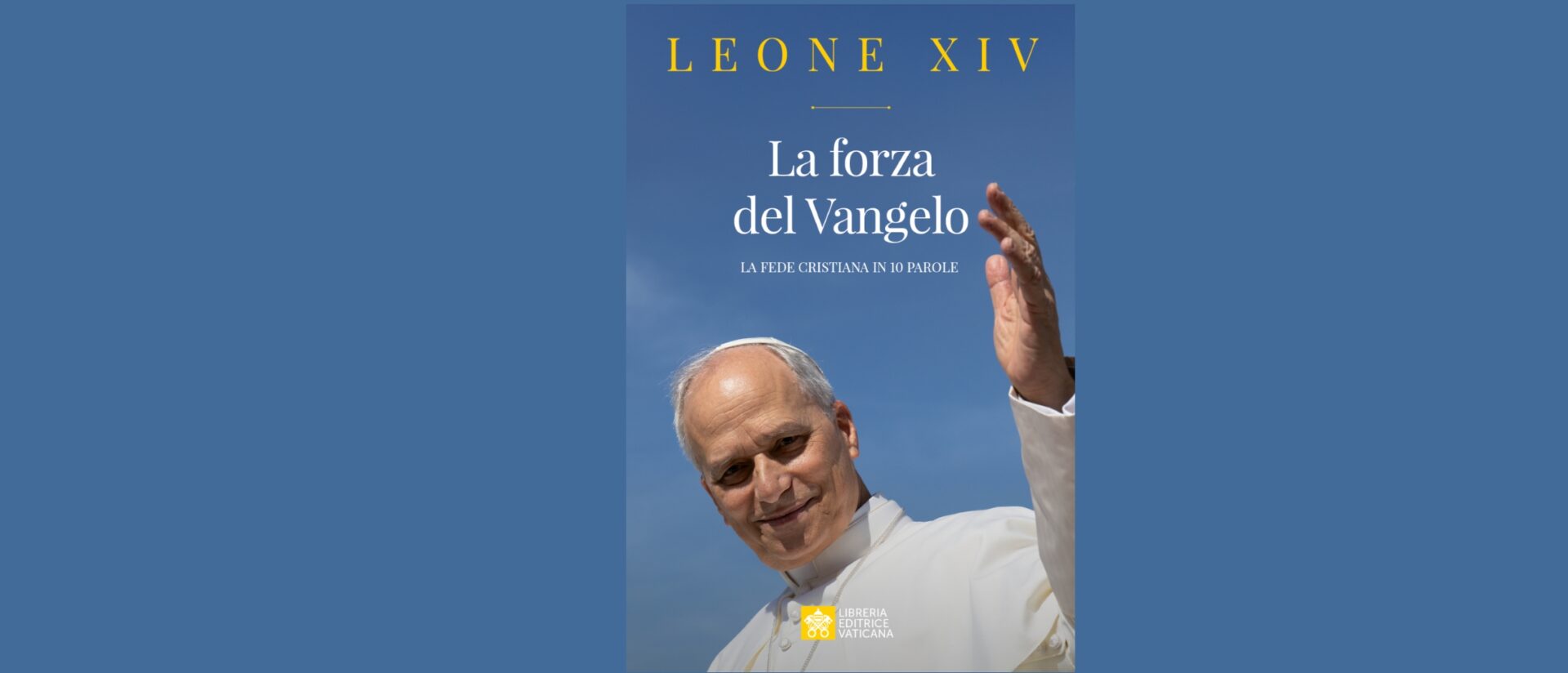J.J. Friboulet: «Mon itinéraire en zigzag m’a appris la résilience»
Attention, ce livre n’est pas une autobiographie classique. Dans Bienfaisantes résiliences, l’économiste chrétien Jean-Jacques Friboulet fait se côtoyer de façon originale expériences de vie et réflexions sur l’état de la planète, avec le liant de la spiritualité.
«Dans ces quelques pages je n’ai pas retracé l’ensemble de ma vie. Je n’ai abordé que les faits heureux et malheureux qui m’ont conduit à une résilience.» Telle est la précision apportée par Jean-Jacques Friboulet dans l’introduction de son dernier livre Bienfaisantes résiliences (éditions Saint-Augustin, 2025). Le professeur émérite d’économie et d’histoire de la pensée à l’Université de Fribourg, et chroniqueur sur cath.ch, y livre ses souvenirs, ses combats, ses coups de gueule, mais aussi ses espérances. Entretien.
On vous connaît comme auteur d’ouvrages scientifiques, notamment sur l’économie. Votre dernier livre est différent…
Jean-Jacques Friboulet: Oui, j’avais depuis longtemps envie d’écrire quelque chose au-delà de la dimension académique, quelque chose de plus personnel, de plus intime. Les réflexions d’une amie m’ont convaincu de m’y mettre. Elle m’avait notamment fait remarquer tous les événements dramatiques que j’avais vécus, en particulier depuis ma retraite, en 2014; et de quelle façon je m’en était toujours sorti, pas seulement au sens physique, mais aussi mental, moral et spirituel. Cette amie m’avait alors qualifié de «résilient». Je connaissais le terme, popularisé par Boris Cyrulnik, et c’est une notion qui me plaisait. Mais je me suis renseigné davantage sur ce que cela voulait dire. Ce qui m’a fait réfléchir sur ma vie et m’a donné l’envie de mettre tout cela sur papier.
Aussi pour les autres?
Mon livre est définitivement un livre d’espérance. En déroulant le fil de ma vie, j’ai constaté à quel point elle avait été chaotique. J’aurais rêvé d’un chemin droit, mais il a plutôt été en zigzag. Finalement, je porte sur cet itinéraire un regard positif, parce qu’il m’a appris la résilience, et cela à plusieurs reprises, c’est le sens du pluriel dans le titre.
Il ne faut jamais penser que l’avenir est bouché, parce que nous pouvons en tout temps trouver un soleil, dans la nature, dans la beauté, dans l’amour, dans la recherche de la vérité, dans les autres, dans la foi…
La résilience, ce n’est pas seulement revivre correctement, c’est trouver une ouverture à des voies nouvelles, que l’on ne percevait pas avant. Dans la période un peu sinistre et déstabilisante que nous vivons, il peut être important de le rappeler.
Quel rôle a joué la foi dans ces résiliences?
J’ai l’impression que le Christ m’a toujours accompagné. Il m’a pris sur ses épaules. Alors qu’à certains moments j’aurais dû sombrer, cela ne s’est pas produit, parce qu’il était là. Je pense que l’Évangile est un livre de vie, qui donne littéralement la vie à celui qui le lit.
La résilience n’est-elle pas toujours bienfaisante? Pourquoi avoir ajouté cet adjectif dans le titre?
C’est une question qui m’a été posée lorsque j’ai présenté mon livre à la Plateforme Dignité et Développement. Je tenais à qualifier ces résiliences de «bienfaisantes», pour marquer à quel point j’en avais retiré des bienfaits, des cadeaux.
Quel genre de cadeaux?
J’ai reçu aujourd’hui un message de mon ancienne secrétaire qui m’a annoncé le décès de sa maman. J’ai été touché par cette marque de confiance. Je vis comme un cadeau le fait d’avoir pu garder un si bon lien avec cette ancienne collaboratrice, alors que je suis à la retraite depuis onze ans. Ça peut paraître banal, mais je trouve magnifique de pouvoir faire d’une relation professionnelle une relation d’amitié durable.
On trouve dans votre livre des expériences de vie assez intimes en même temps que des réflexions intellectuelles globales sur l’économie, l’écologie, le monde académique…
Une idée qui m’a toujours accompagné pendant mes 25 ans d’enseignement est celle du lien entre microcosme et macrocosme. Ce livre traduit certainement le fait que j’ai toujours été engagé dans ces deux dimensions. Il m’a d’ailleurs été reproché de ne pas choisir mon camp. À la lecture de ce livre, certains m’ont dit: «Tu ne parles pas assez de ta vie.» D’autres: «La partie de réflexions macrocosmiques est intéressante, mais celle sur ta vie personnelle n’est pas terrible.»
«En ce qui concerne l’économie, j’ai l’impression d’une coupure complète avec la vie des gens»
Mais moi, je suis comme ça, je m’intéresse autant à la vie du monde qu’à ma propre vie et à celle des autres. Lorsque j’étais professeur, je laissais toujours la porte de mon bureau ouverte pour mes étudiants qui souhaitaient discuter, aussi de sujets qui n’avaient rien à voir avec les études. La rencontre personnelle, c’est ce qui fait le sel de la vie. Je crois vraiment que la vérité c’est l’être humain. Moi, Dieu, je ne l’ai jamais rencontré dans les nuages, mais dans la vie des gens, dans ma vie.
Dans le même temps, les personnes s’insèrent dans un contexte…
Absolument, et pour les comprendre, il faut comprendre l’environnement dans lequel elles évoluent. C’est pour cela que scruter le macrocosme est aussi essentiel. Mais on rencontre trop souvent la tentation de séparer les dimensions. Une dichotomie qui existe aussi bien dans le monde scientifique et académique que dans l’Église.
Vraiment?
En ce qui concerne l’économie, puisque c’est mon domaine, j’ai l’impression d’une coupure complète avec la vie des gens. Ce n’était pas le cas à mon époque. On parlait alors beaucoup du travail, de la formation, des cycles des vies, des personnes… L’économie était vécue comme une science humaine. En 1967, lorsque j’ai commencé, est sortie l’encyclique Populorum progressio du pape Paul VI, qui m’a vraiment enthousiasmé. J’y ai découvert une économie qui pouvait être au service de l’homme et non l’inverse.
Que s’est-il passé?
L’économie a dérivé principalement sous la pression du libéralisme nord-américain. Elle a perdu dans le mouvement son aspect social et humain, on s’est focalisé sur l’aspect macrocosmique. À mesure que l’on s’est orienté vers la finance, on l’a déconnectée complètement du monde réel. La numérisation et l’informatisation ont contribué à faire de l’économie quelque chose de plus en plus abstrait. Alors qu’avant, les scientifiques devaient se déplacer, rencontrer des gens, aujourd’hui, ils peuvent se contenter de rester devant leurs ordinateurs. L’économie est devenue une économie de chiffres, totalement déshumanisée.
«Bien sûr, il faut prier, accorder du soin à la liturgie. Mais les prêtres doivent également s’intéresser à la vie du monde»
Le secteur académique dans ce domaine a aussi été marqué par le scientisme. Beaucoup pensent qu’un bon scientifique est quelqu’un qui reste confiné dans sa discipline. Alors que moi j’avais tendance à toujours déborder. Cette interdisciplinarité ne plaisait pas à certains.
Le christianisme peut-il jouer un rôle dans une réhumanisation?
J’en suis convaincu. Mais pour cela l’Église doit rester sur les impulsions données par François, notamment par Laudato si’ (2015). Sa critique du paradigme technocratique est à cet égard ultra pertinente. Il a montré que la coupure de l’humanité d’avec la nature mène à sa propre destruction. La reconnexion à l’environnement est indispensable pour que l’homme redevienne plus humain. Cela exige un changement culturel et spirituel.
Les prêtres doivent être proches de la vie des personnes. Bien sûr, il faut prier, accorder du soin à la liturgie. Mais les prêtres doivent également s’intéresser à la vie du monde, ce qui manque à mon avis souvent dans les messes auxquelles j’assiste. Cette dichotomie existe aussi chez les fidèles, qui parfois ne font pas le lien entre leur vie chrétienne et leur vie personnelle.
Donc, selon moi, l’Église ne peut être un rempart contre l’absurdité du monde que si elle va dans le sens de cette unification de la personne et de l’ensemble. (cath.ch/rz)
Jean-Jacques Friboulet est né en 1949 à Dijon. En 1958, il est victime d’un grave accident à la jambe dont il subira toute sa vie les séquelles. Il se marie en 1970. En 1983, il réalise un doctorat sur l’économie de l’éducation. II est nommé en 1984 maître de conférences à l’Université de Bourgogne, et en 1989 professeur ordinaire à l’Université de Fribourg, où il crée en 1995 le cours d’économie du développement.
Entre 2002 et 2008, il s’acquitte de plusieurs missions en Afrique de l’Ouest et centrale. Il part à la retraite en 2014. Aujourd’hui divorcé, il a un fils et une fille.
Jean-Jacques Friboulet est un spécialiste reconnu de l’économie du développement et de l’histoire de la pensée et des faits économiques. Il s’est engagé depuis le début de sa carrière dans la promotion de l’enseignement social de l’Église. Il est l’auteur d’ouvrages de référence tels que La naissance de l’économie moderne. XIIIe-XXe siècles. Il poursuit aujourd’hui sa réflexion notamment à travers des chroniques régulières sur cath.ch. RZ