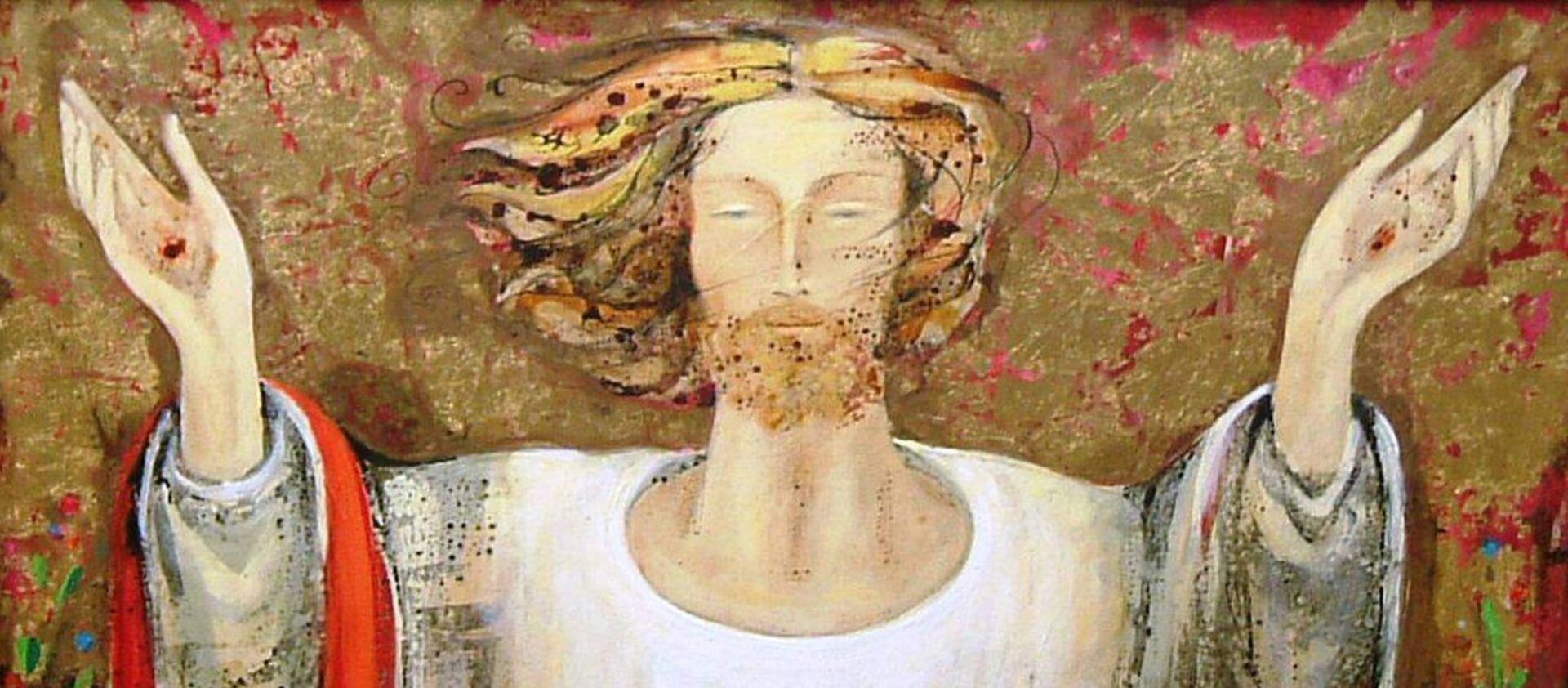La gratuité, un concept chrétien à éclaircir
Le christianisme et la gratuité font bon ménage. Mais comment l’homme libre peut-il, sans entrer dans une logique contractuelle, louer Dieu pour ses dons tout en œuvrant pour le Royaume? Dans son livre En toute gratuité? (Ed. Cerf), le théologien Jean-Marc Liautaud éclaircit une parole chrétienne parfois ambiguë sur la gratuité et la grâce.
Bernard Litzler, pour cath.ch
Votre livre évoque le caractère gratuit des dons de Dieu. Peut-on associer la grâce de Dieu et la gratuité ?
Jean-Marc Liautaud:Le mot «gratuité» est assez délicat à employer: on parle de don gratuit pour parler de générosité, mais on parle d’une violence gratuite pour un acte injustifiable. Dans l’acte de donner, la gratuité peut également qualifier à la fois la liberté de celui qui initie le don, mais aussi la liberté que le donateur laisse à son bénéficiaire de répondre ou pas à son initiative. La théologie chrétienne parle, depuis saint Paul, de «charis», c’est-à-dire de cadeau, pour qualifier le caractère foncièrement donateur du Dieu biblique. En latin, le terme «gratia» qualifie également l’aspect gracieux d’un être, la gratitude, la générosité et le désintéressement, le charisme d’un individu….

Le mot ouvre donc un champ de significations très vaste. Du coup, il a suscité des questions. La question n’est pas de savoir si la grâce divine est gratuite, mais de savoir dans quel sens elle l’est. Dieu est-il totalement libre de donner ce qu’il veut à qui il veut? Mais dans ce cas, ce don ne relève-t-il pas de l’arbitraire? Dieu attend-il quelque chose en retour, et si oui quoi? Oui, on doit associer grâce et gratuité, mais ce n’est pas suffisant. Il faut surtout savoir de quelle gratuité on parle et comment on en parle.
Le christianisme est donc ambigu face à la notion de gratuité?
Le thème est chargé! Le mot gratuité est très employé mais, en fait, peu pensé. Cela conduit à un discours délicat, facilement corruptible.
Délicat parce que la posture chrétienne, campée par saint Paul, est singulière. Le baptisé s’oblige vis-à-vis d’un Dieu qui n’oblige personne, puisqu’il a donné son pardon et son amour de manière inconditionnelle, en Jésus-Christ. La vie chrétienne est un triple «rendre»: rendre grâce – c’est la dimension du culte, de la prière et de la liturgie -, rendre compte – c’est le témoignage, l’évangélisation et la catéchèse -, rendre service – c’est la diaconie et la charité.
«Le mot de gratuité est ‘chargé’! Très employé, il est, en fait, peu pensé. D’où un discours facilement corruptible».
Mais ce «rendre» jaillit du fond du cœur, porté par l’Esprit de liberté. Il ne repose pas sur un système d’obligations légales. C’est toute la différence entre la première et la seconde Alliance. Du coup, le discours chrétien sur la grâce peut facilement tomber soit du côté de l’obligation légale en oubliant la gratuité, soit du côté d’une «gratuité» hors sol qui exalte des postures idéalistes, sacrificielles. Et parfois un mélange des deux
Mais la gratuité reste fondamentale dans l’Alliance avec le peuple élu…
Des siècles de débats ont prouvé que l’action de Dieu est «gratuite» au sens de vraiment libre. Personne n’achète Dieu, c’est lui qui a toujours l’initiative. Dans ce sens, la Bible parle d’une seule voix, depuis la Genèse jusqu’à saint Paul.
Par contre, on constate une diversité de postures dans la manière dont le Dieu de la Bible «oblige» ses partenaires vis-à-vis de lui. Dans l’alliance avec Noé, par exemple, Dieu n’engage que lui-même. Il demande à l’humain de ne pas consommer le sang des animaux, mais le texte ne parle pas de rétribution. Au Sinaï, tout change: Dieu se constitue un peuple partenaire qui reçoit une Loi et s’engage à la respecter. Dans ce sens, l’Alliance avec Israël comporte une dimension conditionnelle. On peut parler d’un «régime de la Loi».
Bien sûr, cette dimension est soutenue et portée par une autre, plus fondamentale, un régime inconditionnel de gratuité. Ainsi, quand le peuple est «châtié», par exemple par l’Exil, les prophètes proclament que Dieu pardonnera, car son amour est inconditionnel et recouvre toutes les trahisons de son partenaire.
Et cela change avec le Nouveau Testament?
Le ministère de Jésus relativise la dimension conditionnelle portée par la Loi. Jésus refonde consciemment l’Alliance entre Dieu et l’humanité à partir de la dimension de gratuité «absolue». C’est la «nouvelle Alliance», prophétisée par Jérémie.
C’est pourquoi Jésus attire les pécheurs et les impurs, des gens disqualifiés par leur incapacité à répondre au jeu de réciprocité de la Loi. Avec Jésus, il s’agit pour l’être humain de recevoir une grâce inconditionnelle, un pardon premier, qui transforme le cœur en profondeur. Pour saint Paul, il s’agit de devenir non plus «un sujet de la Loi» qui est obligé, mais un «sujet de la grâce» qui s’oblige librement en réponse au don gratuit et premier de Dieu. Le contexte de l’Alliance demeure, mais cette Alliance bouge dans le sens d’une reconnaissance et d’un appui plus fort sur la gratuité.
«Jésus refonde consciemment l’Alliance entre Dieu et l’humanité à partir de la dimension de gratuité ‘absolue’».
Le Christ donne sa vie pour racheter le péché des hommes. Ne quitte-on pas la gratuité pour un «donnant-donnant»?
Cette question a fait couler beaucoup d’encre. Pour bien comprendre ce que le Nouveau Testament veut dire avec les mots de «rançon» ou de «sacrifice», une génération de théologiens a effectué depuis les années 1950 un travail assez similaire à ce que font les restaurateurs de tableaux anciens quand ils enlèvent les couches de vernis et de suie qui masquent les couleurs originelles.
En effet, l’idée que la mort du Christ serait le prix réglé par le Fils à la justice d’un Dieu offensé qui avait besoin d’un paiement exorbitant pour «effacer son courroux» s’est construit à partir du Moyen-âge, mais n’est pas biblique. Cette théologie de la substitution a été condamnée par le Saint Office. La mort de Jésus est à comprendre sous le signe de la gratuité, d’un don en plus qui fait écho à la folle bonté de Dieu. Sur la croix, Jésus révèle à la fois la profondeur du péché des hommes et la bonté de Dieu qui aime et pardonne, dans l’espoir que l’humanité reprenne le chemin de la bonté.
«La mort de Jésus est à comprendre sous le signe de la gratuité, d’un don en plus qui fait écho à la folle bonté de Dieu.»
Alors les «endettés» reconnaissent le don suprême reçu et cela les stimule à donner…
Pour les sociologues l’endettement comporte un aspect positif dans le cadre des relations d’alliance, la famille, les amis, les réseaux, etc. Être prêt à donner en retour à qui nous a «obligés» sans nous contraindre, fait partie du savoir-faire de toute société. L’Evangile ne contredit pas cela, et y invite. Mais il introduit dans cette «spirale des dons» un acteur supplémentaire, Dieu, qui rendra à ceux qui ont osé un acte de générosité gratuite.
Il y a, dans les Evangiles, un véritable «art du bien donner», afin que les échanges opérés par le don ne tournent pas en rond dans des cercles convenus mais, au contraire, s’élargissent jusqu’à inclure ceux qui ne peuvent pas rendre. A la base de cette aptitude, il y a la capacité à reconnaître que l’on a tout reçu. Le savoir-être chrétien fondamental est un savoir recevoir, à l’image de Jésus qui a pleinement reçu à son baptême la parole de Dieu et l’Esprit Saint, à l’image de Marie qui exulte de la bonté gratuite de Dieu à son égard.
Vous passez, dans votre livre, de la reconnaissance du don à l’engendrement. Comment?
Il existe un lien étroit entre la logique de l’engendrement et celle du don. Tout simplement parce que nos parents nous ont donné la vie. Ils ne nous l’ont pas «vendue». Le parallèle va plus loin. En effet, c’est en recevant des dons et en faisant des dons que le sujet humain «s’engendre», c’est-à-dire accède à sa capacité à dire «je» et à interagir avec les autres.
Nier que quelqu’un puisse donner quelque chose aux autres, c’est déjà commencer à le tuer. Le contrat encadre, mais seul le don engendre. C’est plus risqué, mais c’est le seul moyen pour qu’émergent des sujets capables de dire «je», de bâtir des relations d’interdépendance et un monde habitable. Voilà pourquoi il faut résister à l’envahissement de la logique de l’utilitaire, des «deals» et des négociations, comme ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis en ce moment. (cath.ch/bl)
Jean-Marc Liautaud, En toute gratuité? Penser la grâce sous le paradigme de l’alliance, Ed. Cerf, coll. Cogitatio Fidei
Une invitation au dialogue
Le livre de Jean-Marc Liautaud se donne pour tâche «de saisir le rapport problématique entre gratuité et réciprocité au sein du croire chrétien». Ce travail de réflexion de dix ans fédère des éléments bibliques, pastoraux, missionnaires, et l’apport des sciences humaines.
Originaire du Sud-Est de la France, Jean-Marc Liautaud travaille depuis plus de 35 ans comme permanent du mouvement international Fondacio. Installé à Angers, il participe à l’animation du tiers lieu de l’Esvière, qui promeut l’écologie intégrale chère au pape François. BL