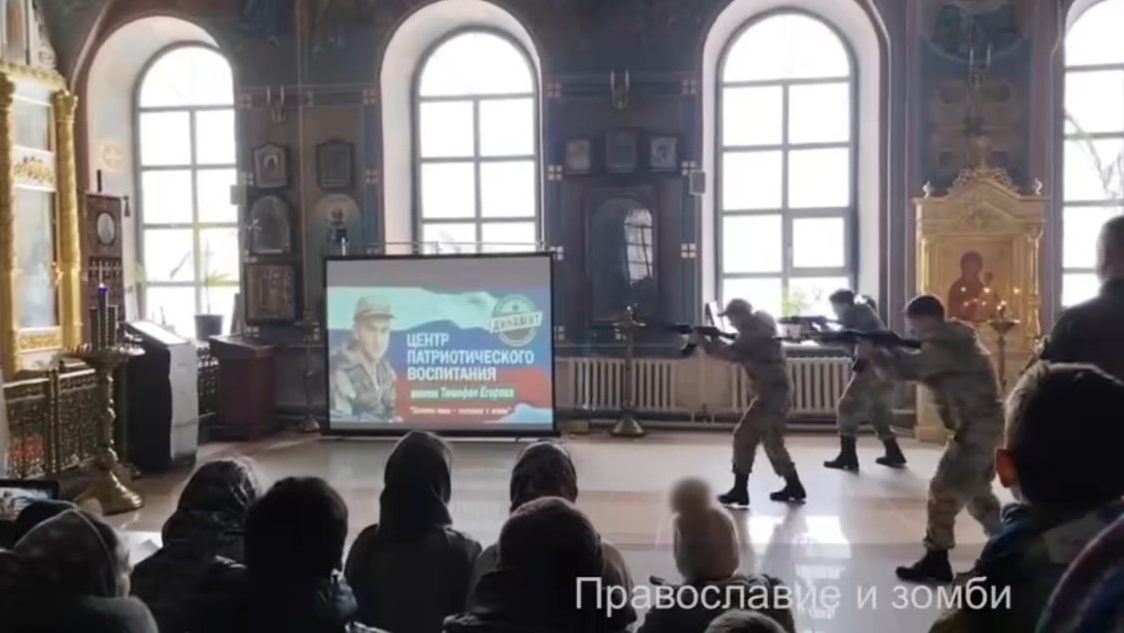Le réarmement est-il le nouveau nom de la Paix? Débat
Si vis pacem, para bellum (Si tu veux la paix, prépare la guerre). Cet adage de l’Antiquité romaine semble à nouveau guider le monde. Politiciens, généraux et médias assènent que la guerre est à nos portes. Comment, en tant que chrétiens, aborder cette dramatique évolution? Débat avec le théologien et éthicien Thomas Wallimann et le prêtre ukrainien Taras Ovsianyk.
Pour faire face à la menace russe, l’Europe, la Suisse et l’Otan misent sur une augmentation massive des budgets de réarmement (voir encadré). Ce bouleversement met-il à mal nos valeurs judéo-chrétiennes? Pour en parler, cath.ch a organisé un débat à Fribourg, dans les locaux de la Conférence des évêques suisses, entre Thomas Wallimann, docteur en théologie et président de la Commission Justice et Paix, et Taras Ovsianyk, prêtre grec-catholique ukrainien, doctorant à la Faculté de théologie de Fribourg. Hasard du calendrier, ou signe de la Providence, la rencontre a eu lieu le 25 septembre 2025, jour de la saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse et de la paix.
Le commandement biblique ‘Tu ne tueras point’ et l’invitation de Jésus à tendre l’autre joue doivent-ils être mis au rencart? Comment, personnellement, vivez-vous cette tension entre ces choix de réarmement et vos valeurs chrétiennes?
Thomas Wallimann (TW): Je vis en Suisse, dans un pays où je me suis longtemps senti en sécurité, loin des conflits armés. Aujourd’hui, ce n’est plus aussi évident. Je me dis que le renforcement de notre armement est nécessaire pour nous défendre en cas d’attaque. En même temps, en tant que théologien, je pense au Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7) et aux Béatitudes, à Jésus qui dit «Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu». Ce message pacifique est au cœur du Nouveau Testament.

Je suis donc divisé. Je suis certes chrétien mais aussi humain. Je vis dans un monde qui n’est pas le Ciel. Sur la Terre, la violence est inhérente. Elle est d’ailleurs inscrite dès le début dans la Bible, avec le meurtre d’Abel par Caïn. Le Nouveau Testament lui-même est rempli d’histoires violentes.
Taras Ovsianyk (TO): Je vis aussi une tension. Je ne suis pas bien placé pour parler objectivement du réarmement de l’Europe. Je suis Ukrainien, donc je suis personnellement touché par la guerre. J’y ai perdu des amis. Je souhaite donc que l’Ukraine puisse se défendre avec des armes. Mais je pourrais aussi en parler en tant que prêtre, chargé d’annoncer l’enseignement de l’Église, en m’appuyant sur la notion de guerre juste et du critère de légitime défense développés par l’Église catholique. Mais je n’en suis pas convaincu. Au fond de mon cœur, je sais que ce ne sont là que des concepts, qu’il n’y a pas de guerre juste, car la guerre se construit toujours sur la violence, sur la haine. Cette haine que je ressens aussi en partie en moi et que j’aimerais évacuer.
Taras Ovsianyk
Ordonné prêtre il y a sept ans en Ukraine, Taras Ovsianyk, 32 ans, assure la charge pastorale des communautés ukrainophones catholiques de rite byzantin à Lausanne et à Bâle. Il poursuit parallèlement un doctorat en exégèse biblique du Nouveau Testament et des écrits intertestamentaires à l’Université de Fribourg. Il a précédemment étudié et vécu en France, en Italie et en Israël.
À vous entendre, on comprend à quel point vivre l’Évangile dans la réalité du monde, est complexe. Faut-il toujours dire non à la violence, même en cas d’injustice patente?
TO: Les Béatitudes ne nous disent pas d’être simplement pacifistes, d’accueillir la paix comme un don de Dieu. Jésus en appelle à notre responsabilité individuelle, il nous demande de devenir des artisans de cette paix. Est-ce que nous pouvons y travailler en évitant toujours le scandale? Jésus lui-même a provoqué le scandale et notre Salut s’est réalisé dans les violences de la croix. Et si la Bible commence, en effet, par un meurtre, elle se termine aussi dans la violence, avec la bataille de l’Apocalypse. En tant que chrétien, nous sommes appelés à nous réaliser dans cette violence. Jésus a apporté la Paix, mais pas celle du monde (cf. Jean 14,27).
Dans Le Léviathan (1651), le philosophe Thomas Hobbes développe la notion de «guerre de chacun contre tous». L’état de nature de l’Homme serait d’être belliqueux. Et la Bible nous dit que ce sera ainsi jusqu’à la fin de l’histoire du monde. Croire en un Dieu maître de l’Histoire, qui mène le monde vers le Bien, adhérer à l’idée de Providence augustinienne peut être consolateur. Mais laisser l’idéal à l’Église et la réalité du terrain aux politiciens, n’est-ce pas se défiler?
TO: La foi est un appel à agir. Laisser faire les autres serait de la paresse. Dieu ne nous appelle pas juste à réparer, mais à créer. Les Églises élargissent le débat, lui donnent de la profondeur et une dimension eschatologique. Elles disent que Dieu ne nous a pas créés pour la violence. Et qu’en tant que chrétiens, nous sommes appelés à diminuer le recours à la violence – je ne dis pas à l’éliminer, car ce ne serait pas prendre en compte la réalité – et à bâtir la paix. Mais nous ne sommes pas appelés à vaincre le mal. Jésus l’a fait.
TW: Pour un chrétien, bâtir la paix est l’objectif supérieur. L’Église doit jouer son rôle prophétique, même si c’est ressenti comme une provocation par des militaires ou des politiciens. Mais elle peut en même temps affirmer que se réarmer n’est pas un mal en soit, quand c’est un moyen d’assurer la sécurité des populations.
La Commission Justice et Paix cherche justement à apporter une réflexion alliant idéalité et réalité du terrain. Comme son nom l’indique, la Justice – associée à la recherche du bien commun et à l’option pour les pauvres – va avec la Paix. Il n’y a pas de paix sans justice, mais il n’y a pas de justice sans une certaine paix.
La paix et un monde sans guerre, est-ce la même chose?
TO: Je ne pense pas. Bâtir la paix, c’est beaucoup plus profond. Et aujourd’hui en Europe, en Israël, ce n’est malheureusement pas l’objectif. Comment parler de désarmement dans ce contexte? Pour nous, Ukrainiens, nous ne pouvons pas parler de Paix sans Justice.
Thomas Wallimann
Auteur d’une thèse à l’Université de Lucerne sur la politique suisse en matière de drogues du point de vue de l’éthique chrétien, et formé en gestion des services, Thomas Wallimann dirige l’Institut d’éthique sociale «ethik22». Il enseigne aussi l’éthique à la Haute école spécialisée de Lucerne, à la Haute école spécialisée bernoise et à la KV Business School de Zurich. Il préside depuis 2013, la Commission épiscopale Justice et Paix. Il est aussi engagé en politique en tant que député Vert au Grand Conseil de Nidwald.
TW: Bâtir la paix, c’est agir de manière à ne pas enflammer les esprits et accepter les différences de compréhension des événements. La tendance en cours, que ce soit en Russie, avec Poutine, ou aux États-Unis dans les cercles de JD Vance, est d’utiliser le message biblique pour justifier le recours à la violence. Cette vision de la loi naturelle et de l’ordre repose sur une conception dévoyée de la Providence, qui légitimerait l’usage du pouvoir pour abattre ses ennemis. Il faut être très attentifs face à cette dérive.
C’est là une réponse simple à la complexité du monde. La guerre, du reste, est toujours une réponse simple. Il y a ›nous’ et il y a les ennemis à abattre. Il n’y a pas de zone grise. Si on veut bâtir la paix, il faut être prêt à écouter l’histoire de l’autre. Cela demande du courage et de la sagesse. C’est aujourd’hui la fête de saint Nicolas de Flüe. On ne sait pas exactement ce qu’il a dit à la Diète de Stans (1481), mais ce qui est sûr, c’est qu’il a appelé les partis à s’écouter mutuellement et que son intervention a évité le déclenchement de nouveaux conflits entre les cantons.
Après la Seconde Guerre mondiale, trois axes majeurs de consolidation de la paix ont été développées (en sus du catéchisme de l’économie libérale): la diplomatie, l’action non-violente, la solidarité sur le plan national et international, avec l’aide l’humanitaire et au développement notamment. Ces trois axes sont aujourd’hui très malmenés. Les évêques devraient-ils les défendre avec plus de conviction?
TW: Le pape François en tout cas n’a cessé de le faire. Dans son encyclique Fratelli tutti, il dit que c’est très difficile de parler de «guerre juste». Selon moi, les évêques en Suisse pourraient donc rappeler avec plus de force au respect du droit international et humanitaire.
L’Église fait partie de la société, elle ne peut être «non politique». Même se taire est une façon de faire de la politique, de dire son accord avec les gens au pouvoir. L’Église ne peut se contenter de messes et de prières. Et elle ne le fait pas d’ailleurs! On le sait peu, mais la Commission Justice et Paix, et donc la Conférence des évêques suisses, a été membre de la Coalition contre les exportations d’armes dans les pays en guerre civile qui a lancé en 2019 l’initiative du même nom.
«Les évêques en Suisse pourraient rappeler avec plus de force au respect du droit international et humanitaire.»
Thomas Wallimann
L’Europe s’est construite sur un idéal de paix. Si celui-ci n’habite plus les peuples, c’est donc un échec?
TO: C’est vrai, un mouvement unique s’est construit en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Les États recherchaient le Bien et on a eu 60 ans sans guerre (entre États, la guerre en ex-Yougoslavie étant considérée comme une guerre civile, ndlr). La réussite économique y est pour beaucoup, mais aussi le fait que l’UE est fille de l’Église, qu’elle s’est bâtie sur les vertus chrétiennes.
Mais aujourd’hui nous devons constater que la solidarité, les droits de l’homme, la dignité, l’ONU, etc. ne fonctionnent pas. Même les dénominations chrétiennes n’affichent pas d’unité et se combattent. Il faut reconnaître nos failles, accepter la défaite du projet de paix en Europe, puis relancer sa construction. Le travail n’est pas fini. Mais je suis assez confiant. Les jeunes sont plus conscients de l’importance de ces enjeux qu’on veut bien le dire.

En Occident, on juge les actions par leur succès. Mais gagner une guerre, cela veut dire quoi, quel est le prix à payer? Ce n’est pas juste que l’Ukraine vive la guerre, mais c’est une réalité à accepter. Crucifier quelqu’un sur la croix, même si c’est un Dieu, ce n’est pas juste, mais on l’a fait. Et c’est par là que le Salut est arrivé. Aujourd’hui, pour trouver la paix, on n’a pas d’autre solution que d’accepter la guerre.
Il faudrait donc passer par là? La traverser?
TO: C’est une question de vocabulaire. Donald Trump parle de «terminer la guerre». Le problème, c’est que nous humains nous ne savons pas finir les guerres. Nous ne nous préparons pas assez à ce qu’exige le rétablissement de la paix: la constitution de tribunaux internationaux, la réintégration des soldats traumatisés…
En Ukraine, les gens ne se posent pas des questions théologiques, ni même politiques. Ils se demandent ce que vont devenir leurs enfants s’ils meurent. Pour eux, 500, 1000 morts, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des tragédies concrètes pour chaque famille concernée et autant d’histoires personnelles. On ne peut pas parler des Ukrainiens ou de l’armée. De la même façon, il n’y a pas de pilule guérisseuse.
En attendant, il faut bien chercher des solutions. Faut-il miser sur le réarmement ou sur la diplomatie?
TO: Il nous faut maîtriser le Mal, et les armes ne sont pas le pire outil. Si vous avez un terroriste dans la ville, vous souhaitez que la police intervienne. Les armes ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, tout dépend de la façon dont nous les utilisons. La recherche d’un bien commun pour l’Europe passe peut-être par le réarmement.
En ce qui concerne la diplomatie, elle exige que les deux bords soient prêts à s’écouter pour rechercher un compromis. Mais quand ce n’est pas le cas?
«En Occident, on juge les actions par leur succès. Mais gagner une guerre, cela veut dire quoi, quel est le prix à payer?»
Taras Ovsianyk
La guerre est en cours, mais on veut déjà réconcilier les peuples. Il faut de la patience, observer ses causes. Ce qui veut dire ne pas fermer les yeux, même si cela se passe ailleurs, à Gaza, au Soudan. Il faut être présent malgré la douleur. Comme Jésus l’a fait. Il n’a pas guéri tous les malades, il n’a pas proclamé l’Évangile partout, mais il a été présent. Et il a formé le peuple et son équipe pour prêcher plus loin.
TW: Je partage cet avis. Nous devons nous exercer à cette présence, et donc faire œuvre de patience et prendre avec nous cette douleur. Aujourd’hui nous sommes à la recherche de solutions immédiates. Le meilleur exemple est donné par Trump. Il n’a jamais appris à attendre. Il dit: «Je veux la paix», donc pour lui il doit y avoir la paix. Mais il faut d’abord penser. Que mettons-nous sous le terme de sécurité? Grâce à quoi pouvons-nous la garantir? Aux gilets pare-balles? aux armes? aux murs? Cela peut être infini… Le ‘toujours plus’ associé aux valeurs du marché n’est pas ‘le mieux’ pour avancer vers la paix. Nous devons faire des choix éthiques et cela demande des sacrifices. (cath.ch/lb)
Hausses des dépenses d’armement
En 2024, les dépenses de défense ont augmenté de 7,4 % à l’échelle mondiale, et même de 17% au sein de l’UE. Pour répondre à la menace russe, celle-ci a adopté ReArm Europe, un plan qui prévoit d’investir 800 milliards d’euros dans l’armement d’ici 2030. En Suisse, en décembre 2024, le Parlement a décidé d’augmenter de quatre milliards de francs le plafond de dépenses pour l’armée pour la période 2025-2028, le faisant ainsi passer à 29,8 milliards. Et il a l’intention d’atteindre l’objectif de 1% du PIB d’ici 2032. Donald Trump, quant à lui, exige que les membres de l’Otan consacrent 5% de leur PIB à la défense. LB