
Homélie du 3 octobre 2021 (Mc 10, 2-16 )
Chanoine Olivier Roduit – Basilique de St-Maurice, VS
Dimanche après dimanche, les lectures bibliques du jour mettent le prédicateur au défi. Que nous disent, à nous et à nos contemporains, ces textes très anciens, souvent très étrangers à notre culture ? Pour ma part, pendant ma méditation, j’essaye de me laisser toucher par un mot ou une phrase que je laisse résonner dans mon cœur. Ce dimanche mon attention a été portée sur ces mots très forts : « la dureté de vos cœurs ». « C’est en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé cette règle ».
A côté de cette dureté, heureusement, il y a aussi ces mots du livre de la Genèse : « ce qui est bon pour l’homme ».
Deux questions m’ont alors interpellé.
Ai-je donc le cœur dur ? et
Qu’est-ce donc qui est bon pour l’homme ?
Ces interrogations me sont peut-être arrivées parce que j’ai été frappé cette semaine par certains propos très durs à propos d’un thème actuel très clivant en lien avec la pandémie qui nous frappe. Pourquoi ce durcissement d’un discours qui en arrive à devenir irrationnel ? Je sais que je m’avance ici sur un terrain glissant et ne vais donc pas aller plus loin.
Comment est mon coeur ?
Je me contenterais de me poser une seule question. Comment est donc mon cœur ? Est-il ouvert et généreux, ou bien se ferme-t-il douloureusement ?
Nous savons bien qu’au fond de nous-mêmes notre cœur a tellement tendance à se fermer, à se durcir, et à porter des jugements sévères sur notre prochain.
Nous sommes hélas marqués par le péché et l’égoïsme.
Mais voici que la Parole de Dieu vient nous interpeller. M’est venu en tête ce verset du psaume 94 que nous chantons surtout au Carême : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ».
Oui, écoutons la voix du Seigneur. Il veut notre bien. Il nous propose ce qui est bon pour l’homme. C’est au fond du cœur que se trouve le meilleur, car Dieu est présent au plus intime de nous-mêmes. Et pour y pénétrer, c’est difficile. Il faut briser une couche d’égoïsme pour trouver le meilleur.
Autrefois, lorsqu’elle faisait sa confiture aux abricots, ma maman utilisait pour la conserver et la protéger une couche de paraffine. Ainsi lorsque le temps était venu de la consommer, il fallait briser cette couche rigide de paraffine pour atteindre cette excellente confiture. Le meilleur est à l’intérieur et, pour l’atteindre, il faut très souvent briser une carapace isolante et très sécurisante.
Laissons-nous rejoindre par le Seigneur
Au moment de faire nos choix, si nous ne savons pas trop bien que décider, laissons-nous rejoindre par le Seigneur. La Lettre aux Hébreux nous le rappelle aujourd’hui : le Seigneur Jésus… « voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ». C’est lui le guide de notre existence où souvent tout est très compliqué pour nous.
Si donc nous nous laissons « aspirer » vers en haut par Jésus, si donc nous acceptons de cheminer vers cette gloire promise, bien des questions, des soucis et des préoccupations vont disparaître.
Un père qui nous prend par la main
Jésus lui-même, dans cet évangile, nous donne le guide du pèlerinage de notre vie. Il s’agit d’accueillir le royaume de Dieu à la manière d’un enfant, car « le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ».
Un enfant sait qu’il n’est pas tout-puissant, qu’il a plein de choses à apprendre, mais aussi qu’il peut compter sur l’amour inconditionnel de ses parents. Dieu est pour nous un père – nous le proclamons si souvent -, un père qui nous guide en nous prenant par la main. Laissons-nous donc conduire en toute confiance.
Pour en revenir à mon interrogation du début de cette méditation, je crois que le message fondamental des lectures de cette messe, est une invitation à la confiance. Comme un enfant fait confiance à ses parents, osons accueillir le royaume de Dieu à la manière d’un enfant. Cela fait tant de bien de vivre comme un enfant. Alors la dureté de notre cœur va fondre, le choix des bonnes solutions va s’imposer naturellement et nous parviendrons à la gloire promise par Jésus.
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Genèse 2, 18-24; Psaume 127, 1-2, 3, 4-6: Hébreux 2, 9-11; Marc 10, 2-16
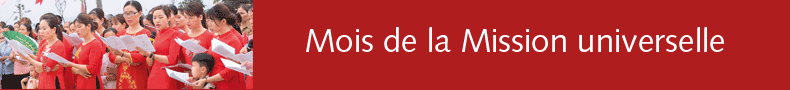
Bannière missio 2021
Un rapport inédit sur la pédocriminalité dans l’Église en France
Des athées américains à la recherche d’un statut « religieux »
Anne-Laure Gausseron témoigne de son engagement en faveur des réfugiés

Homélie du 26 septembre 2021 ( Marc 9, 38-48)
Chanoine Jacques Oeuvray – Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Boncourt
Jésus, heureusement, n’a rien écrit, Chers frères et sœurs. Il ne nous a pas enchaînés, ni sécurisés par un code moral ou des pratiques rituelles. Il nous a laissés un Esprit, un souffle, son Esprit, son souffle, qui ne s’enferme pas, qui ne nous enferme pas mais nous ouvre à tout être humain, au-delà de toutes frontières.
Dans ce qu’on a recueilli de son message, qui n’est autre que sa vie tout entière, on constate que Jésus procède par chocs, éclairs, paradoxes et impulsions et casse ainsi la tentation de faire de lui un Maître et de son enseignement un système.
Ce qu’il dit, ce qu’il accompli, est vitalisant, mais pas pratique : “ Si ta main t’entraîne au péché, coupe-là ! “ Qu’est-ce qu’on peut bien faire avec une telle parole ?
Un être neuf, intact, émerveillé et émerveillant
Pour Jésus, tout homme, toute femme est un être humain. Il s’adresse à lui par-delà les préjugés de race, de famille, de religion, de moralité et travaille à dégager, sous les gangues sociales et les alluvions du passé, l’être neuf, intact, émerveillé et émerveillant que personne n’avait encore réussi à faire naître.
Comme Moïse déjà qui, loin d’être jaloux de voir l’Esprit, ce souffle de Dieu, s’exprimer par d’autres hommes, prie le Seigneur d’envoyer son Esprit sur tout son peuple.
C’est ce que Jésus va accomplir à travers toute sa vie jusqu’au don de lui-même sur la croix. Pour moi, l’essentiel du christianisme tient dans cette foi, ou mieux, dans cette expérience des ressources limitées d’un homme quand il découvre l’amour et le respect de Dieu pour lui à travers l’amour et le respect de l’autre. C’est pour avoir ignoré cela que des régions et des idéologies s’effondrent sous nos yeux.
Des disciples un peu intolérants
Ce passage de l’Évangile de Marc (9, 38-40) rapporte la plainte des disciples contre quelqu’un qui faisait le bien, mais qui n’appartenait pas à leur groupe. « Jésus les corrige : Ne l’en empêchez pas, laissez-lui faire le bien. Les disciples, sans réfléchir, voulaient se refermer autour d’une idée : nous seuls pouvons faire le bien, car nous avons la vérité. Et tous ceux qui n’ont pas la vérité ne peuvent pas faire le bien » nous dit le Pape François. Dans ce cas, « les disciples étaient un peu intolérants », mais « Jésus élargit l’horizon et nous pouvons penser qu’il dit : si celui-ci peut faire le bien, tous peuvent faire le bien ». Voilà pourquoi « nous avons tous le devoir de faire le bien ».
Cela est aussi « une belle route vers la paix ». En effet, si chacun fait sa partie de bien, et le fait à l’égard des autres, « nous nous rencontrons en faisant le bien ». Et ainsi, nous construisons la « culture de la rencontre ; nous en avons tant besoin ». La pandémie actuelle nous a privés de rencontres et nous en souffrons encore !
Faire le bien « est un devoir, est une carte d’identité que notre Père a donnée à tous, car il nous a faits à son image et ressemblance. Et lui fait toujours le bien » nous dit encore le Pape François.
Sauver en nous l’essentiel : la vie
L’évangile de ce dimanche peut nous choquer avec des formules scandaleuses, à l’emporte-pièce. Lorsque Jésus nous dit de couper, d’arracher, de jeter au loin un de nos membres qui nous entraîne au péché, il montre sa volonté, son désir fou, de nous sauver, de sauver en nous l’essentiel : la vie. Car « il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d’être jeté avec tes deux mains dans la géhenne ».
En langage psychologique moderne, nous traduirions ainsi ces formules qui choquent notre esprit : « Ne vous laissez pas envahir par vos pulsions partielles ». Vous le savez par expérience, frères et sœurs : lorsqu’on a mal à une dent, on n’est plus qu’une dent !
Tout nous fait mal. Lorsqu’on est en colère, on est tout entier colère. Certains peuvent devenir tout entier “ argent “ ou “ pouvoir “. Jésus nous dit qu’il vaut mieux couper tout de suite ces tendances, ces pulsions en nous car elles risquent de nous envahir tout entier et de nous étouffer.
Notre foi nous dit que le salut apporté par Jésus n’est pas l’effacement de la dette du péché, mais la reconstruction de tout ce que le péché avait détruit en nous : notre foi et notre amour dans un souffle nouveau.
Et le simple verre d’eau donné à l’un de ces petits, au nom de Jésus, est déjà le début de cette nouvelle construction. Merveilleux appel qui nous déracine ou qu’on étouffe en s’étouffant soi-même.
Après l’avoir rencontré et entendu, on quittait Jésus toujours transpercé par cette lumière sur ce que pouvait être notre vie et sur ce que nous en faisons. Comment allons-nous mettre en œuvre cette parole aujourd’hui dans notre propre vie ? Accueillons le souffle de son Esprit qui nous mettra en mouvement pour vivre pleinement.
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Nombres 11, 25-29; Psaume 188, 8, 10, 12-13, 14; Jacques 5, 1-6; Marc 9, 38-43.45.47-48


