
Bannière DVD messe MB
Le pape François s’attaque aux habitudes alimentaires des personnes en surpoids

Bannière Formation Plus
Les anglicans conservateurs relèguent les femmes en douce

Homélie TV du 13 octobre 2019 (Lc 17, 11-19)
Le Pape François, messe de canonisation – Basilique St-Pierre, Rome
« Ta foi t’a sauvé » (Lc 17, 19). C’est le point d’arrivée de l’Evangile de ce jour qui nous montre le chemin de la foi. Dans ce parcours de foi nous voyons trois étapes, indiquées par les lépreux qui ont été guéris et qui invoquent, marchent et remercient.
D’abord, invoquer. Les lépreux se trouvent dans une condition terrible, non seulement en raison de la maladie qui, répandue encore aujourd’hui, doit être combattue à tout prix, mais aussi en raison de l’exclusion sociale. Au temps de Jésus, ils étaient considérés comme impurs et, comme tels, ils devaient être maintenus à l’écart, isolés (cf. Lv 17, 12). En effet, nous voyons que, lorsqu’ils vont vers Jésus, “ils s’arrêtent à distance” (cf. Lv 17, 12). Mais, bien que leur condition les mette à part, ils invoquent Jésus “à haute voix” (v. 13), dit l’Evangile. Ils ne se laissent pas paralyser par les exclusions des hommes et ils crient vers Dieu qui n’exclut personne. Voilà comment les distances se réduisent, comment on sort de la solitude : non pas en se renfermant en soi-même et dans ses regrets, non pas en pensant aux jugements des autres, mais en invoquant le Seigneur, car le Seigneur écoute le cri de celui qui est seul.
Invoquer le nom de Jésus
Comme ces lépreux, nous aussi, nous avons tous besoin de guérison. Nous avons besoin d’être guéris du manque de confiance en nous-mêmes, en la vie, en l’avenir ; guéris de tant de peurs ; des vices dont nous sommes les esclaves ; de tant de fermetures, dépendances et attachements aux jeux, à l’argent, à la télévision, au téléphone portable, au jugement des autres. Le Seigneur libère et guérit le coeur, si nous l’invoquons, si nous lui disons : “Seigneur, je crois que tu peux me guérir ; guéris-moi de mes fermetures, libère-moi du mal et de la peur, Jésus”. Les lépreux sont les premiers, dans cet Evangile, à invoquer le nom de Jésus. Ensuite, un aveugle et un malfaiteur sur la croix le feront aussi. Les personnes qui sont dans le besoin invoquent le nom de Jésus qui signifie Dieu sauve. Elles appellent Dieu par son nom, directement, spontanément. Appeler quelqu’un par son nom est un signe de confiance, et cela plaît au Seigneur. La foi grandit ainsi, par l’invocation confiante, apportant à Jésus ce que nous sommes, à coeur ouvert, sans cacher nos misères. Invoquons avec confiance, chaque jour, le nom de Jésus : Dieu sauve. Répétons-le : c’est prier. La prière est la porte de la foi, la prière est la médecine du coeur.
La foi devient une route
Marcher est la seconde étape. Dans le court Evangile de ce jour, figure une dizaine de verbes de mouvement. Mais ce qui frappe c’est surtout le fait que les lépreux ne sont pas guéris lorsqu’ils se tiennent devant Jésus, mais après, lorsqu’ils marchent : « En cours de route, ils furent purifiés », dit le texte (v. 14). Ils sont guéris en allant à Jérusalem, c’est-à-dire alors qu’ils affrontent un chemin qui monte. C’est sur le chemin de la vie que l’on est purifié, un chemin qui est souvent en montée, parce qu’il conduit en haut. La foi exige un cheminement, une sortie, elle fait des miracles si nous sortons de nos certitudes commodes, si nous quittons nos ports rassurants, nos nids confortables. La foi grandit avec le don et croît avec le risque. La foi progresse quand nous allons de l’avant, forts de la confiance en Dieu. La foi devient une route avec des pas humbles et concrets, comme humbles et concrets ont été la marche des lépreux et le bain de Naaman dans le Jourdain dans la première lecture (cf. 2R 5, 14-17). Il en est de même pour nous : nous avançons dans la foi par l’amour humble et concret, par la patience quotidienne, en invoquant Jésus et en allant de l’avant.
Il y a un autre aspect intéressant dans le cheminement des lépreux : ils se déplacent ensemble. « Ils furent purifiés » dit l’Evangile (v. 14), toujours au pluriel : croire c’est marcher ensemble, jamais seul. Mais, une fois guéris, neuf s’en vont pour leur propre compte et un seul retourne remercier. Jésus exprime alors toute son amertume : « Les neuf autres, où sont-ils ? » (v. 17). Il semble demander compte des neuf autres au seul qui est retourné. Certes, c’est notre devoir – à nous qui sommes ici à “faire Eucharistie”, c’est-à-dire à remercier – c’est notre devoir de prendre soin de celui qui a cessé de marcher, de celui qui a perdu la route : nous sommes les gardiens des frères qui sont loin. Nous sommes des intercesseurs en leur faveur, nous sommes responsables à leur égard, c’est-à-dire appelés à répondre d’eux, à nous soucier d’eux. Tu veux grandir dans la foi ? Prends soin d’un frère qui est loin, d’une soeur qui est loin.
Invoquer, marcher et remercier : c’est la dernière étape. Jésus dit : « Ta foi t’a sauvé » (v. 19) uniquement à celui qui le remercie. Il n’est pas seulement guéri, il est aussi sauvé. Cela nous dit que le point d’arrivée, ce n’est pas la santé, ce n’est pas le fait d’être bien, mais c’est la rencontre avec Jésus. Le salut, ce n’est pas boire un verre d’eau pour être en forme, c’est aller à la source, qui est Jésus. Lui seul libère du mal et guérit le coeur, seule la rencontre avec lui sauve, rend la vie pleine et belle. Quand on rencontre Jésus, le “merci” nait spontanément, car on découvre la chose la plus importante de la vie : non pas recevoir une grâce ou résoudre un problème, mais embrasser le Seigneur dans la vie.
Vivre en rendant grâce
Il est beau de voir que cet homme guéri, qui était un samaritain, exprime sa joie de tout son être : il loue Dieu à grande voix, il se prosterne, il remercie (cf. vv. 15-16). Le sommet du chemin de foi, c’est de vivre en rendant grâce. Nous pouvons nous demander : nous qui avons la foi, vivons-nous les journées comme un poids à subir ou comme une louange à offrir ? Restons-nous centrés sur nous-mêmes en attendant de demander la prochaine grâce ou bien trouvons-nous notre joie dans l’action de grâce ? Quand nous remercions, le Père est ému et répand sur nous l’Esprit Saint.
Remercier, ce n’est pas une question de politesse, de bienséance, c’est une question de foi. Un coeur qui remercie reste jeune. Dire : “Merci Seigneur” au réveil, pendant la journée, avant de se coucher, c’est l’antidote au vieillissement du coeur. De même en famille, entre les époux : se rappeler de dire merci. Merci est le mot le plus simple et le plus bénéfique.
Etre de « douces lumières »
Invoquer, marcher, remercier. Aujourd’hui, remercions le Seigneur pour les nouveaux Saints qui ont marché dans la foi et que nous invoquons maintenant comme intercesseurs. Trois d’entre eux sont Soeurs et elles nous montrent que la vie religieuse est un chemin d’amour dans les périphéries existentielles du monde. Sainte Marguerite Bays, en revanche, était une couturière et elle montre combien la prière simple est puissante, de même que la patience est endurance et le don de soi, silencieux : à travers ces choses, le Seigneur a fait revivre en elle la splendeur de Pâques. C’est la sainteté dans le quotidien dont parle le saint Cardinal Newman qui a dit : « Le chrétien possède une paix profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas. […] Le chrétien est joyeux, tranquille, bon, aimable, poli, innocent, modeste ; il n’a pas de prétentions, […] son comportement est tellement éloigné de l’ostentation et de la sophistication qu’à première vue on peut facilement le prendre pour une personne ordinaire » (Parochial and Plain Sermons, V,5). Demandons d’être ainsi, de “douces lumières” dans les obscurités du monde. Jésus, « reste avec nous et nous commencerons à briller comme tu brilles, à briller de manière à être une lumière pour les autres » (Meditations on Christian Doctrine, VII,3). Amen !
[Texte original: Italien]

Homélie du 13 octobre 2019 (Lc 17, 11-19)
Chanoine Claude Ducarroz – Ecole des Missions, Le Bouveret (VS)
Il marchait vers Jérusalem où il pressentait que ça allait mal finir pour lui. Il marchait, mais il prenait tout son temps, le temps de croiser des gens, chemin faisant, pour leur annoncer la bonne nouvelle – ce qu’on appelle l’évangile – et pour les guérir de toutes sortes de maladies, selon les besoins de chacun. Le prophète de Nazareth n’était pas seul. Il tirait avec lui une cohorte de disciples – hommes et femmes -, témoins tantôt émerveillés, tantôt déconcertés par sa manière de parler et d’agir. Là, toujours en route, aux confins de la Samarie et de la Galilée.
Mais c’est justement là que Jésus aimait à circuler, à rencontrer les gens, surtout les plus humbles et les plus souffrants, pour leur révéler le visage de son Père qui est aussi le leur, le Dieu d’amour sans barrière et sans frontière.
Le terrain de mission n’était pas des plus faciles. La Samarie, habitée par des juifs dissidents et rebelles qui évitaient de fréquenter ceux de Jérusalem. Et ce n’était pas mieux en Galilée qu’on avait qualifié de « carrefour des païens », tant s’y mélangeaient des cultures et des religions surgies de tous les horizons.
Compassion active
Et aujourd’hui le hasard fait que 10 lépreux vinrent à sa rencontre, autrement dit des malades, mais aussi des exclus, des méprisés, tant il est vrai que plusieurs maladies, y compris sociales et économiques, aggravent encore le pénible destin de ces malheureux.
Et Jésus les guérit, de leur lèpre évidemment, mais aussi de leur exclusion sociale et religieuse, puisqu’ils peuvent aller se présenter chez les prêtres. Il le fait sans autre considération que la compassion active qui jaillit de son cœur touché par leur épreuve.
Il y a un samaritain parmi eux, autrement dit un hérétique peu fréquentable? Qu’à cela ne tienne ! C’est encore lui que Jésus citera en exemple parce qu’il eut, bien plus que les autres, le réflexe de la reconnaissance. Relève-toi, lui dit Jésus – déjà le langage de la résurrection -, ta foi t’a sauvé.
Car la mission de Jésus, et par conséquent celle de l’Eglise aujourd’hui, est toujours la même, encore que les paysages et les contextes soient différents.
Sur les sentiers de la vie ordinaire
Oui, une Eglise en sortie, comme dit le pape François, qui s’avance au milieu des êtres humains tels qu’ils sont, qui les aime avec leurs grandeurs et leurs misères, qui leur annonce une bonne nouvelle de libération et de salut, qui enrobe ses paroles de gestes de compassion et de partage, qui ne met aucune limite ni aux élans de son cœur, ni aux accents de sa parole, ni aux bienvenues dans ses communautés.
La mission est une aventure divine en pleine pâte humaine. L’Eglise – autrement dit tous les chrétiens – marche sur les sentiers de la vie la plus ordinaire. Simplement, nous savons que Jésus nous tient par la main, que son Esprit respire en nous. Et nous avons envie d’inviter à ce pèlerinage d’amour et de liberté tous ceux que nous rencontrons, pour leur joie et pour la nôtre. Une belle mission !
Une paysanne à la rencontre des autres
Quelqu’un a vécu un peu tout cela, et même beaucoup, en arpentant les chemins caillouteux de sa campagne près de Romont, en pays de Fribourg. Une paysanne, célibataire – une vieille fille – comme on dirait encore aujourd’hui. Elle avait les pieds bien sur terre, mais elle marchait surtout à la rencontre des autres, à commencer par les plus petits et les plus nécessiteux, par solidarité humaine, mais aussi par esprit missionnaire.
Car c’est bien cela, l’évangile en actes : visiter les malades, enseigner le catéchisme aux enfants, inviter à la prière en priant beaucoup soi-même, autrement dit aimer Jésus et le faire connaître et aimer, au ras des pâquerettes – elle s’appelait Marguerite. Non pas en accomplissant des choses extraordinaires, mais en distribuant avec charité la petite monnaie des conseils tout en sourire, des invitations tout en respect, des sacrifices de soi tout en gratuité, les yeux et le cœur tournés vers la croix de Jésus ressuscité.
Marguerite Bays est actuellement canonisée à Rome. Elle doit en être très étonnée, et même plutôt gênée. Elle figure en image au fronton de la basilique St-Pierre à côté d’un cardinal anglais, John Henry Newmann, un géant de culture du même siècle qu’elle.
Mais soyons rassurés, Marguerite demeurera toujours la sainte bien de chez nous, pieuse et généreuse, dans la sainteté de la proximité avec les gens simples et au service d’un évangile qui rejoigne les pauvres de toutes sortes.
Avec elle, l’Eglise nous rappelle que la vocation à la sainteté de la vie – autrement dit miser sur la foi et sur l’amour – est à la portée de tout le monde, avec les énergies de l’Esprit du Christ. Car Jésus, avec les saints et saintes d’hier et d’aujourd’hui, en attendant ceux de demain, continue de marcher mystérieusement dans notre monde en nous disant à tous et à chacun : Relève-toi et va ! Ta foi t’a sauvé.
| 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE Lectures bibliques : 2 Rois 5, 14-17; Psaume 97, 1, 2-3ab, 3cd-4; 2 Timothée 2, 8-13; Luc 17, 11-19 |
Fribourg: 25 ans de pastorale de rue
Une beuglante polie contre le patriarcat catholique
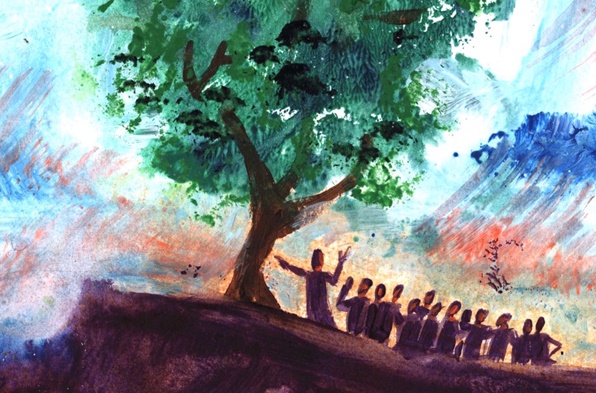
Homélie du 6 octobre 2019 (Lc 17, 5-10)
Chanoine Guy Luisier – Abbaye de Saint-Maurice, VS
Ni Dieu ni maître… proclament les mouvements anarchistes depuis le 19e siècle !
Plus facile à dire qu’à faire. Pas si simple. Libres, oui, mais la prise de conscience de notre liberté passe par une bonne prise de conscience de notre relation avec ce qui nous est supérieur, avec tout ce dont nous dépendons.
L’homme n’a pas beaucoup de choix. Soit il est serviteur, soit il est esclave. Le service ennoblit le serviteur par les qualités que le maître irradie.L’esclavage dégrade l’esclave par les défauts et les violences que maître distille.
Les joies du service
Plutôt que d’insister sur les méfaits des esclavages matériels, psychologiques et spirituels d’aujourd’hui penchons-nous un peu sur les joies, les étonnements et les rayonnements du service.
Mets-toi au service de Dieu et tu te verras grandir dans tes aspirations fondamentales.
C’est un des résumés possibles du message général de Jésus. Mais ce résumé ne reçoit qu’un écho très relatif dans les structures de notre monde occidental, où tout est fait pour que l’homme croie qu’il peut trouver en lui-même ses propres raisons de vivre et d’avancer. Or celles-ci se trouvent toujours dans Celui qui nous a fait et qui est à nos côtés, dans une maîtrise totale de l’univers et de l’histoire.
Dire que Dieu a une maîtrise totale de l’univers et de l’histoire paraît incongru aujourd’hui. Et pourtant on sait bien que dire que l’homme a une quelconque maîtrise de l’univers et de l’histoire est encore plus incongru !
Une relation de simplicité avec ce Maître passionné de nous
Si humblement nous acceptons que Dieu est le Maître et que notre salut est dans une relation de simplicité et de vérité avec ce Maître passionné de nous, alors nous sommes pleinement libres, en voie de plein épanouissement.
J’ai mieux compris le paradoxe de cette attitude lorsqu’on m’a raconté cette jolie anecdote, qui est en fait une parabole :
Un jour un jeune garçon veut rendre service à son père en embellissant le jardin de la famille. Or il y a bien à faire et après la tondeuse, la taille des haies et le soin des fleurs et des légumes, voilà que notre garçon veut déplacer une grosse jardinière en béton pour la mettre dans un autre endroit. Ce n’est pas facile. Le Père qui le voit de loin lui crie : Ce sera difficile mais fais tout ce qui est en ton pouvoir. Alors le jeune s’évertue à pousser et tirer le grand récipient en béton qui ne bouge qu’un petit peu.
Le Père lui crie de nouveau : Fais tout ce qui est en ton pouvoir.
Le jeune va chercher
des planches pour faire levier, des rondelles de bois pour faire glisser mais
c’est toujours l’échec, sous les yeux du Père. Alors humilié le
jeune s’asseoit sur le gazon et pleure.
Le Père s’approche, lui met la main sur les épaules et lui dit doucement.
Je t’ai dit de faire tout ce qui était en ton pouvoir. Il y a quelque chose qui était en ton pouvoir et que tu n’as pas fait, c’est de me demander de t’aider !
Belle leçon, belle histoire, belle parabole de notre relation à Dieu.
Ce monde, c’est ensemble, avec Lui, qui nous devons le transformer. Nos vies, nos relations, c’est ensemble et avec Lui que nous devons les transformer, les bonifier, les embellir et les épanouir.
Or ce n’est pas facile d’avoir une relation simple avec Dieu : Souvent tout se bloque devant nos déceptions de ne pas être à la hauteur : mais qu’est-ce que je dois faire pour arriver au bout de mon service, pour contenter Dieu… La question est fausse et c’est là que se trouve la fine pointe de l’évangile d’aujourd’hui.
De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »
Nous n’avons fait que notre devoir. C’est à–dire nous avons accepté que Dieu est le Seigneur et Maître de ce que nous faisons, de ce qui nous voudrions faire, et aussi de ce que nous n’arrivons pas à faire, pas à bien faire.
Nous sommes de simples serviteurs.
Peut-être savez-vous que les traducteurs ont sué pour trouver l’épithète qui convienne. Il y a cinq possibles : serviteurs inutiles, serviteurs quelconque, serviteur disponibles, serviteurs sans profit et simples serviteurs qui est la traduction que nous propose la liturgie actuelle.
Chaque mot dit quelque chose de juste mais traduit imparfaitement l’idée de Jésus. Ce que Jésus a surtout devant les yeux, c’est la bonté du Maitre souverain qui veut utiliser même des serviteurs sans profit pour lui, si simples et si quelconques, si inutiles finalement face à la grandeur de l’œuvre.
Cette œuvre, son œuvre, c’est de mener à la lumière toutes les parcelles de sa création.
C’est de cela que nous devons être missionnaires. Inlassablement.
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; Psaume 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 ;2 Timothée 1, 6-8.13-14 ; Luc 17, 5-10


