
Un trésor à découvrir d’urgence et à partager
Pascal Corminboeuf juge l’attitude de l’Eglise face à la pédophilie

Abus sexuels: la réforme vient des victimes
2019, l’année où la religion retrouve le pouvoir
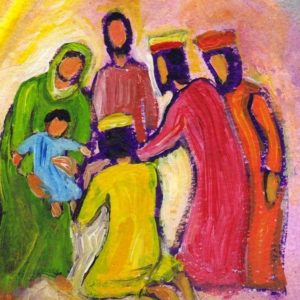
Homélie du 6 janvier 2019 (Mt 2,1-12)
Mgr Jean Scarcella – Basilique de Saint-Maurice
Mes sœurs, mes frères,
Ils sont trois à s’être levés, venant de tous les horizons, et avec eux un peuple entier se lève : « Debout, Jérusalem, resplendis ». Resplendis comme cette étoile qui annonce la lumière qui vient dans le monde pour dissiper les ténèbres, resplendis comme cette étoile qui provoque la joie chez ceux qui se réjouissent, resplendis comme la clarté de l’aurore qui vient de naître pour l’éternité. Resplendis Jérusalem ! Resplendis peuple de Dieu, il est venu ton roi ; sur toi « se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît ». Lève-toi, Jérusalem, relève-toi peuple de Dieu, ton Dieu se lève, sa gloire te met debout ! ». Saint Irénée, évêque de Lyon au IIème siècle le dira : « La gloire de Dieu, c’est l’homme debout ».
« L’homme debout »
Oui, les mages les premiers se sont levés, prémices de tous ceux qui se mettront debout à l’appel de cette gloire de Dieu. Les mages reconnaissent ce que saint Jean écrivait dans le Prologue de son Évangile : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ». (Jn 1, 14)
Jésus apporte la gloire du Père
Mais le premier qui se mettra debout, frères et sœurs, c’est Celui que les mages contemplent dans son berceau en forme de mangeoire, et fait du même bois que la croix. Cet enfant est couché dans la paille, mais un jour il s’étendra sur la croix. La gloire qui rayonne et incendie l’étoile de Bethléem, c’est la gloire du Père que le Fils apporte aux hommes. Petit, emmailloté dans sa crèche, il se mettra debout, parce que sa gloire est celle de son Père qui le précède.
Une anticipation de la vision béatifique
C’est la vision d’Étienne à l’heure de sa lapidation, que saint Luc rapporte dans le Livre des Actes des Apôtres : « Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » (Ac 7, 55-56) « Alors tu verras, écrivait à l’instant le prophète Isaïe que nous venons de lire, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera », tu verras Jérusalem, peuple de Dieu, parce que ton Dieu se révèle à toi. Tu verras celui qui se révèle à toi, comme les mages aujourd’hui voient l’enfant qui étend ses bras pour les accueillir, pour accueillir le peuple entier, pour le salut du monde. Maintenant, explique saint Paul aux Éphésiens, le mystère « a été révélé, dans l’Esprit ». Ce que les mages vivent, frères et sœurs, est comme une anticipation de la vision béatifique, là où la gloire de Dieu met l’Homme debout, le Fils de l’homme et toute l’humanité dans un face à face d’amour échangé, éternel.
Voilà le mystère de l’Épiphanie où Dieu se révèle à l’homme en lui donnant à voir un visage d’enfant, pour qu’avec lui, il parvienne à sa stature définitive. Et cette stature, c’est ”l’homme debout”, c’est-à-dire l’homme sauvé, la stature du Christ qui nous a été promise et que saint Paul exprimait si bien à l’instant : « Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile ».
« Nous sommes fils dans le Fils »
Révélation, promesse, héritage ne sont pas des mots lancés au hasard des vents, non bien sûr, mais ce sont des mots qui doivent signifier une réalité et, pour la signifier, ils doivent s’incarner. Le mystère de Noël c’est l’incarnation du Fils de Dieu en notre chair, et le mystère de l’Épiphanie c’est l’incarnation de l’Église dans le Corps du Christ. C’est ce qui fit dire à saint Irénée, à la suite de saint Paul, que « nous sommes fils dans le Fils », c’est-à-dire fils et filles de Dieu en Jésus le Fils unique, puisque – toujours selon saint Paul – nous sommes adoptés par Dieu le Père par notre incorporation au Christ, lui qui est la tête de ce Corps qu’est l’Église.
Quand nous lisions dans Isaïe tout à l’heure : « Les nations marcheront vers la lumière, […] regarde : tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche », nous comprenons qu’il s’agit du peuple qui se rassemble. Et le peuple rassemblé, vous le savez frères et sœurs, n’est autre que l‘Église, ce peuple qui ensemble fait corps, qui donne une présence humaine continuée du Christ sur cette terre, et qu’on appelle le Corps mystique du Christ : l’Église ! Oui, l’Église, frères et sœurs, l’Église mystère de la révélation de Dieu au monde.
Les mages à Bethléem ont préfiguré, réunis par l’enfant au berceau, le peuple de Dieu, l’Église naissante accomplie par le Fils à la croix, mais toujours en devenir. Et cette Église, frères et sœurs, c’est nous. Nous sommes porteurs de cette réalité parce que nous l’incarnons et que, oui je le redis, nous sommes l’Église.
Nous le savons, c’est par le baptême que nous avons revêtu le Christ, que nous sommes incorporés au Christ, que nous recevons la grâce d’être fils adoptifs du Père et héritiers du Fils. Le mystère de notre filiation divine par le baptême s’apparente à celui de la révélation à l’Épiphanie, et saint Paul nous l’a bien expliqué quand il dit par rapport à ce mystère – et je cite Paul à nouveau ici – : « Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps ». C’est pourquoi comme les rois, contemplons cet enfant qui nous tend les bras, comme il les a écartés sur la croix pour nous ouvrir le passage qui nous conduit dans les bras du Père.
Ainsi soit-il
Fête de l’Épiphanie du Seigneur – Année C
Lectures bibliques : Isaïe 60,1-6; Psaume 71; Éphésiens 3,2-3a.5-6; Matthieu 2,1-12
2019, année Zwingli

Congo: mains tendues
En 2019, Dieu va continuer à régner sur les séries TV



