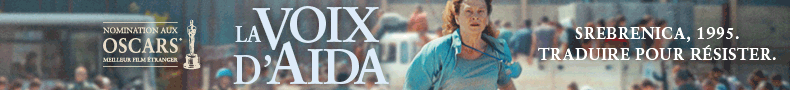Fr. Jean-Michel Poffet, op – Chapelle Saint-Hyacinthe, Fribourg
Croire au Christ : un chemin risqué
Des croyants livrés aux tourments et opprobres, et pour couronner le tout des disciples obtus, attirés par le pouvoir… Chers frères et sœurs, ce dimanche, la Parole de Dieu est particulièrement réaliste, elle nous rejoint au cœur de nos stupeurs, de l’incompréhension, la nôtre face au mystère du Christ ou parfois celle de la société à notre égard.
Des gens non pas à l’abri, mais exposés
La page du livre de la Sagesse est particulièrement impressionnante : elle annonce la persécution des croyants. En effet, la Providence divine nous accompagne, pourtant elle ne fait pas de nous des gens à l’abri, mais des gens exposés. Exposés à la moquerie, parfois à la violence : pas toujours en raison de manquements graves de notre part, – ce qui serait alors justifié -. Mais violence envers qui est droit, qui est juste, qui vit sa foi au plus près de sa conscience et devant Dieu. Le croyant pour peu qu’il ne privatise pas sa foi en la gardant au fond de son cœur, pour peu qu’elle irradie sa manière de vivre, voilà qu’elle le met en tension avec la société, avec ses valeurs – en tout cas avec certaines d’entre elles -, avec ses modes aussi, parfois explicitement avec son rejet de la loi divine inscrite non seulement sur les tables de la Loi mais au creux de la conscience de chacun, pour peu qu’il ne l’ait pas chloroformée.
Et il arrive aux croyants de s’exprimer : après tout nous sommes des citoyens nous aussi avec, jusqu’à plus ample informé, le droit de parole… Or nous le constatons tous les jours : « ça ne passe pas » , ou très mal. « Il nous contrarie », écrit le Sage que nous venons d’entendre, « il s’oppose à nos entreprises et nous reproche de désobéir à la Loi de Dieu ». De fait, c’est même l’aspect prophétique de notre foi. Étrangement, l’opinion publique fustige souvent les silences de l’Église dans le passé face à tel scandale, aux injustices etc. Mais intervient-elle au présent, et elle déchaîne non seulement du scepticisme, mais parfois de la colère, surtout évidemment lorsqu’il s’agit des valeurs d’un monde sécularisé qui ne sont pas toujours celles de l’Évangile, en particulier au plan de la morale.
Mais ce ne sont pas toujours les reproches des croyants qui nous valent la réprobation publique, c’est parfois la simple existence de quelqu’un qui n’est pas dans le courant majoritaire, par conviction religieuse et qui s’y tient. « Tu n’as pas besoin de parler, on sait très bien ce que tu penses… » Je regrette que la traduction liturgique ait omis au cœur du passage lu tout à l’heure quelques versets dont celui-là :
« Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse ; car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d’avoir Dieu pour père. »
Sa seule présence nous pèse… L’auteur du livre de la Sagesse pense d’abord aux Juifs dont le mode de vie était si différent en fait de nourriture, de morale, de fidélité au repos du sabbat etc. Mais cela s’applique maintenant aussi aux chrétiens, à nous, surtout si nous sommes fermes dans notre foi concrètement. Puisqu’ils prétendent avoir Dieu pour Père, eh bien, mettons-les à l’épreuve ! et jusqu’à la mort. On verra bien si ce Dieu qu’ils invoquent viendra à leur secours, viendra à notre secours…
Les violents auraient-ils donc gagné… Où est donc Dieu ?
Mes amis, l’évangéliste saint Matthieu a mis ces mots du Livre de la Sagesse dans la bouche des moqueurs au pied de la croix de Jésus : « Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s’il s’intéresse à lui ! Il a bien dit : Je suis Fils de Dieu ». Or, Jésus va mourir sous les coups de ses bourreaux. Les violents auraient-ils donc gagné… Où donc est Dieu? Terrible question, terrible épreuve pour le croyant, épreuve heureusement éclairée par la résurrection de Jésus, mais elle ne gomme pas le drame du Vendredi Saint. Je lis dans ces propos du Livre de la Sagesse une invitation à ne pas trop nous étonner d’être en butte à de l’incompréhension, voire même à de l’agressivité. Bien des croyants, témoins, et parfois martyrs jusqu’au don de leur vie nous ont précédés sur ce chemin, à la suite de Jésus. Dieu ne préserve pas toujours ses fidèles du mépris, de la persécution ou de la mort, mais il fait fructifier le témoignage des martyrs. Tertullien à la fin du 2e s. écrivait que le sang des martyrs était semence de chrétiens. Et nous le vérifions aujourd’hui là où l’Église est persécutée.
Les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus
L’évangile de ce jour permet de prolonger notre réflexion dans la même ligne : Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il les préparait aux événements de sa Passion. « Le Fils de l’Homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera ». Et saint Marc de noter que les disciples ne comprenaient pas ce langage. Jésus livré,- et il présente cela comme un fait quasiment déjà réalisé – lui le Fils bien-aimé du Père ? Et puis ressusciter des morts ? Tout cela leur paraissait tellement lointain et étrange. Ils avaient même peur de l’interroger.
Cette incompréhension prend même une forme très concrète que, vu les circonstances, j’ose à peine nommer comique : une fois arrivés à la maison, à Capharnaüm, Jésus leur demande de quoi ils discutaient en chemin. Ils se taisaient, comme des potaches, parce qu’ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Sans commentaire. Ce n’est pas seulement qu’ils ne comprenaient pas les mots de Jésus : Fils de l’Homme livré, résurrection, c’est qu’ils n’entraient toujours pas dans la profondeur de l’évangile. Un Dieu qui s’abaisse pour nous rejoindre, nous aimer, nous sauver, et eux rêvaient de s’élever : tout notre monde fonctionne sur ce registre. Oui il y a un abîme entre l’opinion de « Monsieur tout le monde » et l’évangile, lequel nous oblige d’admettre que parfois « Monsieur tout le monde » c’est aussi nous, les croyants, quand nous n’entrons pas vraiment dans la dissidence évangélique. Jésus mais… « décoratif », ou garant de l’ordre social existant. Jésus, mais.. pourvu qu’il nous laisse pieusement tranquilles.
Vivre dans la confiance
En un mot comme en cent : la foi demande du courage, de la ténacité, beaucoup d’humilité aussi, et surtout de la confiance. C’est pourquoi Jésus, pour toucher le cœur des disciples, prend un enfant et place ce môme au milieu d’eux. L’enfant est l’icône de ce qu’il nous propose : vivre dans la confiance. Sans confiance en effet, un enfant ne peut vivre. Sans confiance, nous ne pouvons croire et continuer de croire, quand l’adversité se présente, quand la souffrance d’être incompris est vive, jusque dans nos familles.
Que le Seigneur nous vienne en aide, pour que paisiblement et fermement nous suivions Jésus, lui demandant lumière, courage et endurance, sans dureté mais avec une grande confiance.
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Sagesse 2, 12.17-20; Psaume 53, 3-4, 5, 6.8; Jacques 3, 16–4, 3; Marc 9, 30-37