
Homélie du 18 avril 2021 (Lc 24, 35-48)
Frère Etienne Harant, O.P., Maison Saint-Dominique, Pensier, FR
La double manifestation du Ressuscité
« J’ai revu mon vieil ami Matthieu hier dans la rue, je l’ai à peine reconnu ! » Nous avons sûrement déjà fait cette curieuse expérience, alors que nous avons très bien connu quelqu’un, de ne pas être en mesure de le reconnaître (au sens littéral même de le « connaître à nouveau »), tellement ce dernier semblait avoir changé. Jésus après sa résurrection cherche manifestement à éviter cette situation avec ses disciples. Il se rend présent et identifiable aux apôtres par de multiples moyens, afin qu’ils croient qu’Il a bel et bien vaincu la mort et qu’Il est réellement ce qu’Il prétendait être : le Fils éternel du Père céleste.
Une expérience sensible du Christ
Mais alors, comment s’y prend-il ? L’évangéliste saint Luc nous raconte une double manifestation, en deux temps distincts, mobilisant toutes les capacités d’identification disponibles à l’être humain.
La première étape est une étape sensorielle, ou sensitive. Le Ressuscité se manifeste aux sens. Il parle aux apôtres (« la paix soit avec vous »), Il invite à regarder (« voyez mes mains et mes pieds ») et même à toucher (« touchez-moi, regardez », le verbe employé ici signifie d’ailleurs littéralement « palper », « découvrir en touchant », « faire une investigation par le sens du toucher »). Ainsi les apôtres font une expérience véritablement sensible du Christ réellement, physiquement présent à eux. Je vous invite d’ailleurs à remarquer l’ordre des sens monopolisés : l’ouïe, la vue, et le toucher. Nous allons du plus éloigné au plus proche, du moins assuré au plus certain. Christ se manifeste de manière crescendo, Il s’approche véritablement de ses disciples, même dans la manière de se faire reconnaître, jusqu’à devenir palpable. Il est audible, visible, et palpable. Il ne manquerait plus que les apôtres puissent le sentir et le goûter. Et surprise ! Parce que les disciples n’en reviennent toujours pas, et bien c’est Christ lui-même qui mange ! Ainsi, dans cette première manifestation, les cinq sens sont mobilisés, (partons du principe que si l’on peut toucher quelqu’un, il est aussi possible de le sentir…) plus de doute sensible possible : cet homme vivant n’est pas un esprit, il a un corps, et ce corps permet d’identifier celui qui est mort sur la croix.
Christ se manifeste à l’intelligence des disciples
Mais ce n’était que la première étape. Christ identifié sensiblement, va à présent se manifester à l’intelligence des disciples. Remarquez que cette découverte suit notre mode naturelle de connaissance. Tout ce que notre intelligence connaît, elle le connaît par les sens ! Eh bien Christ se met à dévoiler à l’intelligence de ses apôtres tout ce qui le concernait dans l’Ecriture. Comme pour les disciples d’Emmaüs, il retrace son histoire, l’histoire de son annonce dans l’Histoire Sainte. Christ remédie lui-même à l’ignorance dont Pierre accuse le peuple dans notre première lecture. Vous avez sûrement noté d’ailleurs que ces mêmes disciples d’Emmaüs sont également présents ! Ils auront donc bénéficié deux fois de cette leçon d’exégèse biblique de la part du Verbe, une telle science leur vaut bien le titre de doctor honoris causa de l’Université de Fribourg ! Toujours est-il, on ne connaît rien de cette leçon que donne Jésus aux disciples.
Sens et intelligence sont saisis pour reconnaître que Jésus est bien vivant et qu’Il est le Sauveur annoncé. Ce sont donc toutes les « capacités d’identification » des apôtres qui sont mises à contribution.
Beaucoup « d’indices eucharistiques »
J’attire à présent votre attention sur une troisième révélation du Ressuscité, qui cette fois ne concerne pas tant les apôtres que nous-mêmes. En effet, remarquez que Jésus apparaît au milieu des disciples, dans une pièce close, après que l’on a parlé de lui (qu’il a été « invoqué »), une fois présent il mange, le tout suscité par le récit d’une apparition au cours de laquelle le Christ s’est fait reconnaître à la fraction du pain. Frères et sœurs, cela fait tout de même beaucoup « d’indices eucharistiques », dans un contexte de reconnaissance du Vivant. Et ce nouveau mode de présence du Christ fait à la fois appel aux sens et à la Parole Divine, il est à la jonction des deux. Les sens ne suffisent pas, ils sont débordés par l’Eucharistie, ils sont dépassés par la Parole de Vie qui rend réellement présent le corps et l’âme du Ressuscité. Nous sommes en ce moment même, en célébrant cette eucharistie, unis à tous ceux qui nous écoutent à la radio, dans la même situation que les apôtres : face au Ressuscité, qui se révèle aux sens, soutenus par l’Ecriture. Seulement, pour nous un voile de plus a été déposé sur cette présence vivifiante : celui de la foi.
Alors demandons à celui qui va venir, d’irradier toute notre personne de sa sainte présence afin que toute notre vie en soit transformée, pour que nous puissions vivre un jour enfin, totalement, pleinement, et éternellement en sa présence.
3e DIMANCHE DE PÂQUES
Lectures bibliques : Actes 3, 13-15.17-19; Psaume 4, 2, 4.7, 9; 1 Jean 2, 1-5a; Luc 24, 35-48
Bannière dimanche des médias 2021
Vatican: des canonisations hors de prix
L’idéal de pureté avant mariage se fissure aux Etats-Unis
Des survivants de l’Holocauste utilisent les médias sociaux pour combattre l’antisémitisme

Homélie du 11 avril 2021 (Jn 20, 19-31)
Abbé Michel Demierre -Église Saint-Maurice, Ursy, FR
« Ecoute », entendez bien ce mot, chers amis, pas seulement parce que la radio, ça s’écoute, pas seulement parce que l’Ecoute est le thème de réflexion proposé cette année aux membres de la Vie montante et du Mouvement chrétien des retraités. Les récits de la Résurrection méritent une écoute attentive, même si nous sommes des croyants bien informés au sujet des Evangiles.
Avec l’histoire de Thomas, n’avons-nous pas le sentiment d’être très proches de ces femmes et de ces hommes qui, pour la première fois, furent confrontés au mystère central de la foi chrétienne : la résurrection du Christ. Contrairement à ce que nous pourrions peut-être imaginer, à propos de ceux qui avaient connu et aimé Jésus, il ne fut pas du tout facile de croire.
Saint Marc nous rapporte l’essentiel : « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparaît d’abord à Marie Madeleine…Celle-ci annonce la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient…pas étonnant que lorsqu’un de nos proches décède, nous soyons nous aussi abattus…Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire Marie Madeleine…puis Jésus se manifesta à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. (Mc 16, 9-15) Ils tournaient le dos à Jérusalem. Ils ne supportaient pas qu’après la manifestation d’enthousiasme des Rameaux, la ville était devenue le décor sinistre du vendredi saint.
Vous vous souvenez de cet étranger qui va à leur rencontre sur le chemin d’Emmaüs. Ils le reconnaissent au geste de la fraction du pain, (puis il disparaît à leurs yeux.) Quant à eux, tout retournés, ils reviennent sur leur pas et rapportent aux apôtres leur rencontre.
Dans leur cénacle, les disciples ont eu la visite du Ressuscité. Racontant cette apparition, saint Jean commence par décrire un groupe d’hommes timides et apeurés. Au soir de Pâques, les apôtres ne sont plus que dix, puisque Judas n’est plus là et que Thomas est absent. Les portes sont closes, par peur des juifs. J’en parlais un jour à Jérusalem avec un guide de pèlerinage qui vit là-bas. Les portes closes me disait-il « ce n’est pas pour nous laisser entendre que Jésus aurait traversé les murs, (comme le passe muraille sculpté sur une maison de Montmartre à Paris) mais pour bien nous faire comprendre qu’il ne vient pas du dehors, puisque les portes sont closes, mais qu’il était déjà là, et qu’il est et sera toujours là, comme sur la route vers Emmaüs, qu’ils le voient ou qu’ils ne le voient pas ! » (1)
Faire par soi-même l’expérience du Christ
En leur disant « la paix soit avec vous » le Ressuscité leur fait voir ses mains et son côté. Puis il souffle sur eux : « Prenez l’Esprit Saint. » D’après les exégètes, c’est plus juste de traduire ainsi le mot grec original, car, à la fois, on reçoit l’Esprit, il est donné, encore faut-il le prendre ! (1). Les apôtres en eurent bien besoin pour annoncer à Thomas, de retour parmi eux, ce qui s’était passé. Sous l’emprise d’un doute résolu. Thomas ne dit pas : « ce que vous m’annoncez n’est pas possible ou impensable ». Sa demande est claire : « Je veux voir moi-même ». Si nous avions été à sa place, avec, devant les yeux, l’image du Maître sur la croix, mort après une agonie indescriptible, les mains et les pieds troués et le côté transpercé, qu’elle aurait été notre réaction ? N’est-il pas légitime, en tout temps, de vouloir faire par soi-même l’expérience du Christ ? (1)
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Pour le persuader de l’authenticité de l’apparition de Jésus en son absence, les apôtres tiennent à Thomas une sorte de langage familier : « Ecoute, Thomas, nous sommes là. Dix hommes qui te connaissent. Comment peux-tu penser que nous voulons te tromper ? Nous comprenons ta méfiance, mais nous sommes dix, tes frères, à avoir vécu la même chose. » Et Thomas de leur répondre : « Je ne mets pas en cause votre bonne foi ; je ne dis pas que vous ne l’avez pas vu. Je sens bien que vous croyez l’avoir vu et je sais que vous ne voulez pas me tromper. J’aimerais tenir compte de votre témoignage mais, que voulez-vous, je ne serai sûr qu’à condition de le voir et de le toucher ».
Nous comprenons bien cette exigence de Thomas. Elle est humaine si respectable, et tellement contemporaine… elle peut être la nôtre. Thomas ne veut pas confondre Jésus avec un esprit ou un fantôme quelconque… Jésus est à nouveau présent, l’exigence de Thomas est parvenue à ses oreilles : Il lui déclare, avec une douceur probable : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Remarquez qu’il aurait pu avoir le ton plus dur qu’il eut parfois avec les pharisiens : « Malheur à ceux qui ne croient pas sans avoir vu ! » Il n’en n’est rien.
On nous dit aussi que les apôtres furent remplis de joie… Or la joie est contagieuse, allaient-ils savoir la partager ? C’est là qu’intervient à nouveau le Ressuscité. Il souffle sur eux : ils prennent pour eux cet Esprit qui fait d’eux des témoins.
« Prenez l’Esprit Saint »
Rapidement la communauté chrétienne s’agrandit. Saint Luc nous apprend en effet que les croyants sont devenus de plus en plus nombreux à écouter l’enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Une explication à cet enthousiasme communautaire? Elle se trouve dans le souffle de Jésus qui avait dit : « Prenez l’Esprit Saint ».
« Prenez », à l’origine, le mot est le même que celui qui est employé par le Christ le Jeudi Saint : « Prenez et mangez… Prenez et buvez. » L’Esprit est donné ; encore faut-il prendre ! Tout comme l’Eucharistie qui est donnée, mais que l’on peut ne pas venir prendre…
Nous qui sommes dans cette église d’Ursy en présentiel, vous également, qui êtes à l’écoute d’Espace 2, laissons le Seigneur ressuscité traverser les murailles de nos peurs. Il vient nous saluer avec ses mots : « La paix soit avec vous ! » La pandémie que nous subissons et qui nous déstabilise, implique notre responsabilité de citoyen et de chrétien. Captons notre part du souffle de vie offert par le Christ à ses apôtres, au soir de Pâques. « Mon Seigneur et mon Dieu !» peut se dire en tout temps. Enfin, accordés à ce dimanche de la miséricorde, retenons cette parole pour un temps de Pâques : c’est le vœu d’une femme créatrice d’un mouvement d’Eglise :« Que la passion de faire se rejoindre le Christ ressuscité et notre monde… brûle nos cœurs. »(2) N’est-ce pas, chers amis, la mission des chrétiens ?
(1) d’après J.D. Gullung : Dieu se dit, éd. Écouter la Parole en Terre Sainte
(2) Marguerite Ph. Hoppenot, fondatrice Mouvement « Sève »
2e DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE
Lectures bibliques : Actes 4, 32-35; Psaume 117, 2-4, 16ab-18, 22-24; 1 Jean 5, 1-6; Jesn 20, 19-31
Le gouvernement français s’oppose à la construction d’une mosquée à Strasbourg
Momies, âmes et malédiction
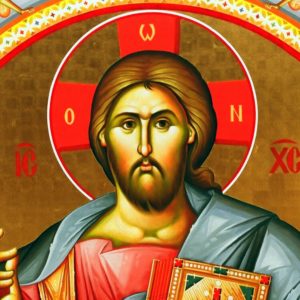
Homélie TV du 4 avril 2021 (Jn 20, 1-9 )
Père Carmelo Andreatta – Chapelle de l’hôpital La Carità de Locarno (TI)
Dans les trois lectures de ce dimanche de Pâques, ce qui frappe, c’est le changement radical d’une histoire humaine, personnelle ou communautaire. Une histoire qui aurait pu retourner dans l’ombre, comme beaucoup d’autres de notre monde : classées et oubliées avec leurs héros.
Les mêmes protagonistes de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus le confesseront par leurs gestes et leurs paroles:
les femmes tristes qui se rendent au tombeau le lendemain du Sabbat pour faire un dernier geste de piété et conclure les rites funéraires ;
Marie de Magdala qui pleure sur la disparition du corps de son Seigneur;
les Apôtres qui, enfermés dans le Cénacle par peur, ne croient pas à l’annonce de la Résurrection, « délire de femmes » – disent-ils – et craignent même ce qu’ils considèrent comme un fantôme (celui de Jésus) qui leur apparaît le soir même.
L’apôtre Thomas qui, pour croire, doit toucher les marques des clous sur le corps du Maître.
Les disciples d’Emmaüs qui, après ces journées cruciales, retournent, inconsolables, de Jérusalem vers leur village, déçus parce qu’en Jésus, mort et enterré, ils voient s’évanouir leurs espoirs de libération d’Israël de la tyrannie.
Même Pierre, qui veut reprendre son ancien métier de pêcheur, sur le lac de Galilée, suivi par quelques apôtres : « Nous aussi, nous venons avec toi ». Presque comme pour dire : « C’était bien pendant le temps que ça a duré.
Maintenant, il ne se passe plus rien, Jésus n’apparaît plus, et nous devons toujours nous débrouiller et continuer à vivre notre vie. »
Et nous pourrions continuer à rappeler des mots, des attitudes, des sentiments, des gestes…
Ce sont aussi les nôtres, frères et sœurs, dans la mesure où nous laissons notre vie prendre le dessus, souvent poussés par nos convictions humaines, par nos prétentions, par nos attentes déçues, voire par nos angoisses, nos peurs, nos illusions ou nos désillusions, par nos moments négatifs.
Puis on se retrouve comme dans une impasse et on fait demi-tour ! Nous retournons à notre vie habituelle.
Que s’est-il passé ces jours-là qui ont littéralement tout remués, chaque situation, chaque cœur, qui ont même redonné de l’énergie à ces corps déçus, de la force et du courage à ces esprits éprouvés et découragés ?
Il est difficile de le dire ! Cependant, nous en percevons les effets sur tous ces premiers témoins.
Se reconnaitre comme témoins de Jésus
Le Cénacle, à Jérusalem s’ouvre, il s’ouvre même totalement, et ce n’est plus la prison de la peur ou des attentes vides de projets, de rêves à réaliser, d’un groupe d’hommes fermés les uns aux autres, incapables de se reconnaître comme des frères, oublieux de tout ce que Jésus avait dit et fait dans l’aventure divine avec Lui.
Maintenant ces mêmes hommes se reconnaissent comme témoins de Jésus, sans plus aucune crainte, et comme un seul corps et une seule âme, ils sortent du Cénacle et, avec force et courage, sans craindre rien ni personne, ils annoncent la résurrection de Jésus, cette même résurrection qu’ils n’avaient pas reconnue les jours précédents.
Ainsi, dans l’Évangile que nous venons d’entendre, nous lisons des verbes desquels émerge la nouveauté qui rafraîchit le cœur et donne des ailes à l’Espérance : Marie-Madeleine se questionne :
« Qui a enlevé la lourde pierre du tombeau ? Où ont-ils mis le Seigneur ? »
Une présence qui est source de vie nouvelle
Et puis, elle court donner des nouvelles aux douze. Pierre et Jean sont particulièrement impliqués dans cette annonce et dans la course qui s’ensuit. Ils sortent, « courant ensemble », pour aller voir. Pierre se penche, entre, voit, constate. Jean voit et croit…
Tous ces verbes qui appellent la nouveauté, la force d’une présence, celle du Ressuscité, que leurs yeux verront et reconnaîtront à la mesure de leur amour pour le Christ, de leur foi en Lui.
Présence qui est source de vie nouvelle et inattendue ; qui libère un dynamisme vital capable de remettre « en mouvement » ce qui semblait éteint ; dans ces hommes et ces femmes germe une vitalité et une énergie qui, dans l’événement extraordinaire, ne peuvent être soutenues par les seules capacités humaines ;
C’est une vigueur qui rend capable d’affronter la vie avec ses succès et ses épreuves, certaines terribles, jusqu’au martyre.
Chercher les réalités d’en haut
Frères et sœurs, nous vivons une époque qui, d’un côté met en lumière toute notre précarité et notre fragilité et de l’autre nous appelle à « laisser sortir », à « faire jaillir» le meilleur de nous-mêmes.
Mais plus encore, elle nous appelle à avoir un regard qui cherche « les réalités d’en haut », comme l’apôtre Paul y invitait les chrétiens de Corinthe, et comme lui-même et les témoins de la Résurrection l’ont fait.
Non pas en s’éloignant de la terre, non ! Ils ont vécu les événements du monde avec la lumière du Ressuscité dans leur cœur et dans leurs yeux. Ils ont su « regarder » la vie et toutes les situations, qu’elles soient heureuses ou tristes, avec les yeux de l’Espérance qui a jailli de la rencontre avec le Ressuscité ;
ils ont su et voulu travailler dans le monde en gardant dans leur cœur les paroles du Maître, en les vivant parce qu’elles sont des « paroles de vie » qui apportent le Ciel sur la terre et la terre au Ciel. Des paroles vécues avec les gestes de la foi, avant d’être proclamés par le son de la voix.
Je ne sais pas comment ils ont vécu leur rencontre avec le Ressuscité, ce qu’ils ont vu et entendu. Il ne nous reste que le témoignage précieux et essentiel des Evangiles. Je sais seulement que leurs vies ont été totalement changées, en prenant un nouveau cours, jusqu’à la fin.
C’est ainsi que nous voulons nous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques, avec un fort désir dans nos cœurs de rencontrer chaque jour le Ressuscité qui vit déjà en nous et qui se manifeste continuellement, avant tout dans sa parole et dans les signes de sa présence, comme l’Eucharistie que sommes en train de célébrer.
Et d’une manière différente mais non moins réelle, il se rend présent dans notre recherche et dans notre amour pour lui dans nos frères et sœurs qui souffrent, dans le désir de fraternité et d’unité qui, aujourd’hui plus que jamais, surgit du monde qui souffre d’une faim d’amour.
Oui, frères et sœurs, « voici le jour que fit le Seigneur, réjouissons-nous et exultons ».
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Lectures bibliques : Actes 10, 34a.37-43; Psaume 117, 1-2, 16-17, 22-23; Colossiens 3, 1-4 ou 1 Corinthiens 5, 6b-8; Jean 20, 1-9 ou Marc 16, 1-7
Version originale (italien)
Nelle tre letture di questa Domenica di Pasqua ciò che colpisce è il cambiamento radicale di una vicenda umana, personale o comunitaria, che si poteva credere destinata a tornare nell’ombra, come tante storie di questo nostro mondo: chiuse e dimenticate assieme ai loro eroi.
Gli stessi protagonisti della passione, morte e risurrezione di Gesù lo confesseranno con i loro atteggiamenti e loro discorsi:
le donne che tristi vanno al sepolcro il giorno dopo il Sabato per compiere un ultimo gesto di pietà e terminare i riti della sepoltura.
Maria di Magdala che piange sulla scomparsa del corpo del suo Signore;
gli Apostoli chiusi nel Cenacolo per paura, che non credono all’annuncio della risurrezione, “vaneggiamento di donne” – dicono – e addirittura temono ciò che considerano un fantasma (quello di Gesù) che appare loro la sera stessa.
L’apostolo Tommaso che per credere ha bisogno di toccare i segni dei chiodi sul corpo del Maestro.
I discepoli di Emmaus che da Gerusalemme, dopo quei giorni cruciali, tornano sconsolati al loro villaggio, delusi perché in Gesù morto e sepolto vedono sfumare le loro attese di liberazione d’Israele dalla tirannia.
Addirittura Pietro che vuol riprendere il suo vecchio mestiere di pescatore, sul lago di Galilea seguito da alcuni apostoli: “Veniamo anche noi con te”. Quasi a dire: “È stato bello finché è durato.
Ora non capita più niente, Gesù non appare più, e noi dobbiamo comunque arrangiarci e continuare a vivere la nostra vita”.
E potremmo continuare ancora a ricordare parole, atteggiamenti, sentimenti, gesti…
Sono anche i nostri, fratelli e sorelle, nella misura in cui lasciamo che abbia il sopravvento la nostra vita, pilotata spesso dai nostri convincimenti umani, dalle nostre pretese, dalle nostre attese deluse, anche dalle nostre angosce, paure, illusioni o disillusioni, dai nostri momenti “no”.
Allora ci ritroviamo come in un vicolo cieco e facciamo dietrofront! Si ritorna alla solita vita.
Cos’è successo quei giorni che ha letteralmente rimesso in moto ogni cosa, ogni situazione, ogni Cuore, addirittura ha ridato energia a quei corpi delusi, forza e coraggio a quelle menti provate e scoraggiate?
È difficile esprimerlo carissimi! Ne vediamo comunque gli effetti su tutti quei primi testimoni.
Il Cenacolo, a Gerusalemme, si apre, si spalanca addirittura, e non è più la prigione della paura o di attese vuote di progetti, di sogni da realizzare, di un gruppo di uomini chiusi gli uni agli altri, incapaci di riconoscersi fratelli, smemorati di tutto ciò che Gesù aveva detto e fatto nella divina avventura con Lui.
Ora questi stessi uomini si riconoscono testimoni di Gesù, senza più paure, e come un corpo solo e un’anima sola, escono dal Cenacolo e con forza e coraggio, senza temere nulla e nessuno, annunciano la risurrezione di Gesù, quella stessa risurrezione che giorni prima non avevano riconosciuto.
E così nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato leggiamo verbi dai quali emerge la novità che rinfranca il Cuore e mette ali alla Speranza:
la Maddalena s’interroga: “Chi ha tolto via la pesante pietra dal sepolcro? Dove hanno posto il Signore?”
E poi corre per dare notizia ai dodici. Si coinvolgono in quest’annuncio e nella conseguente corsa soprattutto Pietro e Giovanni che escono, “corrono insieme” a loro volta per andare a vedere. Pietro si china, entra, vede, costata. Giovanni vede e crede…
Tutti verbi che richiamano la novità, la forza di una “Presenza”, quella del risorto, che i loro occhi vedranno, riconosceranno nella misura del loro amore a Cristo, della loro fede in Lui.
Presenza che è sorgente di vita nuova e insperata, e che sprigiona un dinamismo vitale capace di rimettere “in moto” ciò che sembrava irrimediabilmente spento; in questi uomini e donne germogliano una vitalità e un’energia che, nell’Evento straordinario, non possono sostenersi unicamente con le sole capacità umane;
si tratta di un vigore che rende capaci di affrontare la vita con i suoi successi e le sue prove, talune tremende, fino al martirio.
Carissimi fratelli e sorelle, viviamo un tempo che, se da una parte evidenzia tutta la nostra precarietà e fragilità, dall’altra ci chiama a “lasciare uscire”, a “tirar fuori” il meglio di noi stessi.
Ma ancor più ci richiama ad avere uno sguardo che cerca “le cose di lassù”, come l’apostolo Paolo invitava i Cristiani di Corinto a fare e come lui stesso e i testimoni della risurrezione hanno fatto.
Non estraniandosi dalla terra, no! Loro hanno vissuto gli eventi del mondo con nel cuore e negli occhi la luce del Risorto. Hanno saputo “guardare” alla vita e a tutte le situazioni, liete o tristi con gli occhi della Speranza scaturita dall’incontro col Risorto;
hanno potuto e voluto operare nel mondo custodendo nel cuore le parole del Maestro, vivendole perché “parole di vita” che portano il Cielo in terra e la terra al Cielo. Parole vissute coi gesti della fede prima di essere proclamate col suono della voce.
Non so quindi come abbiano vissuto l’incontro col Risorto, cosa abbiano visto e udito. Ci restano solo le preziose ed essenziali testimonianze dei Vangeli. So soltanto che la loro vita è totalmente cambiata, prendendo un corso nuovo, fino alla fine.
Vogliamo augurarci buona Pasqua così, con nel Cuore il desiderio forte d’incontrare ogni giorno il Risorto che già vive in noi e che si manifesta continuamente anzitutto nella sua parola e nei segni della sua presenza, come l’Eucaristia che stiamo celebrando.
E in diversa misura non meno reale si rende presente nel nostro cercarlo e amarlo nel fratello che soffre, nel desiderio di fraternità e unità che oggi più che mai sale dal mondo che soffre per carestia d’Amore.
Sì, fratelli e sorelle, “questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo”.
don Carmelo Andreatta, arciprete di Locarno


