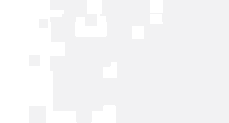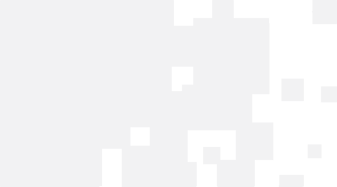Rencontre avec l’écologiste bâlois Bruno Manser, défenseur des Penans du Sarawak
APIC Interview
Quand on coupe la forêt, l’homme se dessèche
Maurice Page, Agence APIC
Fribourg, 9 décembre 1999 (APIC) L’écologiste bâlois Bruno Manser s’est largement fait connaître par ses actions spectaculaires contre la destruction de la forêt pluviale sur l’île de Bornéo. Son but: permettre au peuple Penan de préserver ses moyens d’existence. Son combat est double. Sur place: défendre les droits des indigènes face aux sociétés d’exploitation forestière; en Europe: s’opposer au commerce du bois exotique et exiger au moins une déclaration obligatoire de provenance. Rencontre.
Auteur de plusieurs livres illustrés consacrés au mode de vie des Penans, éditeur d’une revue d’information plurilingue, Bruno Manser est un homme de conviction qui n’hésite pas à interpeller un Occident recroquevillé dans son confort. Sorte de prophète des temps modernes, il défend la non-violence et la primauté de l’être sur l’avoir qu’il a découvertes chez les peuples pour qui la forêt est le tout. «Les cafards aiment leur vie comme nous, les êtres humains, aimons la nôtre», dit un poème penan.
Les Penans vivent dans l’Etat du Sarawak dans le Nord-Est de l’île de Bornéo, qui appartient à la Malaisie Ils sont aujourd’hui environ 9’000 mais seuls 250 d’entre eux sont encore entièrement nomades. Depuis 20 ans, les exploitants forestiers ont détruit 70% de la forêt pluviale du Sarawak. Anéantissant ainsi le milieu de vie des peuples indigènes, la forêt, qui leur fournit leur nourriture quotidienne.
APIC: Votre découverte de la forêt pluviale et des Penans de Bornéo découlait au départ d’une quête existentielle ?
B.M.: A l’âge de trente ans, après avoir passé le baccalauréat et pratiqué divers métiers, j’ai éprouvé le désir de connaître un peuple qui vivait sa propre culture de manière autarcique et sans argent. J’ai commencé à chercher jusqu’à ce qu’une voix intérieure me conduise vers les Penans de Bornéo. En 1984, je suis parti avec un sac à dos, une boussole, un hamac, un couteau, du shampooing et du birchermüesli. Je voulais rester trois ans, mais finalement mon séjour a duré six ans.
Pendant mes années dans la jungle, j’ai utilisé tout ce que les indigènes emploient; pêché avec le filet à lancer; chassé les oiseaux et les bêtes sauvages avec les chiens, le javelot, le fusil, la sarbacane et les fléchettes empoisonnées. J’ai mis cinq ans pour être capable de survivre dans la jungle et j’ai appris à apprêter le sago, la nourriture de base des Penans.
Il a fallu néanmoins me décider à quitter le pays. Diverses organisations et les Penans eux-mêmes m’ont demandé de faire quelque chose pour eux à l’extérieur, c’est ainsi que ma résistance pacifique a commencé.
APIC: Vous gardez la nostalgie de la jungle et vous affirmez volontiers avoir vécu six ans au paradis.
B.M.: Un mythe raconte que la déesse du paradis appelle les Penans à venir manger toute la nourriture qu’elle a préparée avant qu’elle ne se gâte. Mais aucun des Penans ne veut aller au paradis, parce que chacun aime sa vie. Aucun Penan ne veut mourir pour aller au paradis. Avec les Penans, j’ai moi-même vraiment vécu au paradis. Ils m’ont prouvé que l’on peut vivre le paradis dans le présent. Pendant six ans, je n’ai pas vu une seule fois deux Penans se battre, ni même s’insulter. Je n’ai même jamais vu quelqu’un, femme ou homme, être interrompu pendant qu’il parlait. Les Penans ne connaissent pas de hiérarchie, et ne connaissent pas la violence. Pour moins c’est la meilleure preuve de leur profonde spiritualité.
APIC : Abattre les arbres et exploiter la forêt signifie donc détruire tout un mode de vie?
B.M.: Voir les feuilles vertes de la forêt, c’est comme respirer. Quand on coupe cette forêt, les branches sèchent, les fleurs se fanent et l’homme commence à souffrir. Telle est de manière très simplifiée la spiritualité des Penans par rapport à leur milieu de vie. Il faut devenir ce que l’on voit. Cette vision du monde est somme toute assez proche de la règle d’or connue en Occident et dans le christianisme. «Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse». Pour vivre cette spiritualité, il faut mettre en éveil les sens, les yeux, les oreilles, le nez, le toucher. Les Penans n’ont qu’une seule expression pour dire la terre et la forêt. Dans leur tradition, il n’y a rien d’autre que la forêt.
APIC: Votre lutte n’est donc pas seulement écologique, mais aussi spirituelle et culturelle.
B.M.: En Occident, on sépare culture, spiritualité et économie. De telles distinctions n’existent pas chez les peuples animistes où toutes les choses sont liées entre elles. On ne peut pas ainsi séparer la personne de la forêt ou de la terre. Pour les Penans, la forêt, c’est tout. Lieu de vie, de cueillette et de chasse. Le poison dont sont enduites les fléchettes tirées par la sarbacane est fabriqué à partir de la sève d’un arbre. La légende veut que cet arbre soit une très belle femme désirée par tous les hommes. Incapable de se décider pour l’un d’entre eux, elle s’est mise sur la tête, ses cheveux sont devenus des racines, et le poison est le lait de ses seins avec lequel elle nourrit en fait toute la société. Car sans poison, pas de chasse et pas de nourriture. On voit donc bien que tout est lié.
Les Penans mangent tous les animaux de la forêt, surtout les singes, mais ne tuent jamais un animal à qui on a une fois donné à manger. Ce qui est très significatif.
APIC: La survie des peuples de la forêt est menacée non seulement par la destruction de leur milieu vital mais aussi par l’arrivée massive des technologies et des modes de vie occidentaux.
B.M.: Je suis arrivé trop tard au Sarawak pour y découvrir aussi la tradition religieuse, parce les missionnaires australiens y étaient venus bien auparavant. Ils ont fait des feux de joie avec les amulettes et les talismans des peuples indigènes. Aujourd’hui, 95% des Penans sont chrétiens. La plupart d’entre eux sont semi-sédentarisés, leurs enfants vont à l’école et ils se sont mis à l’agriculture. Les missionnaires ne prônent plus un rejet systématique des traditions ancestrales, mais les Penans sont encore regardés par la société comme les plus primitifs qui marchent à pieds nus et qui s’habillent d’un pagne.
La jeunesse, surtout avec la destruction de l’espace vital, fait les mêmes expériences qu’ailleurs avec la radio, la télévision, l’ordinateur, etc. Pour ceux qui sont en ville, le changement est bel et bien là. Ce sont surtout les plus âgés qui n’ont pas besoin de remplacer l’être par l’avoir. Les Penans ne sont pas contre le développement, ni contre l’utilisation des objets de notre civilisation, mais ils veulent protéger leur forêt.
La forêt c’est tout: avec ses feuilles, on peut tout faire, des torches, des toits, des maisons… La forêt, c’est la nourriture avec les palmiers, les légumineuses, les fruits fournis par pas moins d’une centaine d’arbres. La forêt, c’est la médecine aussi. C’est la beauté.
APIC: Le citoyen et le consommateur occidental ne voient guère comment empêcher la destruction de la forêt tropicale, pas seulement au Sarawak, mais aussi en Afrique et en Amazonie.
B.M.: Les bois exotiques tirés des forêts tropicales sont partout dans votre maison. Il suffit de regarder le cadre qui entoure la photo de vos enfants, vos portes, vos manches de balai, vos plinthes, vos chaises de jardin. Le Japon, dont la tradition est pourtant extrêmement attachée à la forêt, consomme en fait près du tiers des bois tropicaux.
APIC: Des alternatives existent pourtant…
B.M.: Nos forêts européennes pourraient largement couvrir nos besoins en bois d’œuvre. Il suffirait d’en avoir la volonté, mais le bois indigène coûte plus cher, ce qui n’est guère logique. Aujourd’hui, il n’y a malheureusement pas de label écologique sérieux pour les bois exotiques. Les labels utilisés actuellement ne sont pas crédibles et trompent les consommateurs. En outre le bois labelisé devrait avoir un prix qui reflète sa juste valeur comprenant à la fois la qualité de la ressource, le travail, l’énergie utilisée et le renouvellement de la ressource. Or ce n’est pas le cas. C’est pourquoi l’utilisation des ressources indigènes est beaucoup plus recommandable.
APIC: Le consommateur a-t-il les moyens de choisir ?
B.M.: Dans un grand magasin, vous pouvez trouver deux pinceaux pratiquement identiques. Le premier coûte 2,80 francs le second 8,40 francs. La différence ? Le manche du premier est en ramin de Malaisie, le second est en hêtre indigène. Mais rien ne l’indique sur l’étiquette. Le consommateur choisit l’article le meilleur marché, c’est normal, mais qui va payer la différence de prix, si ce ne sont les peuples indigènes qui perdent leur espace vital ?
En y regardant de plus près, le consommateur un peu averti peut néanmoins faire la différence à 90% entre un bois indigène et un bois tropical. Par contre, reconnaître l’espèce est beaucoup plus difficile. Seulement en Malaisie, on rencontre 700 espèces d’arbres utilisés commercialement.
En Suisse, 4 cantons et 250 communes ont pris la décision de ne plus utiliser de bois tropicaux dans les constructions publiques. En France, 42 communes ont pris la même décision. De quel droit utilisons-nous des ressources sur lesquelles nous n’avons aucun droit géographique ?
Beaucoup de forêts sont coupées en outre pour être transformées en plantations, par exemple d’huile de palme dont la consommation mondiale a augmenté de 30% en cinq ans. Quand vous achetez de la margarine ou du savon, vous ignorez la plupart du temps que ces produits contiennent de l’huile de palme et que vous contribuez ainsi indirectement à la destruction de la forêt pluviale.
APIC: Ce commerce rapporte tout de même quelques chose aux peuples indigènes.
B.M.: Dans le cas du Sarawak, officiellement 0,6% du profit de la vente doit revenir aux peuples indigènes. Mais en réalité, les populations n’ont rien à dire et n’ont jamais reçu d’argent. Depuis plus de dix ans, ces peuples résistent à la déforestation. Plus de 700 personnes ont déjà été emprisonnées. Et les violences du gouvernement militaire contre la population sont nombreuses. Si les peuples les plus pauvres s’opposent à l’exploitation de la forêt, on ne peut plus parler d’un développement qui devrait aider ces populations. Exploiter des ressources, ce n’est pas du développement mais du business: il faut bien faire la différence!
Le véritable développement suppose que les ressources vont de nos pays vers le tiers monde. Mais avec l’exploitation du bois, c’est exactement le contraire. Quand on dit qu’une des raisons principales de la destruction des forêts est la pauvreté, je ne suis pas d’accord. 99% du bois exploité au Sarawak part pour l’exportation. Sa valeur est de 6 millions de francs suisses par jour !
APIC: Les peuples indigènes n’ont-ils donc aucun droit sur les terres où ils vivent et sur les ressources qu’elles contiennent ?
B.M.: Depuis 1958, les peuples indigènes de Malaisie ont des droits sur leurs terres. Mais cette loi ne leur a donné la propriété des terres que dans les endroits où ils étaient établis avec l’agriculture. Pour les tribus nomades qui vivent dans la forêt, cela ne sert à rien, d’autant plus qu’eux mêmes ne se considèrent pas comme propriétaires de la forêt, mais uniquement comme des gens de passage.
APIC: Au cours des vingt dernières années, ce sont des milliers de kilomètres carrés de forêt pluviale qui ont été définitivement détruits.
B.M.: Les gouvernements des pays civilisés ont tous exprimé leur sympathie pour la lutte contre les injustices. Mais très peu ont eu le courage de prouver leurs intentions par des décisions claires. Au Sarawak, le résultat est pratiquement nul. Quel être humain peut créer un arbre immense de 500 ou 1’000 ans ? Cet arbre, l’homme peut l’abattre en quelques minutes ! Une concession d’exploitation de la forêt pour dix ou vingt ans laisse largement le temps de tout détruire et ces grands arbres auront disparu à jamais. C’est ce qui arrive lorsque des pouvoirs extérieurs prétendent gérer des territoires qui ne sont pas les leurs. Même en pratiquant une gestion sélective, on ouvre la canopée, c’est-à-dire la voûte sommitale de la forêt, et le soleil peut alors assécher le sol permettant ainsi aux incendies de se propager facilement et d’accélérer ainsi la déforestation. (apic/mp)
Mgr Ngabu, président de la Conférence épiscopale du Zaïre (100494)
APIC – Interview
La lente évolution du Zaïre vers la démocratie
Le Synode doit être un souffle de réconciliation pour l’Afrique
Bruxelles, 10avril(APIC) Mgr Faustin Ngabu, évêque de Goma, dans l’est du
Zaïre, et président de la Conférence épiscopale zaïroise, est l’un des
quelque 320 participants de l’assemblée spéciale du Synode des évêques pour
l’Afrique, ouverte à Rome le 10 avril et qui durera jusqu’au 8 mai. A la
veille de cette importante rencontre, il a accordé une interview à l’agence
CIP où il fait le point sur l’évolution de son pays, tout en soulignant son
attente majeure à l’égard du Synode africain.
Question: La situation politique au Zaïre reste très confuse. La volonté de
conciliation qui anime Mgr Monsengwo, en tant que président du Haut Conseil-Parlement de transition, ne va-t-elle pas se révéler moins payante que
l’intransigeance? La recherche de la conciliation ne finit-elle pas par entraîner plus de division dans l’opposition au régime actuel de dictature?
Mgr NGABU: Il n’y a toujours pas de gouvernement de transition à Kinshasa.
Il est donc normal que le Premier ministre Faustin Birindwa, démissionnaire, continue à s’occuper des affaires courantes. En jouant un rôle de médiation et de conciliation, Mgr Monsengwo a montré qu’il n’a jamais abandonné l’objectif que visait la Conférence Nationale Souveraine. Cette Conférence avait été mise sur pied pour réconcilier le peuple zaïrois avec
lui-même, et particulièrement pour réconcilier les forces politiques. Depuis, chacune des forces politiques tente de tirer Mgr Monsengwo de son côté. Heureusement, personne n’y est parvenu.
Au départ, l’unité de l’opposition a pu sembler acquise. Maintenant les
perspectives apparaissent plus diverses. Cette division n’est pas due à Mgr
Monsengwo mais à une différence d’optique quant au changement à promouvoir.
Aux yeux de Mgr Monsengwo – et c’est un point de vue que partagent tous les
évêques du Zaïre -, il n’y aura de changement fondamental dans le pays que
s’il s’accompagne d’une transformation profonde des mentalités pour placer
la recherche du bien commun au-dessus de l’intérêt personnel. Pour divers
hommes politiques, le changement se réduit, hélàs, à un simple remplacement
des dirigeants: «Ote-toi de là que je m’y mette !»
Question: Qui Mgr Monsengwo représente-t-il aujourd’hui? La Conférence Nationale? L’Eglise catholique? L’épiscopat?
Mgr NGABU: Mgr Monsengwo n’a cessé d’incarner la préoccupation de l’Eglise
sans être son porte-parole officiel, ni le délégué de l’épiscopat pour la
mission qui est la sienne à la présidence du Haut Conseil – Parlement de
transition. Cette mission est un service que l’archevêque de Kisangani rend
au pays, en tant que citoyen, et avec le souci évident de rester cohérent
avec son ministère d’évêque. Sans que nous l’ayons délégué à cette tâche,
nous, les autres évêques, nous sommes moralement en communion avec lui.
Le rôle de médiation qu’assume Mgr Monsengwo est loin, par ailleurs, de
résumer la mission de l’Eglise dans la société zaïroise. Car l’Eglise n’a
pas qu’un rôle de médiation. Relisez nos déclarations épiscopales et vous
verrez que nous n’hésitons pas à stigmatiser la situation d’extrême pauvreté et d’oppression où nos dirigeants ont conduit notre peuple. Ces déclarations expriment, en fait, tout haut ce que le peuple pense tout bas. Le
peuple n’a aucune peine à y retrouver l’écho de sa propre voix.
Question: Le peuple zaïrois perçoit-il toujours correctement l’action de
l’Eglise catholique?
Mgr NGABU: Souvent les gens ne font pas beaucoup de différence entre Mgr
Monsengwo, l’épiscopat dans son ensemble et l’Eglise en général. Aussi
s’étonnent-ils quelquefois que la conférence épiscopale n’élève pas la voix
pour dénoncer telle ou telle situation. Mais les évêques ne peuvent prendre
position à tout bout de champ sur une situation où il n’y a pas d’élément
nouveau. Le peuple aussi a ses responsabilités. A chacun de prendre les
siennes sur le terrain, en tirant parti notamment des orientations déjà
données par les évêques.
Un important travail d’éducation doit donc se poursuivre au sein du peuple, entre autres dans les communautés chrétiennes, si l’on veut promouvoir
un sens plus aigu du bien commun. De plus, l’Eglise veille énormément à
éduquer la sensibilité des chrétiens à la non violence. Car plus la situation se dégrade, plus la violence est tentante. Heureusement, beaucoup sont
conscients que l’option pour la révolte ne les amènerait à rien.
Question: La période de transition politique ne va-t-elle pas s’éterniser?
Mgr NGABU: La Constitution prévoit, pour cette période de transition, que
le nouveau Premier ministre doit être désigné par les forces politiques en
présence. A elles de s’entendre. Dès qu’elles auront entamé leur concertation à cette fin, elles auront dix jours pour aboutir. Sinon, c’est au Parlement qu’il reviendra de prendre les choses pour élire un Premier ministre
parmi les candidats présentés par la force politique autre que celle à laquelle appartient le chef de l’Etat. Cette formule a été mise au point pour
éviter de trop personnaliser la fonction du Premier ministre. A l’opposition de démontrer sa maturité, en présentant un candidat qui sera apprécié
par l’autre force politique.
Question: L’Eglise catholique semble avoir repris en mains un certain nombre d’écoles au Zaïre. Cela ne risque-t-il pas de mettre à mal le système
même de l’éducation nationale?
Mgr NGABU: La Convention de gestion des établissements d’enseignement, signée en 1977 entre les représentants de l’Eglise et de l’Etat zaïrois, stipule que l’Eglise peut reprendre ses activités dans le cadre de l’éducation
de la jeunesse. Depuis cette convention, l’Eglise a cessé d’être le pouvoir
organisateur d’une école quelconque, mais elle continue d’être gestionnaire
de nombreuses écoles.
L’aggravation de la situation économique n’a pas changé la position de
l’Eglise en la matière. Elle s’est simplement préoccupée davantage du salaire des enseignants. Aujourd’hui, au Zaïre, le salaire minimum d’un enseignant est de 7 nouveaux zaïres, ou 1/20e de dollar. Quel enseignant
pourrait vivre avec cette somme? L’Eglise a donc encouragé les comités de
parents à cotiser pour donner aux enseignants une prime supplémentaire,
évaluée en dollars et parfois distribuée en vivres. Ceci a permis de remobiliser des enseignants et de rouvrir des écoles.
Il est possible que l’Eglise accepte un jour de jouer à nouveau un rôle
de pouvoir organisateur dans l’enseignement, mais à la condition que l’Etat
assume réellement le rôle qui lui revient: celui de fournir aux écoles les
ressources suffisantes pour exister. Non seulement l’Eglise n’a pas les
moyens de subsidier elle-même un réseau d’écoles libres, mais l’éducation
doit rester d’abord de la responsabilité de l’Etat.
Question: La situation matérielle de l’Eglise au Zaïre ne doit pas être
brillante? Peut-elle encore compter sur la solidarité de ses soeurs aînées
en Europe?
Mgr NGABU: Notre situation matérielle reste précaire. Nous avons pu compter
jusqu’ici sur la solidarité occidentale, mais nos communautés doivent apprendre à se prendre en charge autant que possible. Pendant des décennies,
nos jeunes communautés ont été peu attentives à ce problème dans la mesure
où elles étaient animées par des missionnaires, belges notamment, qui pouvaient facilement faire appel à la solidarité de leurs compatriotes. Aujourd’hui, les missionnaires qui cèdent le relais aux prêtres africains
prennent soin de dire aux communautés locales qu’elles devront demain davantage compter sur elles-mêmes. Et je constate avec plaisir, dans mon diocèse en tout cas, que ce message est bien compris: les communautés locales,
petit à petit, mettent un point d’honneur à veiller à la subsistance de
leurs prêtres.
Actuellement, au Zaïre, nous sommes en train d’évaluer par région les
initiatives déjà mises en oeuvre pour promouvoir dans les communautés une
prise en charge maximale des besoins matériels. La Conférence épiscopale
sera amenée, dans les mois à venir, à donner des orientations précises aux
communautés.
Question: Comment le peuple peut-il tenir bon dans une situation de pauvreté et d’oppression qui n’en finit pas ?
Mgr NGABU: C’est la solidarité interne du peuple qui nourrit son espoir
quotidien. L’animation ecclésiale, et donc la vitalité de la foi, y contribue assurément. Mais l’Eglise n’a pas tous les mérites. L’espoir du peuple
s’enracine aussi dans la solidarité naturelle entre les gens. Il peut arriver que cette solidarité soit prisonnière d’un cadre tribal. Alors, il est
heureux qu’une perspective de foi élargisse ses horizons.
Question: Au cours des dernières années, l’idée d’un Synode et même d’un
Concile africain a trouvé un large écho au Zaïre. Par deux fois, l’épiscopat zaïrois en a fait explicitement la demande au pape. Quelles sont aujourd’hui les attentes des Zaïrois à la veille du Synode?
Mgr NGABU: – L’idée d’un Concile africain n’est pas née au Zaïre, mais dans
le cadre d’une célébration culturelle organisée en Côte d’Ivoire pour
l’Afrique tout entière. Je ne voudrais pas jouer au prophète: le Synode est
un événement qu’il faut laisser à l’Esprit Saint. Mais j’ai perçu, en tout
cas, chez les catholiques zaïrois un désir que le Synode fasse grandir
encore leur amour de l’Eglise. Les Africains savent qu’ils ne peuvent en
attendre un miracle du jour au lendemain. En revanche, ils espèrent du
Synode un encouragement et une impulsion pour l’approfondissement de leur
foi et de leur responsabilité personnelle. Le Synode portera déjà du fruit
s’il permet aux chrétiens d’Afrique de se dire un peu plus: l’Eglise, c’est
nous.
Ce Synode survient à un moment très difficile pour l’Afrique, qui est
aujourd’hui un continent en ébullition. Humainement parlant, on pourrait
s’interroger sur l’opportunité d’une telle rencontre. Mais sous le regard
de la foi, il me semble que le moment ne peut pas être meilleur. Je vois
personnellement le Synode comme un événement capable de susciter, du coeur
de l’Afrique, un immense mouvement de réconciliation. Notre continent est
actuellement déchiré par de multiples divisions et affrontements entre entités tribales et régionales. J’espère que le Synode apportera au moins à
l’Eglise une impulsion nouvelle qui l’aidera à faire oeuvre de réconciliation, à aider chaque peuple africain à se bâtir et à trouver son bonheur.
(apic/cip/mp)