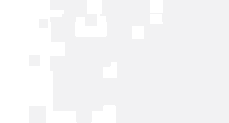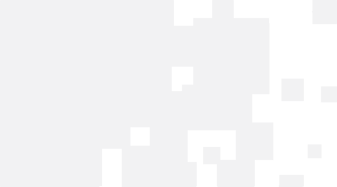Fribourg: Les jeunes de Maranatha, une école de vie sous l’aile du Carmel de Fribourg
Apic reportage
Festival pour la rentrée
Par Samuel Heinzen, Apic
Fribourg, juin 2003 {Apic) Ils sont une quinzaine à se rassembler deux jeudis soirs par mois au couvent des carmes de Fribourg pour prier et partager leur vie de foi. Ils ont entre vingt et trente ans et sont pour la plupart catholiques pratiquants. Pour eux, croire en Dieu, ce n’est pas une simple conviction. Ils le recherchent dans la prière et le vivent dans l’amitié. Ils? Ce sont les jeunes du groupe Maranatha, une équipe hétéroclite et dynamique qui, pour «fêter Dieu», a mis sur pied un festival de jeunesse, prévu chez les carmes en septembre.
Organisé dans le pré du couvent des Carmes au 29 chemin de Montrevers, le festival espère accueillir de nombreuses personnes du 5 au 7 septembre. Au programme: concerts, jeux scéniques, veillée de prière, enseignements, liturgies et partages.
Au nombre des membres d’honneur du comité du festival intitulé «Viens vers le Père», on compte notamment Dominic de Buman, syndic de la ville de Fribourg, Jean Bourgknecht, conseiller communal et président de l’association des Amis des Carmes, ou encore Alain de Reamy, curé de la paroisse du Christ-Roi. Mais qui sont donc ces jeunes, prêts à «déplacer les montagnes» pour célébrer leur foi ? L’Apic les a rencontrés.
Une soirée Maranatha
Un jeudi soir au couvent des Carmes. Une dizaine de jeunes gens et deux Frères carmes se sont retrouvés dans la salle commune. Assis en rond, parterre ou sur une chaise, ils prient, chantent et discutent d’un passage de la Bible. L’Esprit Saint a été choisi pour thème, et Jean-Emmanuel de Ena, le Père prieur, mène la discussion.
Après avoir lu un passage d’Evangile, il lance le débat: «c’est qui, pour toi, l’Esprit Saint?» Les réponses ne tardent pas: «je le prie quand j’ai besoin de conseil», lance Séverine une éducatrice spécialisée de 23 ans. «Il m’aide dans mon travail, surtout dans les situations de crise», confie une infirmière de l’hôpital cantonal. Et la discussion continue, certains sont intarissables, d’autres se contentent d’écouter.
Les témoignages, parfois très personnels, sont ponctués de rires et de petites «vannes» amicales. Des gestes discrets entre un jeune homme et une jeune femme laissent entrevoir bien plus que de l’amitié.
Une école de vie
A les voir prier et parler du Bon Dieu pendant deux heures avec passion et familiarité, on pourrait prendre Maranatha pour un énième groupe de prière, vaguement charismatique. On se tromperait lourdement.
Maranatha n’est pas un groupe de prière, mais une «école de vie», explique le Frère Marie-Pierre, un des carmes qui participent fréquemment aux rencontres. Certes la prière est essentielle pour ces jeunes, mais que représente-te-elle si elle ne porte pas de fruits? C’est pourquoi à Maranatha on cultive l’amitié avec un soin tout particulier. Il ne s’agit pas de prier ensemble pour ensuite «même pas se dire bonjour dans la rue», souligne Samuel, secrétaire du festival en préparation.
Une vision des choses que partage pleinement Noémi. A 31 ans, elle élève seule deux enfants, tout en étudiant la médecine. Pas facile tous les jours. Pour cette jeune mère, qui redécouvre depuis quelques années la foi de son baptême, le groupe Maranatha est «un lieu de partage et d’épanouissement». Convivialité et enracinement spirituel sont les deux raisons principales que donnent ces jeunes pour expliquer leurs motivations.
La spiritualité du Carmel
Séverine est très engagée dans la vie chrétienne. A Fribourg, elle vit à «la Grotte», affiliée à l’Arche, la communauté de vie avec des personnes handicapées fondée par Jean Vanier. Pourtant, cette jeune femme ressent le besoin de venir au groupe pour «approfondir la vie de prière». Une demande à laquelle le Carmel et particulièrement à même de répondre.
En effet, les carmes, en plus des offices communs à tous les religieux, font deux heures quotidiennes d’oraison silencieuse. «En quelque sorte un coeur à coeur avec Dieu», comme ils aiment à le dire. Si les jeunes de Maranatha sont loin de comptabiliser de tels horaires de prière, ils trouvent auprès de ces religieux des grands frères dans la foi, qui ne demandent pas mieux que de partager leur expérience.
Mais pourquoi donc ces jeunes gens sont-ils attirés par le Carmel plus spécialement, alors que les communautés ferventes ne manquent à Fribourg? Avant que Marinka, une collégienne de 20 ans, qui fréquente également les évangélistes, ne découvre le groupe, elle pensait que «tous les catholiques étaient supers coincés». Elle a depuis lors changé d’avis.
Les carmes de Fribourg, des «déchaux», ont une règle de vie fondée sur les enseignements de deux saints espagnols du XVIe siècle, Thérèse d’Avila, dit «la Madre», et Jean de la Croix. La spiritualité qu’ils proposent est toute empreinte du tempérament latin.
Bien que suivant l’une des règles les plus austère de l’Eglise catholique, les carmes considèrent que la joie de vivre sa foi doit s’exprimer à sa juste mesure, à savoir avec un enthousiasme passionné. Les chants et les danses ne sont d’ailleurs pas rares lors des rencontres, et surtout pendant les week-ends organisés par le groupe. Cette spiritualité du Carmel, qui «englobe tous les aspects de la personne», souligne le Frère Marie-Pierre, sait donner des réponses à une jeunesse en recherche d’authenticité.
La diversité: une richesse
Si la majorité des membres et amis de Maranatha sont des universitaires catholiques pratiquants entre 20 et 30 ans, le groupe compte également des personnes d’autres secteurs d’activités. Sans parler des jeunes aux sensibilités de foi très diverses, allant des plus fervents aux plus modérés.
Les membres de Maranatha sont très attachés à leur diversité. Leur différence d’opinion ne va pas sans faire quelques étincelles de temps à autres. Elle est surtout un exercice de tolérance, qui donne corps à la charité chrétienne. En d’autres termes, une disparité synonyme de source d’inspiration et de réflexion intarissable. Pour nourrir l’expérience de vie de chacun. C’est en fait une soif commune de spirituel et le partage de moments de vie qui font l’unité de Maranatha et non une uniformisation des croyances et des comportements. SH
Encadré
D’où vient Maranatha ?
Un après-midi de septembre 2001, des anciens de la Frat, un groupe de jeunes chrétiens né au Collège St-Michel au début des années nonante et aujourd’hui dissout, décident de passer le relais. Le temps faisant son oeuvre, les membres de la Frat ont vieillis et se sont engagés sur des chemins de vie différents, mariages pour certains, vie religieuse pour d’autres. Ayant au fil des années développé des liens avec les carmes de Fribourg, l’idée est assez naturellement venue de proposer aux religieux de développer, dans un esprit de partenariat, un nouveau groupe de jeunes. Cette fois avec un lien au Carmel, beaucoup plus fort. C’est à cette même époque que le Père Jean Joseph Marie Bergara, Provincial d’Avignon- Aquitaine, la province à laquelle est rattaché le couvent fribourgeois, a demandé que les couvents de carmes prennent des initiatives pour mettre sur pieds des groupes de jeunes croyants. La coïncidence était trop belle pour ne pas être saisie et la première rencontre de Maranatha, qui à l’époque ne portait pas encore de nom, a eu lieu le 25 octobre 2001. SH
Encadré
Programme du festival «Viens vers le Père»
Le festival débutera le 5 septembre en début de soirée par des vêpres suivies d’un concert animé par Maranatha et d’une veillée. Le lendemain, la matinée sera principalement consacrée aux enseignements et partages ainsi qu’à la célébration eucharistique. L’après-midi comprendra également un temps d’enseignements et de partages suivi d’un jeu scénique de la Jeunesse franciscaine. La danse et un concert de Pierre Eliane occuperont la soirée. La matinée de dimanche sera consacrée aux enseignements et ateliers. En début d’après-midi le festival se clôturera par une messe animée par le choeur de Prier Témoigner. SH
Encadré
La Frat, l’ancêtre de Maranatha
Dans les rangs de Maranatha, on ne compte plus qu’une minorité d’anciens de la Frat. Le nouveau groupe, qui a maintenant deux ans âge, s’est émancipé de ses initiateurs. Il reste cependant le fruit visible d’un groupe qui, en plus de 10 ans d’existence, a été un témoin de la jeunesse catholique des années nonante.
Fondé en 1992, ses «quatre piliers» étaient le service, le partage, l’enseignement et la prière. Il était composé d’un «noyau» de 15 jeunes et près d’une centaine de sympathisants. Ses rencontres organisées toutes les deux à trois semaines comportaient un repas, des chants, des partages d’expérience de foi et un temps de prière. Elles se poursuivaient en général autour d’un verre, souvent tard dans la nuit, et parfois au rythme de la salsa.
Constitué de manière très informel dès le départ, ce groupe a conservé tout au long de son existence cette flexibilité d’organisation. Flexibilité qui se retrouvait dans l’accueil: aux non pratiquants et même aux non chrétiens. Nombre de ceux ayant passé par la Frat sont aujourd’hui très engagés dans la vie d’Eglise, en tant que laïcs, familles, ou religieux. Cette dispersion des membres à travers l’Eglise est le principal fruit de ce groupe. Nombre d’entre eux estiment que leur expérience à la Frat a été une formation qui a contribué à un passage réussi de la jeunesse à l’âge adulte. SH
Les illustrations de ce reportage peuvent être commandées auprès de l’agence CIRIC, chemin des Mouettes 4, CP 405, CH-1001 Lausanne
Tel.++41 21 613 23 83 Fax. ++41 21 613 23 84 E-Mail: ciric@cath.ch
(apic/sh)
Nicaragua: entre le passé révolutionnaire et les recettes néo-libérales
APIC – REPORTAGE
En attendant 1996 (020693)
Par Sergio Ferrari, pour l’agence APIC
Managua, 3juin(APIC) Trois ans après la défaite électorale des sandinistes et l’arrivée au pouvoir de la présidente Violeta Chamorro, dans l’attente aussi des élections de 1996, le Nicaragua s’interroge. Dans un calme
fragile que nombre d’anciens contras n’hésitent pas à rompre à coups d’actions, meurtrières souvent. Partagé entre le passé révolutionnaire sandiniste et les recettes néo-libérales d’aujourd’hui. Désabusé par le chômage
croissant proche de 65%, par la désintégration des services de la santé et
de l’éducation, fleurons de l’action sandiniste dont il ne reste rien ou
presque… Personne aujourd’hui ne doute d’un autre Nicaragua. En mieux,
mais surtout en pire.
Circuler dans Managua relève du cauchemar… avec ses rues engorgées de
véhicules importés ou plutôt rapatriés en compagnie des propriétaires exilés de Miami, avec des milliers de petits laveurs de pare-brise à la recherche d’une petite pièce, avec ses vendeurs de «tout et de rien» qui
s’agglutinent toujours plus nombreux dans la capitale. Mais aussi et surtout avec ses légions d’adultes en quête d’un hypothétique emploi.
Nicaragua d’hier et Nicaragua d’aujourd’hui… accaparé qu’il est par le
problème du manque de travail qui affecte plus de 65% de la population. Et
par l’apparition progressive de la prostitution, phénomène relativement
nouveau dans le pays. Qui touche un nombre impressionnant de jeunes et
d’enfants même parqués le soir venu aux abords des hôtels de la capitale, à
la recherche du client… des rares touristes mais des nombreux «Miamiboys» récemment revenus au pays.
Les illusions perdues
Entre la ville qui regorge de «constructions nouvelles» de carton ou de
tôle, mais aussi de quelques récentes et visibles réalisations, peu nombreuses, pour créer l’illusion d’une chimérique transformation du pays, entre une campagne qui n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’elle était
«avant», les Nicaraguayens pèsent et soupèsent la réalité. Le miracle escompté s’estompe. Les regrets se font par contre tenaces. Et les milliers
de véhicules importés – trois fois plus de voitures en trois ans -, apparence trompeuse d’un renouveau économique, ne parviennent pas à faire oublier que le pays, et en particulier le monde rural, est à moitié paralysé.
Les salaires moyens – pour ceux qui en touchent – n’atteignent que difficilement 60 dollars… Dans l’attente de 96, personne ne croit plus au miracle que du reste ni le gouvernement Chamorro ni la droite pro-américaine ne
sont en mesure de réaliser.
«La situation des campagnes est terrible et la présidente Chamorro n’a
respecté aucune de ses promesses électorales», constate désabusée Maria del
Jesus Oliva, jeune campagnarde de Matagalpa et dirigeante syndicale active.
Nous vivons au régime de la «tortilla», du riz et du sel depuis plusieurs
mois. On ne nous paie plus… Nous n’avons plus de quoi payer». Désillusion, illusions perdues. Son désapointement est aussi celui de ses 91 compagnons de travail, ouvriers dans la finca «Santa Celia». Auparavant propriétée d’Etat, cette exploitation rurale a été rendue à son ancien propriétaire sur la base de la loi sur la reprivatisation. Les employés sont
désormais sans travail. Ils chôment depuis début avril.
Le gouvernement joue avec l’estomac des enfants et des travailleurs,
poursuit Oliva, 38 ans, mère abandonnée avec cinq enfants. «Cette misère
devenue chronique explique pourquoi notre région, située à près de 200 km
de Managua, est aujourd’hui fréquentée par de nombreux «recontras» (ex-contras réarmés), par des «recompas» (sandinistes réarmés pour se défendre des
«recontras»), mais aussi par des bandes de délinquants. Tous pousuivis par
l’armée, La situation est dramatique. L’insécurité est plus grande encore
que par le passé», admet-elle.
Membre de l’association des ouvriers agricoles, coordinatrice de la
«Clinica de la Mujer Rural», Margarita Lopez partage cet avis. En deux ans,
dit-elle, plus de 150 dirigeants de son association ont été emprisonnés.
«Le poids du réajustement appliqué par le gouvernement actuel est largement
supporté par les femmes, même s’il touche tout le monde en général». Selon
Margarita, le salaire quotidien d’un travailleur rural ne dépasse pas 5
cordobas (un dollar = 6 cordobas). On a reprivatisé tout le secteur de la
santé. On est en train d’en faire autant pour l’éducation…. Durant ces
derniers 24 mois, plus de 4’000 fonctionnaires et enseignants de ce ministère ont été licenciés. Quant au panier de la ménagère, calculé à quelque
150 dollars mensuellement, il coûte plusieurs salaires de base mis en commun…»
Le conflit de la terre
Assis sur son nouveau siège au ministère de la Coopération extérieure,
Leonel Teller, un ex-dirigeant de la contra durant huit ans envoyé ces deux
dernières années à Washington pour y occuper un poste important à l’ambassade du Nicaragua, reconnaît l’importance de la crise et tente d’en expliquer les origines. Le grand problème? «La non-clarification du problème de
la propriété, source de tensions, et le manque d’intérêt des secteurs industriels et productifs, qui n’investissent pas en raison du flou juridique
qui prévaut actuellement au Nicaragua, indique le vice-ministre Leonel Teller.
Depuis l’arrivée au pouvoir de la présidente Chamorro, en 1990, deux
thèses s’opposent au sujet de la propriété. Les sandinistes soutiennent que
tout en corrigeant les erreurs commises dans le passé, il convient de respecter les répartitions des terres et des lots de terrain opérées sous
leur régime. La droite et l’extrême droite insistent en revanche sur une
révision totale de la propriété donnée par l’Etat. Une position qui ne va
pas sans préoccuper et alarmer les secteurs populaires, principaux bénéficiaires de ces donations sous forme de répartitions des terres.
Tant que ce problème majeur et de fond ne sera pas résolu, le Nicaragua
continuera à dépendre de la Coopération internationale. «Toute interruption
de celle-ci entraînerait un risque élevé d’une nouvelle guerre civile», affirme le vice-ministre. Selon lui, le climat d’insécurité que vit actuellement le pays justifie «le droit des producteurs à engager entre 20 et 30
hommes en armes pour protéger leurs fincas».
Une année sur trois…
Critiquée à droite et à gauche, la présidente Chamorro se voit malgré
tout créditée d’un certain nombre de réalisations. La plupart obtenues pendant la première année de son mandat: la fin de la guerre; la démobilisation de la contra – même si un nombre encore relativement important reste
actif – la réduction des effectifs de l’armée, de 90’000 à 20’000 hommes,
le contrôle relatif de l’inflation. Reste, c’est vrai, admet Carlos Fernando Chamorro, fils de la présidente et directeur-fondateur de la revue «Barricada», que ces acquis ont été obtenus les premiers 12 mois, et que les 36
suivants ont vu s’accroître les problèmes économiques et les divisions internes. «Le gouvernement essaie maintenant de se placer en interlocuteur
pour favoriser le dialogue entre tous les secteurs».
Un dialogue difficile dans un orage de critiques. Que n’épargne pas Humberto Ortega, chef de l’armée et ancien membre de la direction sandiniste,
dont la démission à ce poste est réclamée à cris et à corps par les milieux
conservateurs du pays et les Etats-Unis. Sans raison, reconnaît le fils de
la présidente: «Le général s’est comporté loyalement à l’égard du gouvernement».
Réconciliation: convergence entre les sandinistes et la présidente
L’étape actuelle n’est assurément pas facile pour la présidente Chamorro. Elle ne l’est pas non plus pour les sandinistes, au pouvoir pendant 11
ans. Le mouvement qui a fait face aux plans destabilisateurs des gouvernements Reagan et Bush, puis à la défaite électorale, se trouve confronté depuis pas mal de temps à une sérieuse remise en question. Sans parler qu’il
existe encore et toujours des milieux qui n’acceptent pas et n’accepteront
jamais l’existence du sandinisme, constate Tomas Borge, unique fondateur
encore vivant du sandinisme et actuel membre de la direction nationale du
mouvement. «Face à l’offensive de l’extrême droite, incarnée par le viceprésident Virgilio Godoy, le député Afredo César et le maire de Managua, le
Front sandiniste a décidé de consolider à différents niveaux son alliance
avec le gouvernement. Ce dernier reconnaissant le Front comme un allié imprescriptible».
«Je crois que la présidente Chamorro est sincèrement en faveur de la réconciliation nationale. Sa façon de voir les choses dans ce domaine coïncide avec la notre. relève Tomas Borge. «Les positions entre elle et nous divergent, certes, mais en matière d’élaboration de plans économiques».
Face à la crise d’identité et des divers courants qui se manifestent en
son sein, le mouvement sandiniste doit se rénover, imaginer d’autres structures et renouveler ses dirigeants pour retrouver sa crédibilité, assure
encore le «commandant» Borge. Un voeu que partage le député sandiniste Sergio Ramirez, ancien vice-président nicaraguayen, le regard déjà tourné vers
1996. «Il faudra aller plus loin dans notre restructuration. Ce qui a été
conçu et pensé jusqu’à présent est insuffisant».
Le principal parti du pays n’échappe certes pas à la crise. Mais que dire du nouveau Nicaragua «néo-libéral» qui se débat dans une crise généralisée. Avec sa légion de chômeurs, qui voient quotidiennement défiler les publicités des grandes marques de voitures japonaises, des appareils les plus
sophistiqués en matière de TV ou autres chaînes hi-fi. Le Nicaragua d’aujourd’hui vante les cigarettes américaines, incite à se restaurer dans les
MacDonalds où autres Pizza Hut qui ont désormais droit de cité. Sans que la
majorité puisse y pénétrer. Mais c’est bien là le moindre mal. (apic/sftraduit et adapté de l’espagnol par Pierre Rottet)