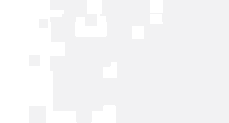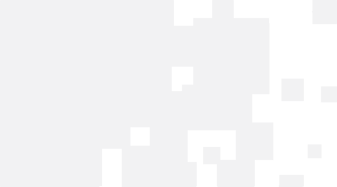Suisse: Art brut en terre catholique
Apic Reportage
Fribourg, terreau de symboles et d’irréel pour un art en marge
Valérie Bory, agence Apic, Fribourg
Lausanne/Châtel St Denis, 28 novembre 2006 (Apic) Le canton de Fribourg est un berceau d’art spontané. A tel point que la Collection de l’art brut à Lausanne prépare une grande exposition consacrée aux créateurs d’art brut fribourgeois. La Maison St- Joseph, à Châtel-St-Denis, a vu fleurir des centaines de peintures inattendues, fruit de l’imaginaire de deux vieillards récemment décédés dans ce home, dont les oeuvres sont aujourd’hui à l’Art brut.
A Châtel-St-Denis, un home médicalisé a eu la chance d’héberger deux pensionnaires, dont le gisement pictural découvert sur le tard, enrichit aujourd’hui la Collection de l’Art brut à Lausanne. Lucienne Peiry, sa conservatrice – fribourgeoise d’origine – avait accueilli avec enthousiasme la donation de la Maison St-Joseph au musée lausannois. La reconnaissance des 2 artistes par la Collection de l’Art brut, institution dédiée à cet art en marge, et de leurs centaines d’oeuvres, a eu lieu en septembre 2005, peu après leur disparition. En outre, Une partie des quelque 400 oeuvres signées Pierrot et Gaston feront l’objet d’une grande exposition consacrée aux artistes fribourgeois de l’art brut, actuellement en préparation, pour 2008.
Pierre Garbani, dit «Pierrot» (1926-2001), tessinois d’origine, venu jeune adulte à Fribourg, et Gaston Savoy (1923-2004), originaire d’Attalens, résidaient tous deux à la Maison St-Joseph, un home pour personnes âgées à Châtel-St-Denis. Un home pas comme les autres, nimbé d’art et, indirectement, de spirituel. Au bout d’une route serpentant dans la campagne, dans la Veveyse, on pénètre dans le vaste corps de bâtiments surplombant une ferme. D’emblée. on tombe sur un groupe de sculptures en terre cuite. Quelques personnages et un bébé dans les bras de sa mère, attablés devant une fondue, et figés la fourchette en l’air comme en un instant d’éternité, témoignent d’un étonnant travail collectif des résidents du home.
On s’est fait traiter de tous les noms quand on a voulu héberger de l’art
Claude Ecoffey, le directeur, qui a imprimé un style tout particulier à cet établissement, parle d’ailleurs d’habitants plutôt que de résidents, de Maison plutôt que d’EMS, et c’est loin d’être juste une façon de dire. «Il y a un esprit et une histoire dans cette maison, qui a été fondée par des religieuses en 1866». Un style différent d’EMS a pu trouver ici son terreau, affirme Claude Ecoffey, initiateur du lieu, avec une poignée d’autres, dont Yves-Alain Repond, le responsable des ateliers créatifs. Ces mordus d’un «social autrement» ont voulu mettre en avant autre chose que des prestations hospitalières et hôtelières pour leurs pensionnaires. «L’un de ces besoins a été de demander aux gens de s’exprimer dans la création. On s’est fait traiter de marginaux et de fous, dans les années 80!».
L’autre pôle a consisté à exposer des artistes fribourgeois normalement accrochés aux musées et galeries. Aujourd’hui, la Maison St-Joseph est certainement la seule où il n’y a pas un mur sans tableau, gravure, dessin, y compris des oeuvres religieuses, comme ce saint Joseph, de Christine Esseiva. Ou ces tableaux d’artistes fribourgeois: Charles Cottet, Pierre Spoeri, Daniel Savary et Jacques Cesa, qui a dédié une oeuvre à la mine de plomb à Gaston Savoy, dont il a découpé une de ses petites vaches rouges pour la mettre dans le coin de son tableau. Claude Ecoffey se souvient de la fierté de Gaston Savoy.
Peindre ou éplucher des patates, c’est tout comme
Lorsque Pierre Garbani, dit Pierrot, est arrivé à St Joseph, c’était encore un hospice, créé au 19è siècle dans une époque de paupérisme, tenu par les soeurs de St Vincent de Paul et où vieillards et enfants cohabitaient parfois.
Pierre Garbani, qu’Yves-Alain Repond a bien connu, était «un personnage touchant, qui ne pouvait pas vivre de manière autonome. Entré à St-Joseph à l’âge de 19 ans, il était très intéressé par la vie des saints et rêvait aussi d’être enterré comme un cistercien, à même la terre. Il repose maintenant .dans le caveau des soeurs St Vincent de Paul, au cimetière de Châtel St Denis». Une sépulture qui peut étonner, mais cet homme retardé était un «innocent» à l’instar de certains personnages de Dostoïevski.
Comme il était au service de la cuisine, «il a pelé pendant des années des tonnes de pommes de terre et il faisait ça comme une prière», se souvient Yves-Alain Repond, qui ajoute: » Je lui avais demandé s’il préférait peindre ou éplucher les patates; il avait répondu: pour moi, c’est pareil, j’aime les deux».
Celui qui est pour beaucoup dans l’émergence de ces deux talents secrets se souvient comme il a été surpris par la force du pinceau de Pierrot. «On allait peindre à l’embouchure du Rhône, on accrochait le papier à peindre contre un tronc, qui servait de chevalet. Pierrot avait mis un magenta, un orange, un vert. et ça faisait une vibration, dans cette forêt pauvre du début de printemps. Il avait saisi l’énergie du lieu. Je me suis dit c’est un hasard. Mais il a continué dans cette veine! Quand il utilisait l’aquarelle, il allait d’instinct d’une couleur à l’autre, il disait que ça lui venait d’ailleurs. C’était un homme qui s’émerveillait de tout». Un homme simple, dont les tableaux font penser au grand artiste abstrait Bram Van Velde.
Gaston Savoy lui, a toujours dessiné, en général sur des bouts de bois. Quand l’atelier s’est créé à la fin des années 80, «c’était quelqu’un d’indomptable», raconte Yves-Alain Repond. «Il avait été gardé dans sa famille à cause d’un retard mental et avait vécu dans des fermes». Arrivé à St-Joseph vers ses 70 ans, il a marqué les esprits par son respect des rituels, religieux, ou plus personnels. Il a peint le plus souvent des séries, séries de vaches, séries de crèches. A la période de Noël, on peut dire qu’il s’identifiait à la crèche. A Pâques il se promenait avec un lapin.Il arrivait souvent que des artistes fribourgeois viennent à St Joseph. Ainsi le peintre animalier Jacques Rime s’était pris d’amitié pour Gaston et pour Pierrot, qu’il considérait comme de véritables artistes. «Ils s’adoraient», raconte Claude Ecoffey.
Actuellement, 20 résidents peignent, dessinent ou malaxent de la pâte, à l’atelier de St-Joseph. Et même ceux qui sont démunis au niveau psychique, ou malvoyants. Tous n’ont pas la force picturale d’un Gaston Savoy ou la rigueur de Pierrot Garbani. Il faut savoir que les critères de l’art brut s’efforcent d’être stricts et précis tant au plan inventif que sur celui de l’anti-académisme. (voir encadré)
Lucienne Peiry: la présence du sacré et de l’irréel dans ces oeuvres
Pour la conservatrice de la Collection de l’Art brut, Lucienne Peiry, «contrairement à un canton protestant comme Vaud, on sait que la présence onirique et symbolique est très importante dans le canton de Fribourg», longtemps resté rural. «Le merveilleux, l’irréel, le sacré, y ont une immense présence depuis l’enfance, chez chaque individu».
Outre Gaston Savoy et Pierre Garbani, auxquels il faut ajouter Lydie Thorimbert, de Romont, cette spécialiste de l’art brut s’est retrouvée face à trois découvertes coup sur coup», explique-t-elle l’oeil bleu, volubile et passionnée. » D’autres personnes encore sont actuellement approchées par la conservatrice. Travail d’approche, en effet, car comme elle le rappelle, il faut toujours longuement préparer les artistes avant de les convaincre. «Ce sont des êtres vulnérables, pas du tout des artistes au sens où on l’entend habituellement. Encore moins des personnes habituées à être en contact avec les journalistes, à parler de leurs oeuvres ou à se mettre en valeur. Ce ne sont pas des personnes qui recherchent la communication», résume-t-elle sobrement.
Lydie Thorimbert (1954-2001) a dessiné la plupart de ses oeuvres pendant les 10 dernières années de sa vie, aux Ateliers de la Glâne, à Romont. 178 de ses dessins font désormais partie de la Collection de l’Art brut. Trisomique, Lydie Thorimbert représentait aussi de thèmes traditionnels comme Pâques, Noël, saint Nicolas, le Père Fouettard. Tout comme chez Gaston Savoy, «cela faisait partie de leur vie quotidienne», commente Lucienne Peiry. «Tout au long de l’année la vie étant réglée par ces fêtes, par les célébrations des saints, sujets que l’on retrouve chez ces artistes, métamorphosés, transfigurés, parfois bricolés .»
Des oeuvres souvent guidées par le surnaturel
Encore une caractéristique de ces faiseurs d’art malgré eux, dont la vie et l’oeuvre, chahutées, sont indissociables: «leurs oeuvres sont faites par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils ne les destinent à personne». La preuve de ce farouche enfermement à l’intérieur de leur art? On les découvre le plus souvent après leur mort.
Lucienne Peiry poursuit: «Ces oeuvres sont parfois inspirées par une entité spirituelle, un défunt, une personnalité décédée. Ils sont guidés par une force suprême, par cet esprit ou par Dieu simplement.» Ainsi l’artiste italien Giovanni Battista Podestà (1895-1976) dont on peut voir quelques oeuvres à l’Art brut – les autres étant disséminées dans différentes collections – affirme être guidé par Dieu. Des Christ en croix, les Dix Commandements de Moïse, l’opposition du Bien et du Mal, la lutte contre le matérialisme, la peur du Jugement dernier sont tous des sujets qui ont inspiré Podestà, personnage hautement original.
Ce natif d’un village de Lombardie, qui passa ensuite sa vie dans une petite ville des bords du Lac Majeur, prophète à ses heures, portait une croix le Vendredi saint, sur les hauts de Laveno. Il ornait tous ses tableaux d’une sentence inspirée de la Bible, inscrite sur de petits panneaux portés par ses personnages, dans une esthétique proche des enluminures du Moyen Age. Ses productions se trouvent dans différentes collections, dont l’Art brut et l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, à Fribourg. Jean Tinguely possédait en effet lui-même une importante collection de l’oeuvre de Podestà, qu’il admirait beaucoup. Pour exprimer la fantaisie et même la fantasmagorie qui caractérise toutes les oeuvres de Podestà, il utilisait volontiers le verbe «tournebouler».
A agender : Exposition de juin à septembre 2008 à la Collection de l’Art brut, sur le thème Fribourg et l’Art brut
Encadré
La Collection de l’Art brut – Un musée imprégné de magie
Fabuleux musée qui vit le jour en 1976 grâce au peintre français Jean Dubuffet, qui fit don de sa collection à la Ville de Lausanne. Celle-ci lui aménagea comme un bel écrin mystérieux le Château de Beaulieu, dont les oeuvres, sculptures, panneaux, tableaux, rouleaux émergent de la pénombre comme d’une grotte des Mille et Une nuits.
L’Art brut est un concept créé par le peintre Jean Dubuffet en 1945 et perpétué par le premier conservateur de la Collection de l’Art brut et musée lausannois, Michel Thévoz. Une oeuvre d’art brut est théoriquement vierge de toute influence académique, et même traditionnelle ou populaire.
Sa grammaire esthétique et technique est originale et personnelle. Le parcours de l’artiste d’art brut est indissociable de la marginalité de son auteur, du caractère désintéressé de sa création. La notion d’art brut repose autant sur des bases esthétiques et sociologiques, résume Lucienne Peiry, la Conservatrice qui a succédé à Michel Thévoz.
Ajoutons que ces artistes ont souvent développé leur art en milieu psychiatrique, mais pas seulement. Ce n’est pas un art de handicapés, même si la Fribourgeoise Lydie Thorimbert était trisomique. Mais il est vrai que la notion d’art brut est devenue moins rigide que dans les premiers temps de son émergence. Ainsi le grand peintre Louis Soutter, né à Morges en 1871, est à la fois un grand artiste de l’art du XXe siècle et un créateur d’art brut. Aloïse, l’une des plus connues des personnages d’art brut, dont les oeuvres, comme celles de Soutter, valent très cher aujourd’hui est, elle, emblématique de l’art brut. Pour Jean Starobinsky, écrivain, médecin et historien de la psychiatrie: «L’art brut naît de la claustration et de l’exclusion». «À côté de malades qui sombraient dans la stérilité catatonique, quelques fleurs secrètes, ici ou là, s’épanouissaient sous les doigts d’Adolf Wölffli, d’Aloïse.» (cité par Lucienne Peiry dans l’une de ses publications). VB
(apic/vb)
Histoire de l’alimentation à travers les siècles
APIC – Reportage
De l’hôpital des religieuses à l’hôpital des médecins
Quand diététique se conjuge avec -sagesse populaire et proverbes
26 mars 1998 Par Pierre Rottet, de l’Agence APIC
Sur un budget global de 210’000 francs, la maternité de Port-Royal, à Paris, a dépensé 22’000 francs pour donner chaque jour à ses patientes un ou deux verres de vin. L’histoire est vraie. Elle se passe en 1828. A une époque où la rubrique alimentation occupait 60% du budget des hôpitaux en France. On ne parlait alors pas d’explosion des coûts de la santé. Retour dans le passé, et clin d’œil à des milliers de proverbes liés à la santé et au corps. A des recettes aussi délicieusement sinon sagement appelées de grand’mère. Reportage.
«La pomme du matin tue le médecin», disait-on naguère, à une époque pas si lointaine où l’on n’était pas avare de proverbes dans les milieux populaires. Sur un corpus de 6’000 proverbes relatifs au corps récoltés à la fin du XIXe siècle, près d’un tiers traite de l’alimentation en relation avec la santé. L’histoire de l’alimentation dans les hôpitaux à travers les siècles n’est pas triste. Que ce soit avec le contenu d’une assiette tour à tour austère, abondant puis médicalisé selon les époques, ou encore en raison des tiraillements, pas très lointains, entre le corps médical et les sœurs hospitalières. Une exposition en retrace les grands moments.
Ce proverbe, parmi d’autres, figure en grandes lettres sur l’un des panneaux de l’exposition que présente ces jours le Musée de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, sur l’»Histoire de l’alimentation à l’hôpital, du XVe au XXe siècle». Et même avant, bien avant, au Moyen Age déjà, à une époque ou les hôpitaux étaient administrés par des communautés monastiques, avant d’être gérés, en France, jusqu’au XVIIIe siècle par les sœurs hospitalières. Soit jusqu’à la publication du décret sur le régime de laïcité pour les hôpitaux. Révolution oblige.
Du Moyen Age au XVIIIe siècle, assure Anne Nardin, Conservateur du Musée, les hôpitaux n’avaient qu’une devise: «Donner à manger à ceux qui ont faim». Dans les établissements administrés par des communautés de sœurs ou de frères hospitaliers, l’alimentation des malades était alors gouvernée par les principes qui fondaient les pratiques alimentaires des religieux. La nourriture devait être à la fois fonctionnelle et spiritualisée: il s’agissait de réparer ses forces et de disposer à nouveau l’individu au service de Dieu. Nourrir les démunis et les malades représentait du reste l’acte de charité par excellence.
Tout chrétien, en principe, et les hospitaliers en particulier, trouvaient dans cet acte l’occasion d’incarner l’attitude chrétienne que réclame d’eux la Bible. Pour Anne Nardin, la distribution du repas prenait dans ce cadre les dimensions d’une cérémonie ritualisée, théâtralisée, qui reprenait à grande échelle, pour les rejouer, les grandes scènes inspiratrices de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Les religieuses remises à l’ordre
Au moyen Age, et pendant longtemps, la nourriture dans les hôpitaux sera austère, mais réparatrice. Parfois réparatrice… car l’observance stricte des prescriptions religieuses, de règle, pour les jours maigres ou encore la période de carême, ne plaidait pas forcément en faveur du malade affaibli. Dans un mémoire présenté en 1756 à l’administration parisienne de l’Hôtel-Dieu, les médecins écrivent: «Il est indispensable que les religieuses veuillent bien s’en rapporter à ce que les médecins prescrivent par rapport au régime».
Il n’est pas rare, les jours de jeûne, qu’un malade se voit privé d’une nourriture adéquate. Mais rien n’est plus ordinaire non plus que les médecins soient obligés de faire retirer des pains distribués à des patients le jour même où «ils doivent être saignés du pied». Il est tout aussi courant que des purgatifs ordonnés ne peuvent être administrés, parce que dès le matin, on a fait boire une soupe très forte et très épaisse à des malades.
Donner au malade ce qu’il réclame
La tradition hippocratique accorde certes une place importante à l’alimentation dans la santé au malade. La diététique qui, au-delà de l’alimentation, englobait «le genre de vie mené» était, chez les grecs déjà une des trois branches fondamentales de la médecine, avec la chirurgie et la pharmacologie. Tempérance et modération étaient alors les maîtres-mots de la prévention au quotidien. Ces principes, redécouverts au XVIe siècle, se diffuseront un siècle plus tard, mais au sein des élites exclusivement. Les classes populaires, elles, continueront à croire au contraire aux vertus protectrices et thérapeutiques d’une alimentation abondante.
A l’austérité du contenu des assiettes héritée du Moyen Age, succédera alors la période de «l’abondance». On n’est pas loin de penser qu’il faut donner au malade ce qu’il réclame. Et d’autant plus si ses jours sont comptés. Dame… il fallait bien contredire une certaine image de l’hôpital. Ne disait-on pas que «la répugnance des malades à aller à l’hôpital vient de ce que le peuple croit qu’on y tue des gens en ne leur donnant pas à manger».
Le règne des gestionnaires
Jusqu’à la fin du XVIIIe, le médecin sera plus toléré qu’admis à l’hôpital. Traduction institutionnelle du principe de charité, l’hôpital chrétien ne fait pas de l’activité de soins sa priorité. Administré par des religieux, doté par des dons et les legs d’un patrimoine propre, il fait certes ponctuellement appel à des médecins, mais refuse de se médicaliser, entraînant ainsi un perpétuel conflit avec le corps médical. Celui-ci finira cependant par imposer ses vues, en dépit de convictions et de pratiques enracinées dans une longue tradition. Le régime de la diète finit par prendre le dessus. Le premier règlement du régime alimentaire des Hospices de Paris, publié en 1806, permet de mesurer, au gramme près, la nature du changement intervenu. On s’achemine peu à peu vers la nutrition moderne, la diététique, reconnue comme telle depuis 50 ans seulement. Et encore.
«Par arrêté du 16 décembre courant, j’ai décidé que dorénavant le caramel pourrait être employé en remplacement d’oignons brûlés dans la préparation du bouillon gras. Cette décision aura pour effet une notable diminution des dépenses», peut-on lire dans une circulaire du directeur général de l’Assistance publique, publiée en 1856. Jusqu’à ce que l’institution se médicalise, et que le matériel médical – et le personnel – absorbe la majeur partie des ressources budgétaires, l’alimentation a représenté le premier poste de dépenses: 60% du budget. A titre indicatif, le budget consacré aujourd’hui par l’Hôpital cantonal de Fribourg pour les achats de l’alimentation se situe entre 1 et 1,5% et entre 4 et 5% si l’on tient compte du salaire des cuisiniers et du restaurant du personnel, sur un budget annuel global de fonctionnement de l’ordre de 135 millions de francs.
Dans le budget de 1828 de la Maternité de Port-Royal, note l’historienne Scarlett Beauvalet, sur un total de dépenses de 210’898 francs français de l’époque, la rubrique «vin» apparaît avec un montant de 21’947 francs, juste derrière la «viande» (28’500 frs) et le «pain» (28’500 frs), mais loin devant la «pharmacie», avec 10’651 frs. Précisons que la tradition populaire d’alors attribuait à la femme enceinte ou accouchée d’irrésistibles envies et lui conseillait de s’y plier. D’où la naissance de l’adage «manger pour deux», à défaut de boire pour deux sans doute.
A chacun son demi-setier
Dans tous les régimes hospitaliers, aussi loin que l’historienne remonte, on trouve du vin. A l’hôpital de Metz, au Moyen Age, on donnait à chaque malade et chaque jour sa pinte de vin calculée à la vieille mesure, soit 93 cl. L’Hôtel-Dieu, à Paris, vers la même époque, donnait un demi-setier (23cl) par repas. En 1540 et en 1580, il est même question d’un demi-setier ou demyon «tant à disner que à souper et à desjeuner ung possen (du poisson) ou la moitié d’un demi-setier».
A vrai dire, note l’historienne, l’ancienne diététique n’était pas fondée sur l’analyse de la composition chimique des aliments et ne se souciait pas des besoins du corps en vitamines et sels minéraux. En 1606, le «Thresor de santé» proclamait étrangement au chapitre du lait et des produits dérivés comme le fromage qu’»on ne doit le permettre aux enfants mesme à ceux qui sont persécutez par des vers». Quelques années plus tard, un certain Abraham de la Framboisière dira des laitages que «le viel fourmage ne leur vault rien». Hostile aux fruits, le mal nommé de la Framboisière dira des fraises, des cerises, des prunes, des raisins, des groseilles et autres fruits aqueux qu’ils se corrompent facilement dans le corps. Quant aux pruneaux, ils trouvaient grâce aux yeux du médecin non comme fruits utiles à l’alimentation mais comme médicaments.
Proverbes et sagesse populaire
Les médecins et les pharmaciens? Les proverbes populaires ne les ménagent pas pour un sou. Sagesse? Dans les milieux populaires, on assurait que «deux sous chez le boulanger rapportent plus que trois francs chez le médecin»; «il est mieux d’aller à l’hôtellerie qu’à la pharmacie»; «mieux vaut le cheval du meunier que le cul du médecin»; «il vaut mieux payer le boucher que le médecin».
Les cerises, fruits de la vie
Le second groupe d’aliments est à la fois complémentaire et antithétique du premier. La salade, les fruits et les légumes aident le corps à évacuer: «salade bouillie allonge la vie»; «si tu veux de porter bien, dans ton estomac met un jardin. Contrairement à ce qu’on affirmait au XVIIe siècle, certains fruits comme les poires, les prunes et les cerises sont pourvues d’éléments bénéfiques. «poire bouillie sauve la vie». Les pommes ont pour leur part un rôle calmant, soporifique: «manger une pomme le soir fait dormir». Quant aux cerises, si décriées, elles ont pour elles ce proverbe à rendre pauvre n’importe quel médecin: «si dans toute l’année il y avait des cerises, messieurs les médecins n’iraient plus qu’en chemise».
Tantôt piquants, tantôt caustiques ou encore empreints de bon sens, les proverbes ne manquent pas d’accorder une place aux valeurs… à l’ordre du monde s’il n’est pas bien mis à table: «le pain à l’envers, le monde sens dessus dessous. Cet ordre apparaît aussi dans le souci des détails qui président aux principes d’ingestion des aliments. «vin sur lait est souhait, lait sur vin est venin». Des incompatibilités sont souvent soulignées: «l’ail cru et le vin pur rendent la mort sûre»; «eau et vin dans un même estomac, chien et chat dans le même sac; «ail et oignon font du poison». Quant à la diététique populaire, elle insiste sur les horaires des repas et la succession des aliments dans le temps: «les figues le matin sont d’or, à midi d’argent et le soir de plomb».
Dans la médecine domestique, où l’on note une très forte relation entre les recettes de cuisine et celles qui concernent la médecine, c’est la femme qui tout à la fois prépare la nourriture et les remèdes. Les livres de recettes de cuisines contenaient souvent des préparations de remèdes: tisane de santé, boissons digestives, bouillons fortifiants, mais aussi des remèdes spécifiques comme le sirop de limaces, contre la toux. La soupe à la grimace de l’époque qu’on faisait boire aux enfants à grand renfort de «une cuillère pour papa…, une cuillère pour maman…(apic/pierre rottet)