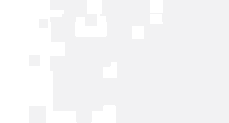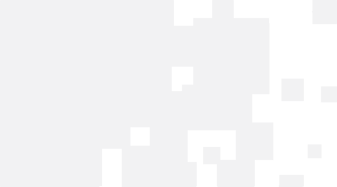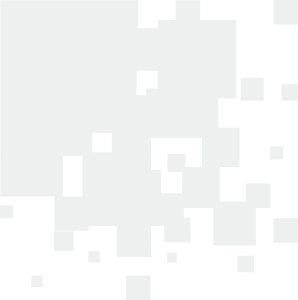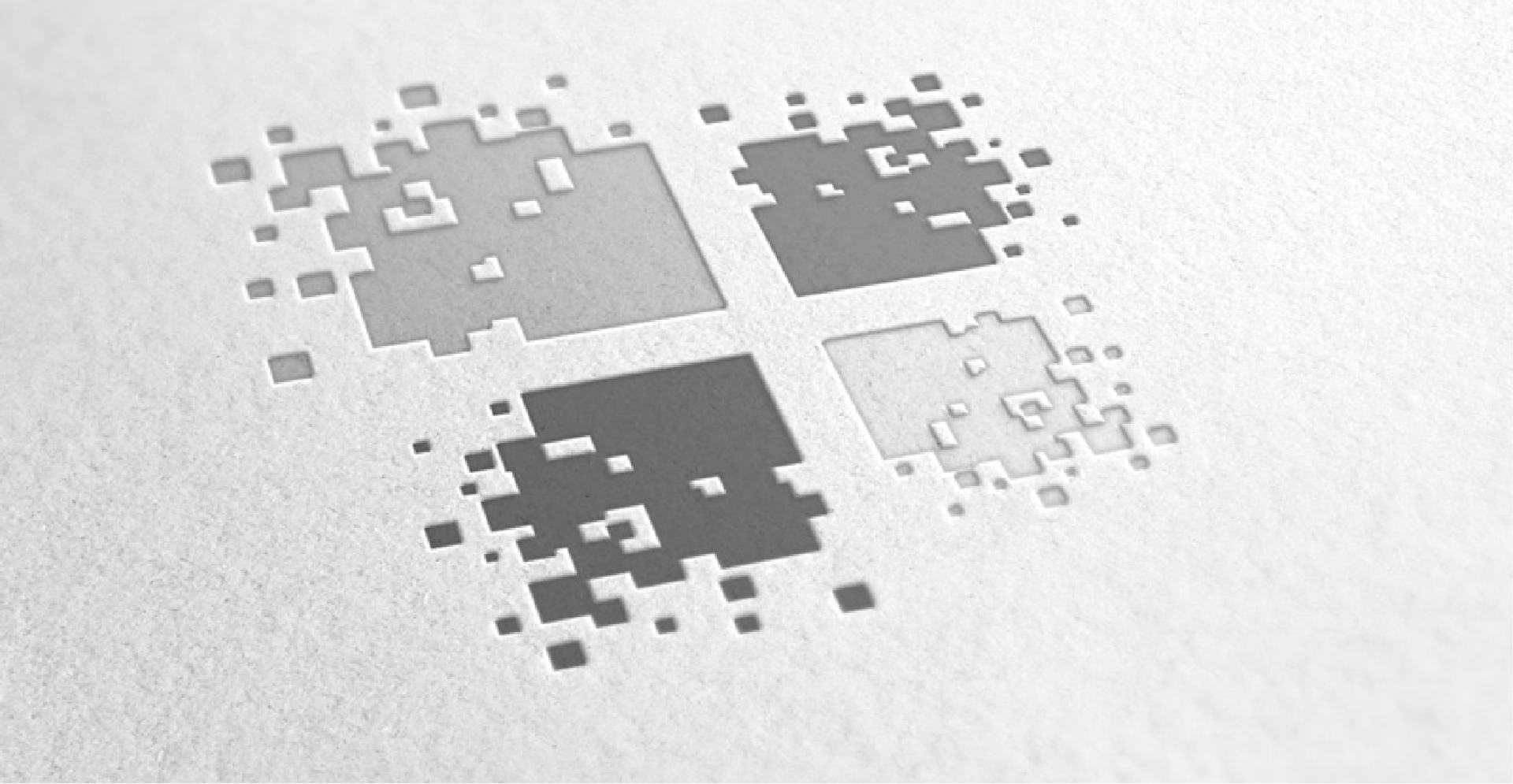Aujourd’hui, la presse écrite doit «faire de la TV sur papier»
Lausanne: La vision du journalisme selon Philippe Gardaz
Lausanne, 18 avril 2011 (Apic) Comment un juriste, ancien chroniqueur et administrateur de quotidiens, voit-il l’évolution du métier de journaliste? «Papivore insatiable» et critique, Philippe Gardaz (*) est aujourd’hui à la retraite. Chroniqueur religieux aux revues «Choisir» et «Sources», il nous donne sa vision du journalisme. Interview à chaud autour d’un café, dans son appartement à Lausanne.
Apic: Votre passion du journalisme remonte aux années 70. Quelle était votre vision de la profession?
Philippe Gardaz: Je croyais alors en l’existence et en la pérennité du journaliste cultivé, indépendant d’esprit, pouvant reporter et analyser les événements, en les mettant en perspective. La contrainte de l’immédiateté était, me semblait-il, faible.
Aujourd’hui, les journalistes doivent parler de tout, à toute allure. Ce qui les met dans une situation très difficile, en particulier à cause de la pression du temps. Or, dire des choses intelligentes demain, c’est mieux que de se précipiter pour reporter une réaction aujourd’hui, sans filtre ni regard critique.
Apic: Vous retrouvez-vous dans les règles établies en journalisme?
Philippe Gardaz: Je me retrouve très peu par rapport à mes représentations initiales. Notamment parce que la narration factuelle et le commentaire ne sont plus distingués, mais ils sont intégrés dans un texte unique.
Apic: Etes-vous plutôt un nostalgique, qui regrette le temps de Tintin reporter?
Philippe Gardaz: Il y a une part de nostalgie, c’est certain. Mais surtout la conviction que les contraintes actuelles empêchent les médias d’être ’citoyens’ (sourire amusé).
Apic: Qu’entendez-vous par là?
Philippe Gardaz: Ils n’assument plus le rôle fondamental de présentation des événements, assortis parfois d’un commentaire. Il faut absolument mettre en scène quelque chose qui accroche. Même si la réalité est rarement sensationnelle. Je regarde toujours la première page du «24 heures». Chaque jour, il faut un ’pétard’ à la une.
Apic:Pourquoi faites-vous référence au «24 heures» ou à un quotidien comme «Le Matin», et non au journal «Le Temps»?
Philippe Gardaz: La dérive émotionnelle s’insinue partout. En particulier dans la manière de titrer. (Maître Gardaz saisit «Le Temps» du 31 mars, ndlr) Voyez vous-même: «La Syrie, si verrouillée, sera-t-elle rattrapée par le printemps arabe?» ou «Des mesures pour sauver Lampedusa qui craque (et non qui croule, commentaire de Maître Gardaz, ndlr) sous l’immigration». Paradoxalement dans ses premières pages, «20 minutes» est plus sobre. Il donne des comptes rendus.
Apic: Comment concilier immédiateté et information événementielle?
Philippe Gardaz: Le métier de journaliste est devenu très difficile. La presse écrite doit produire quelque chose dans les heures qui suivent. On pourrait imaginer qu’un journal ne traite pas la dépêche ATS, pour alors le lendemain, publier un article plus fouillé. Mais la contrainte de l’immédiateté, liée à la course avec les médias électroniques, amène les journaux à faire de la TV sur papier. On survalorise alors un événement. Le journaliste devient l’otage de cette culture. Cela me dérange.
Apic: Laissez-vous entendre que le journalisme manque de professionnalisme?
Philippe Gardaz: Il y a un paradoxe. Les gens qui réfléchissent, qui mettent en perspective, qui exposent, ce sont les miliciens, dans les chroniques de non-professionnels; j’en suis parfois.
Apic: Votre regard sur l’évolution du métier est très critique. Vaut-il encore la peine de se former au journalisme?
Philippe Gardaz: Oui, parce que les consommateurs de médias vont finir par découvrir qu’une presse sérieuse et indépendante est globalement une protection pour chacun. Elle empêche le règne sans partage des préjugés, des idées qui ont cours et d’autres clichés usuels. Les médias s’opposent idéalement au fatalisme du «c’est comme ça».
Parallèlement, il faut que le public admette que ce produit protecteur, qu’est la presse indépendante, a un coût élevé. Il y a une mutation culturelle qui doit se faire et qui, me semble-t-il, est en train de se faire. L’indépendance n’a pas de prix, encore faut-il le payer.
(*) Ancien juge suppléant au Tribunal fédéral (1997-2008), Philippe Gardaz est président du conseil de l’Institut de droit des religions de l’Université de Fribourg, et membre de la commission d’experts Eglise-Etat de la Conférence des évêques suisse. (apic/ggc)