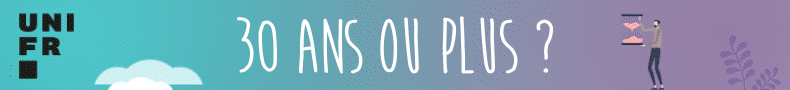
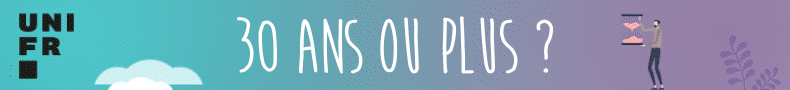
Sœur Élisabeth: religieuse depuis 70 ans
Le Canada dépense 3 milliards de dollars pour compenser les scandales des pensionnats catholiques
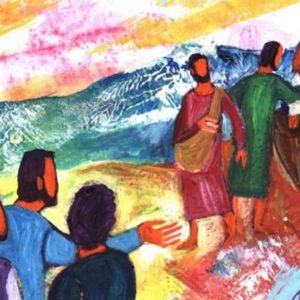
Homélie du 22 janvier 2023 ( Mt 4, 12-23)
Diacre Bernard Litzler – Eglise Saint-Joseph, Lausanne
Frères et sœurs,
Quelle leçon de management ! Jésus vient au bord du lac de Tibériade et interpelle deux frères, qui le suivent immédiatement. Puis deux autres, pareil. Quel management d’entreprise ! D’abord, Pierre et André, puis Jacques et Jean, c’est déjà un tiers de son équipe. Des frères qui ont l’habitude de travailler ensemble, ça fera moins de tensions dans le team, car ils se connaissent déjà.
Mais, frères et sœurs, le Christ n’est pas venu pour gérer une entreprise. Il vient appeler à la conversion en vue du Royaume de Dieu. Et son efficacité à recruter tient aussi à la réponse que donnent les pêcheurs qui quittent tout « aussitôt », dit le texte de Matthieu.
Efficacité des paroles, recrutement exprès : Jésus est entré dans sa phase missionnaire. Il enseigne, il proclame l’Evangile, il guérit les malades.
Jésus appelle encore aujourd’hui
Réponse à l’appel donc. Combien de vocations à la vie religieuse ou au sacerdoce sont nées ainsi ? Appel, coup de foudre et réponse radicale. Mais si Jésus a appelé ses disciples au bord du lac, ce n’est pas juste une histoire pieuse. Car il appelle encore aujourd’hui. Pas que des pêcheurs, mais nous tous. C’est moins frontal, mais ce n’est pas moins existant.
Jésus appelle à la foi. Et la réponse de foi donnée doit être volontaire. L’appel de Dieu n’est pas destiné d’abord à la vie religieuse, même si cela existe. Non, à tout moment, Dieu peut appeler à tel engagement, à telle action, à telle initiative. Un appel qui entraîne plus loin.
Combien entendent, à travers des intuitions intérieures, des appels aux conséquences parfois inimaginables ? Exemple, Mère Teresa de Calcutta, déjà religieuse et enseignante, a ressenti un appel intérieur à servir les plus pauvres : elle va fonder les Missionnaires de la Charité en Inde.
Autre situation, l’écrivain Paul Claudel a vécu, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, une conversion instantanée : « En un instant, écrira-t-il, mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d’une telle force d’adhésion, d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une conviction si puissante, que, depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher ».
Jésus peut aussi nous orienter dans les petites choses
C’est sans doute ce qu’ont vécu, à leur manière, les pêcheurs du lac. Mais le Christ n’agit pas que dans nos grandes décisions. Il peut aussi nous orienter dans les petites choses quand nous demandons son Esprit. Un appel à tel service à un voisin, à un collègue. Car l’Esprit veut guider nos pas. Ce n’est pas toujours évident à capter, mais Dieu appelle, encore et toujours. Et il nous donne la force intérieure de percevoir si c’est juste.
N’oublions pas que Dieu a aussi appelé Abraham à quitter son pays. Et il a, selon la Bible, appelé d’autres : Moïse au Buisson ardent, Moïse encore pour passer la mer Rouge avec le peuple hébreu, Elie, Osée, Ezéchiel, et d’autres. Et Marie, bien sûr, les Apôtres, Zachée, la Samaritaine, la femme adultère, etc.
Bien évidemment, certains refusent l’appel, comme Jonas que Dieu veut envoyer à Ninive. Mais Jonas s’enfuit et monte dans un bateau qui est pris dans une tempête. Il va se retrouver dans le ventre de la baleine. Soudain réaliser que Dieu s’obstine : il l’attend, encore et encore.
Aujourd’hui, le Royaume de Dieu est toujours en construction. Et Dieu nous attend ici-bas. Car son Esprit est à l’œuvre dans la Galilée qu’est devenue notre planète.
Nous sommes toujours à réévangéliser
Déjà du temps de Jésus, la Galilée c’était un lieu d’échanges entre les peuples. Et c’est en Galilée que Jésus commence sa mission. Le monde actuel reste une terre de mission pour les chrétiens. Nous-mêmes, nous sommes toujours à réévangéliser, à nous mettre à l’écoute des intuitions de l’Esprit. Nous restons des humains « à pêcher », sans aucun doute.
L’Eglise nous aide dans ce discernement. Entre autres avec la Doctrine sociale de l’Eglise, à savoir l’ensemble de sa réflexion sur les questions économiques et sociales.
Autre détail de notre Evangile : en Galilée, Jésus s’installe à Capharnaüm. Au sens figuré, le nom de cette ville désigne un lieu de pagaille, avec des objets entassés pêle-mêle, un endroit en désordre. Si Jésus va habiter à Capharnaüm, comment ne pas y voir une allusion à tous nos désordres personnels ou sociaux ? Le Christ déménage et il nous entraîne avec lui.
En appelant ses premiers disciples en Galilée, le Christ déborde de la Judée, le centre de la foi juive, avec le Temple de Jérusalem.
Désormais, comme le dit le livre d’Isaïe, une lumière s’est levée et elle va rejoindre tous les pays de la terre.
La mission se poursuit. Et nous croyons que les appels de Dieu sont orientés vers la vie. Prions donc pour que les appels de Jésus continuent de résonner dans les cœurs et produisent des fruits en abondance : « Venez à ma suite ». Amen.
3e dimanche du Temps ordinaire
Lectures bibliques : Isaïe 8, 23 – 9,3; Psaume 26; 1 Corinthiens 1, 10-13.17; Matthieu 4, 12-23

Bannière SPI – 2 semaines
Le catholicisme s’effrite en Pologne

Homélie du 15 janvier 2023 (Jn 1, 29-34)
Abbé Luigi Griffa – Eglise Saint-Germain, Assens, VD
Jean le Baptiste connaît Jésus. Ils sont parents par leurs mères. Comment peut-il dire qu’il ne le connaissait pas ?
Jean le Baptiste fait cette surprenante déclaration après avoir baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain. Jean donne ce premier témoignage : il a vu l’Esprit Saint descendre sur son cousin sous la forme d’une colombe peu après avoir quitté le lieu de son baptême. Cette expérience de la proximité de Dieu l’a bouleversé.
Dans un deuxième témoignage, il révèle que la mission de baptiser, il l’a reçue de Dieu qui l’envoyait ainsi manifester au peuple d’Israël l’arrivée prochain du Messie, celui que le prophète Isaïe, dans la première lecture, annonce comme la lumière des nations et le porteur du salut jusqu’aux extrémités de la terre.
Et cette mission était assortie d’une révélation plus extraordinaire encore : le Messie baptisera lui aussi, non dans l’eau, comme rite de purification, mais dans l’Esprit Saint. C’est pourquoi Jean le Baptiste donne ce troisième témoignage : Celui qui reçoit l’onction de l’Esprit Saint n’est pas le simple mortel qu’il semble être. Non. Son humanité est certes réelle, mais il est bien plus que cela : il est venu pour une mission plus grande encore que la sienne. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
La mission de Jean s’achève sur deux témoignages : Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est l’Agneau de Dieu
En voyant l’effusion de l’Esprit Saint sur Jésus, Jean comprend ainsi que sa mission s’achève et qu’il doit laisser la place. Il donne les deux témoignages les plus importants : la première, Jésus est le Fils de Dieu, la seconde Jésus est l’Agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde.
Le premier, Jésus est Fils de Dieu, est une chose impensable pour un Juif. Si le Dieu unique d’Israël a un fils, alors c’est la fin du monothéisme, caractéristique historique du judaïsme. Il est tout aussi impensable que Dieu, le Tout-Autre, puisse accepter d’être limité dans cette condition qui est la nôtre. C’est pour cette raison que Jean le Baptiste affirme qu’il ne le connaissait pas : s’il connaissait Jésus dans son humanité, il le connaît maintenant dans sa vraie condition, celle de Fils de Dieu venu en notre chair.
Le second, Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est tout aussi impensable. Les Juifs, au Temple de Jérusalem, sacrifiaient des animaux en de nombreuses occasions, l’agneau étant l’animal le plus utilisé. Le Messie peut-il tenir, dans l’oeuvre de Dieu, la place de l’agneau du sacrifice ? Ne doit-il pas être le libérateur d’Israël du joug des Romains ?
Mais c’est pourtant ce que Jean affirme à ses disciples présents. Dès lors ils se mettent à suivre Jésus.
Le deuxième dimanche du temps ordinaire, chaque année, le lectionnaire nous présente quelques-unes des proclamations de la divinité de Jésus, au moment où il quitte Nazareth et commence à enseigner dans les villes et les villages de Galilée, au moment où il trouve ses premiers disciples. Les trois passages sont tirés du même Evangile de Jean : l’année B (l’année prochaine) ce sont les disciples de Jean le Baptiste qui se mettent à suivre Jésus, l’année C (l’année passée) c’est le changement de l’eau en vin aux noces de Cana.
Accueillons le témoignage de Jean le Baptiste
Alors, en ce dimanche, accueillons le témoignage de Jean le Baptiste. Mettons notre confiance en Jésus Christ, né de Marie, Sauveur d’Israël, comme nous l’avons proclamé et célébré au temps de Noël. Ouvrons notre vie à Jésus, Fils de Dieu : par sa mort sur la Croix, agneau du sacrifice, et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort et les portes de son Royaume, où nous sommes attendus avec joie pour partager éternellement la plénitude qu’il a réalisé en sortant vivant du tombeau.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
2e dimanche du Temps ordinaire
Lectures bibliques : Isaïe 49, 3-6 ; Psaume 39 ; 1 Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34
Test stream RTS
https://www.rts.ch/play/embed?urn=urn:rts:video:13580933&subdivisions=false
https://tp.srgssr.ch/p/rts/inline?urn=urn:rts:video:13580933&subdivisions=false
—
<iframe width="560" height="315" src="https://www.rts.ch/play/embed?urn=urn:rts:video:13580933&subdivisions=false" allowfullscreen allow="geolocation *; autoplay; encrypted-media"></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://tp.srgssr.ch/p/rts/inline?urn=urn:rts:video:13580933&subdivisions=false" allowfullscreen allow="geolocation *; autoplay; encrypted-media"></iframe>
Un livre du secrétaire de Benoît XVI ébranle le Vatican

Homélie du 8 janvier 2023 (Mt 2, 1-12)
Abbé Etienne Catzeflis – Café du Col de Torrent, Villa sur Evolène (VS)
Hommes de bonne volonté, disponibles à l’aventure de la foi
Attention que le récit de l’Epiphanie (aujourd’hui) et celui de Noël ne demeurent des anecdotes infantiles, pour amuser les enfants, comme le conte du Père Noël.
Avec le récit de Noël, Luc nous apprend que Jésus n’est pas un espèce d’extra-terrestre, un sauveur surgi d’ailleurs :
il est un homme né d’une femme comme chacun de nous,
à une époque précise et en une région bien déterminée.
Et les premiers à s’en émerveiller sont des pauvres, qui veillent : les bergers.
Le Sauveur se fera accueillir par les cœurs pauvres … qui restent éveillés dans la nuit du monde.
La mission de Jésus déborde les frontières du judaïsme
Pour sa part le récit des Mages, donné par l’évangéliste Matthieu, montre que la mission de Jésus déborde les frontières du judaïsme.
Evoquant l’adoration de l’Enfant-Roi par « des étrangers », notre récit, fort imagé, donne le ton à tant d’autres paroles et gestes de Jésus, que Matthieu va compiler dans son livre, relevant la grandeur, la foi ou la bonté de personnes non-juives.
Comme nous l’avons entendu dans la 2ème lecture, saint Paul confirme cela : « Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, … »
Chers amis, enlevons la couronne à ces hommes :
les mages n’étaient pas des rois, mais des sortes de savants qui étudiaient les mouvements des astres et autres phénomènes cosmiques, afin d’y lire des messages divins.
Pour atteindre leur but, ils interrogent la tradition juive en passant par Jérusalem.
Une fois parvenus, ils adorent l’enfant-roi et expriment leur hommage par des présents.
Puis, mystérieusement éclairés, ils s’en retournent chez eux par un autre chemin.
COMMENT cet épisode PEUT-IL ECLAIRER notre foi chrétienne aujourd’hui et DONNER SENS à ce que nous voyons dans ce monde varié ?
Un monde varié et vaste (!), mais que nos moyens techniques et nos facilités de communications réduisent en quelque sorte à la taille d’un village.
Cela fascine certains, et fait peur à d’autres, provoquant des mouvements sécuritaires nationalistes, parfois même extrêmes, malheureusement.
Pour retenir un enseignement profitable à notre monde aujourd’hui, évitons d’abord des interprétations réductrices ou simplistes :
Non, les mages ne sont pas venus présenter une sorte d’allégeance à l’Enfant-roi.
Et pour nous, non, il ne s’agit pas d’imaginer notre jubilation dans un rêve que toutes les Nations embrassent notre foi chrétienne.
L’Enfant-Jésus, les bras tendus vers les mages
Je vous invite plutôt à un changement de perspective :
EN REALITE, CE NE SONT PAS LES MAGES qui se déplacent : c’est l’Enfant-Roi qui va à eux.
Telle est la posture tellement significative dans certains tableaux de la visite des mages : on voit l’enfant-Jésus, porté par sa mère, les bras tendus vers ces hommes présentant leurs coffrets.
Ainsi Dieu, dans le Tout-Petit, vient agréer ce que ces hommes lui présentent : l’or, la myrrhe et l’encens.
Prenons cela comme des symboles de la disposition intérieure de ces savants:
L’or (pour un roi) : l’aspiration à la sagesse et à la maîtrise
La myrrhe (baume funéraire) : la pleine reconnaissance de leur finitude malgré leur savoir
L’encens (régulièrement associé aux prières) : l’humilité de concevoir l’existence du Tout Autre et de Le prier.
Dieu présent dans toutes les démarches profanes qui honorent l’homme
Ainsi, par la visite des mages et l’accueil offert par l’Enfant-roi, nous percevons qu’aujourd’hui encore Dieu se trouve bien dans toutes les démarches profanes qui honorent l’HOMME, dans tout le potentiel créateur de l’homme, indépendamment de la religion, quelles que soient la culture, la religion et la race ; tout ce qui, en l’homme, reflète Ce que Dieu est en Lui-même.
Pensons aujourd’hui au monde de la science et au monde de l’art – avec la somme des œuvres techniques et culturelles (musiques, poèmes, peintures, danses, etc…).
Tout ce monde, cherchant la vérité et la beauté, ou cherchant encore à exprimer par leur inspiration et leur talent ce qui restera toujours ineffable,
ou constatant avec humilité que leur découverte leur révèlent toujours plus des pans gigantesque de leur ignorance (cette science qui leur ouvre sans cesse des horizons nouveaux d’interrogation et, du coup, de contemplation face à la beauté et la complexité de la Création).
Telle est la porte par laquelle Dieu se laisse honorer. Et parfois, c’est le surgissement de contemplation qui surprend l’un ou l’autre de ces hommes assoiffés de Vérité, de Sens et d’Amour. Ils lui expriment la seule attitude possible : la gratitude.
Telle est l’expérience de Blaise Pascal, lors de « la nuit de l’extase » (novembre 1654), que commente un de ses admirateurs (Xavier Patier, Blaise Pascal, La nuit de l’extase, Cerf 2014, p. 23) :
« Toi, le philosophe et le savant, tu as pleuré de joie en te laissant aimer par le Christ, qui n’était pas le Dieu des philosophes et des savants.
N’oublie jamais qu’à une certaine heure tu as, toi le scientifique imbu de sa supériorité, désiré la soumission totale et douce à Jésus.
Tu as, toi le pessimiste, été fasciné par la grandeur de l’âme humaine.
Tu as, toi le sceptique, ressenti une certitude.
Tu as, toi le cérébral, éprouvé un sentiment ».
« Joie, joie, joie, et pleurs de joie ! »
Frères et sœurs, que la Solennité de l’Epiphanie, nous aide
à rechercher,
à apprécier
et à relever cette présence de Dieu
en toute culture, en toute civilisation, en toute religion,
dans leurs activités intellectuelles, artistiques, spirituelles.
Amen
Fête de l’Epiphanie du Seigneur
Lectures bibliques : Isaïe 60, 1-6; Psaume 71; Ephésiens 3, 2-6; Matthieu 2, 1-12


