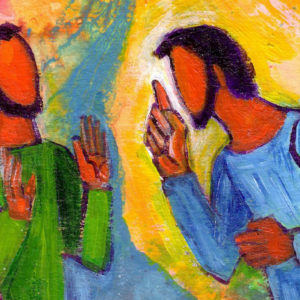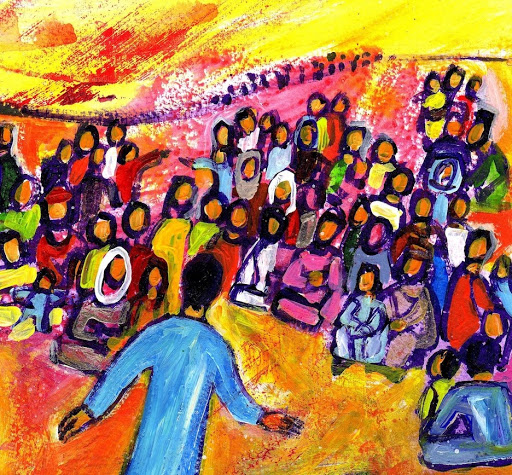Abbé Joseph Demierre – Église Saint-Joseph, Lausanne
La Fraternité
La paille et la poutre, l’aveugle qui guide un autre aveugle, ou bien : on juge l’arbre à ses fruits…
Voilà diverses comparaisons que Jésus utilise dans l’Évangile de ce jour et qui sont entrées dans la sagesse populaire.
Et pour dire quoi ?
Jésus veut nous faire réfléchir sur nos attitudes, et surtout sur la vérité de nos paroles ou de nos comportements : ton regard sur l’autre quel est-il ?
Nous sommes tous facilement enclins à critiquer, à faire la morale, à juger. Mais Jésus nous invite d’abord à nous regarder nous-mêmes. Pour changer le monde, il faut d’abord se changer soi-même. Et nous aurons tout le Carême qui va commencer cette semaine pour faire cet examen de conscience.
Jésus propose un autre regard
Pour aujourd’hui, le Christ veut d’abord nous redire quelles sont ses perspectives. Il dénonce nos fausses interprétations et notre hypocrisie, pour nous proposer un autre regard, une autre logique, une autre manière de voir. « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon » : qu’y a-t-il dans notre cœur ? Dans notre cœur, il y a peut-être beaucoup de pourriture ou de moisissure, des épines ou des ronces, des rancœurs, des suspicions, des ressentiments qui se cachent et qu’il s’agit de purifier. « On ne cueille pas des figues ou du raisin sur des épines ou des ronces », dit encore Jésus.
Ce que nous dit Ben Sira le Sage : « Quand on secoue le tamis, il reste les déchets… »
Ce que nous dit aussi saint Paul : « L’aiguillon de la mort, c’est le péché, c’est-à-dire la jalousie et les rivalités : Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Il y a tout un travail de décantation à faire dans notre cœur, dans notre vie, spécialement dans nos relations les uns avec les autres.
C’est donc à une prise de conscience que Jésus nous invite, et à une autre attitude à avoir. Laquelle ? Celle de la bonté du cœur, qui peut produire de bons fruits.
La bonté du coeur
Cette bonté du cœur est d’abord celle de Dieu, et celle de Jésus, face à ceux et celles qu’il rencontre, et qui apparaît dans tout ce qu’il dit ou fait : il ne juge pas ; il accueille chacun, chacune tel qu’il l’est ; il ne fait pas acception de personne. Pour lui chacun de unique et précieux.
Puissions-nous avoir le même regard de bienveillance et de compassion, de respect et d’estime que Jésus a eu avec ceux et celles qu’il rencontrait.
« Vous n’avez qu’un seul Père et vous êtes tous frères », nous dit Jésus. Là derrière, il y a une transformation qui s’opère, une autre manière de voir la vie, le monde, les autres : c’est la Fraternité entre les hommes, du fait que tous sont fils du même Père.
La Fraternité entre les hommes
Cela rejoint l’intuition de saint François et la belle encyclique du pape François « Fratelli Tutti », sur la fraternité entre les hommes. Ce fut aussi l’intuition de frère Charles de Foucauld, dont l’encyclique s’inspire, et qui sera canonisé à Rome en mai prochain :
« Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, idolâtres et agnostiques à me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler ma maison « la Fraternité » et cela m’est doux. » écrivait-il, au fin fond du Hoggar, le Sahel actuel. C’était prémonitoire.
Accueillir et respecter chacun comme un enfant de Dieu pour lequel le Christ a donné sa vie, et comme un frère ou une sœur bien-aimé. C’est ce que nous disons dans le Notre Père.
Ce rêve, cet idéal change notre perspective d’êtres humains et notre vision de la réalité.
La foi au Christ nous fait voir les choses et les autres tout autrement. Nous ne sommes plus aveuglés par nos peurs et nos ressentiments. Nous sommes mus par un autre idéal, une autre perspective. L’autre n’est plus vu comme un ennemi ou un adversaire, un concurrent ou un rival duquel il faut se méfier. Il devient un frère, une sœur à aimer, qui mérite toute notre attention, notre estime et notre considération. Enlever la poutre qui empêche de voir clair, c’est se tourner vers Dieu pour pouvoir regarder comme Dieu regarde, parler comme Dieu parle, aimer comme Dieu aime.
Le Christ nous invite à dépasser nos réactions instinctives et à regarder l’autre comme Dieu le voit.
La venue du Christ a permis l’engendrement d’une nouvelle humanité.
L’Évangile est à la base d’une transformation profonde de notre manière de vivre, illuminés par l’amour inépuisable et débordant de Dieu pour nous.
Savoir dépasser l’inimitié ou l’offense par un surcroît d’amour. Et ce surcroît d’amour vient de Dieu. Nous en sommes incapables par nous-mêmes. Seul Dieu peut guérir ces blessures du passé.
Le Christ en appelle à une autre manière de voir, non plus de notre point de vue, mais de celui de Dieu, de sa miséricorde, de sa bienveillance, de sa bonté. Dans un monde dominé par la loi du plus fort, ou celle du profit, Jésus instaure une autre logique : la loi de l’amour, la loi du cœur. Le cœur de l’homme et de la femme est appelé à ressembler au cœur de Dieu.
Telle est la Bonne Nouvelle à annoncer au monde, dans une approche du salut passant par l’idée d’une fraternité à construire avec des attitudes et des mots qui disent l’universel de l’homme et de la femme créés à l’image de Dieu, au-delà de toute religion et de tout parti pris, dans le souffle de l’Esprit.
Tous fils et filles de Dieu et frères et sœurs les uns des autres, dans un Esprit de bienveillance et de bonté du cœur, qui est celle même de Dieu.
Amen !
8e dimanche du Temps ordinaire
Lectures bibliques : Siracide 27, 4-7; Psaume 91, 2-3, 13-14, 15-16; 1 Corinthiens 15, 54-58; Luc 6, 39-45