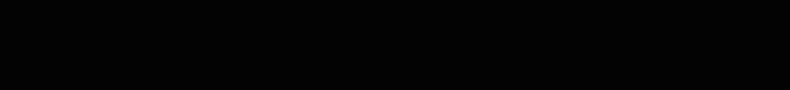Homélie du 25 juillet 2021 (Jn 6, 1-15)
Chanoine Raphaël Duchoud – Hospice du Grand-Saint-Bernard
Dieu qui t’a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi.
« Dieu qui t’a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi »… Chers frères et sœurs ici présents dans cette église de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard et vous tous qui êtes en communion avec nous par la magie des ondes d’Espace 2, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez en ce moment, à l’hôpital, en prison, à la maison, sur la route ou sur le lieu de votre travail ou encore ailleurs, cette réflexion de saint Augustin qui ouvre cette homélie veut rappeler à chacun de nous combien il est nécessaire de notre part de donner une réponse libre à l’exhortation divine de marcher sur la route avec le Christ pour accomplir pleinement notre vocation de pèlerin en marche vers le Règne de Dieu.
S’engager pour la cause du Règne de Dieu
Le récit bien connu de la multiplication des pains que la liturgie de ce jour présente à notre méditation enseigne en premier lieu que Dieu, en son Fils Jésus, révèle son dessein d’amour en désirant que tout être humain soit sauvé au point de placer toute sa gloire dans l’homme vivant. Ce passage d’évangile présente donc un Jésus très humain, attentif à la condition de chacune des personnes venant vers lui pour entendre sa parole. « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Cette question adressée à Philippe, précise l’évangéliste, a comme but de l’interpeller et par là, d’exhorter chacun à s’engager pour la bonne cause du Règne. Travailler pour le Royaume de Dieu n’est pas une tâche réservée à un petit groupe de personnes ; chacun est appelé à se sentir impliqué pour cette cause : Dieu qui t’a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi ; il a suffisamment semé dans ton cœur les qualités nécessaires pour travailler à la venue de son Règne mais il attend ta libre réponse pour réaliser en toi son dessein de salut.
La communauté est donc appelée à s’impliquer pour répondre au commandement du Seigneur ; « Donnez-leur vous-même à manger ! » dit Jésus. Alors que les disciples s’interrogent au niveau économique pour essayer de trouver une solution, l’attention de Jésus se porte vers un petit garçon, présenté par André, le frère de Simon-Pierre, qui avait avec lui cinq pains d’orge et deux poissons. Et c’est là que Jésus attend de la part de chacun un acte de confiance : avec peu de choses, il est capable de réaliser quelque chose de grand : un signe montrant qu’il se donne abondamment à tout être humain, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Les petites qualités qui sont signe du royaume de Dieu
Il faut souvent peu de choses pour rayonner d’une présence riche, porteuse d’espérance et de vie. Si l’on pouvait redécouvrir les petites qualités cachées dans le cœur de chacun capables d’être un signe du royaume de Dieu ! Par exemple, un sourire ne coûtant rien qui produit beaucoup, un petit geste d’attention qui restimule, un regard encourageant qui valorise. Le Seigneur n’attend pas des actes extraordinaires de notre part pour se manifester ; dans le récit de la multiplication des pains, un enfant ayant cinq pains et deux poissons suffit pour être le signe d’une espérance nouvelle.
Lors d’un pèlerinage à Lourdes durant le mois de juillet, assis près de l’entrée des sanctuaires, un mendiant recevait quelques pièces de monnaie de la part d’un prêtre qui lui faisait l’aumône. En recevant ce don, il fixa des yeux son bienfaiteur et lui dit : « Toi, tu es un curé, moi je suis un con. Je n’ai pas besoin de ton argent, j‘ai besoin de ton cœur. » Par des rencontres, d’évènements inattendus, joyeux comme douloureux, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Confrontés à nous-mêmes, nous apprenons petit à petit la qualité et l’importance du don. Ecoutons ces quelques réflexions du poète libanais Khalil Gibran à ce sujet :
Alors, un homme riche dit : « Parlez-nous du don. »
Et il répondit : « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C’est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement.
Il en est de ceux qui donnent peu de l’abondance qu’ils ont – et ils donnent pour susciter la reconnaissance – et leur désir secret corrompt leur don.
Il en est qui ont peu et le donnent entièrement. Ceux-ci croient en la vie et dans la bonté de la vie et leur coffre n’est jamais vide.
Il en est qui donnent avec joie et cette joie est leur récompense.
Il en est qui donnent avec douleur et cette douleur est leur baptême.
Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie et ne sont pas conscients de leur vertu ; ils donnent, comme dans la vallée là-bas le myrte exhale son parfum dans l’espace.
Par les mains de tels êtres, Dieu parle et, à travers leur regard, il sourit à la terre.
(Khalil Gibran, Le Prophète)
Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 17ème dimanche du Temps ordinaire où nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur pour tant de personnes qui savent donner le meilleur d’elles-mêmes au service de la société, auprès des malades et des marginalisés, pour tant d’ouvriers œuvrant dans l’ombre dans les entreprises et d’autres établissements, alors que durant cette année, nous vivons l’année “Saint Joseph” durant laquelle le pape François invite chacun à méditer sur la vie de cet homme qui ne fut que don de lui-même pour la cause du Règne de Dieu, demandons au Seigneur la grâce de découvrir ou de redécouvrir la beauté du don de soi-même à l’image de Celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
17ème dimanche du temps ordinaire
Lectures bibliques : II Rois 4, 42-44 : Ils en mangeront et il en restera.
Ephésiens 4, 1-6 : Un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Jean 6, 1-15 : Il leur distribua autant qu’ils le voulaient.
La déconstruction linguistique de termes bibliques a la cote sur TikTok

Homélie du 18 juillet 2021 ( Mc 6, 30-34)
Mgr Jean Scarcella – Abbaye de Saint-Maurice, VS
Mes sœurs, mes frères,
Une raison essentielle et fondamentale qui permet aux hommes et aux femmes de vivre ensemble dans un unique projet de construction, celui de l’établissement du Royaume de Dieu, c’est de chercher la paix, de vivre en paix. Et pas seulement de vivre en paix, mais d’abord de vivre la paix ; la paix qui doit être comprise comme un élément inhérent à la vie des hommes, une réalité qui permet l’épanouissement de toutes les qualités humaines appelées à donner à l’homme sa dignité dans l’ordre de la création divine.
La paix est comme un principe intangible, qui est à la base de toute action humaine, certes, mais bien sûr d’abord chrétienne. Cependant elle n’est pas immuable, elle peut se défaire et se refaire, elle est composite de tant d’enjeux de vie ; elle est forte, mais aussi fragile. Si elle est un bloc qui unit les hommes en son sein, elle peut aussi être le moyen d’unir ceux qui sont dispersés. Saint Paul nous le disait à l’instant : « Il [Jésus] est venu annoncer la Bonne Nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches ».
D’autre part, si la paix est un en-soi, si elle est une réalité à part entière, elle reste confrontée à ce qu’elle n’est pas – son contraire : l’absence de paix qui porte au chaos, l’oubli de la paix qui amène la discorde.
Dieu a mis toutes choses « en forme de paix »
Tout d’abord la paix rassemble, elle met ensemble. Cela a été la première œuvre de Dieu quand il s’est manifesté en tant que créateur face au néant, au chaos, précisément. Sa création a non seulement fait advenir ce qui n’existait pas, mais elle a aussi mis les choses ensemble ; elle a ordonné les éléments créés, en les rassemblant par affinités, comme par fonctionnalités. Il a mis toutes choses “en forme de paix”, là où tout va bien de concert, où tout s’harmonise, comme les notes d’une même tonalité. Et le sommet de cette création, nous le savons bien, c’est l’homme et la femme, principes de paix, à la fois immanente et réelle.
Ensuite la paix doit, par son existence qui se déploie dans l’humanité, et par son essence-même, lutter contre tout ce qui peut la mettre de côté, dans les abîmes de l’oubli. Car alors va naître la discorde, se déployer la violence, gronder la guerre. Pour lutter là-contre, la paix doit continuellement se refaire, elle doit aller chercher au plus profond d’elle-même la force d’y parvenir à tout prix ; c’est essentiel, vital pour le genre humain auquel elle est viscéralement attachée.
L’arme de la paix c’est l’amour
Cependant, malgré tout ce que l’on vient de dire, la paix toute seule, comme ça, avec tout le potentiel d’énergie qui peut lui donner d’être, ne peut pas aller au front, pour contrer ce qui l’agresse, sans arme ; effectivement elle n’a pas d’arme destructrice, ce qui donnerait raison au proverbe :“Qui veut la paix prépare la guerre”, non, mais son arme à elle, son unique arme, qui n’est pas un objet qui pousse à l’offensive, est une réalité, un don, une grâce qui vient de Dieu et sur laquelle elle s’appuie, et cette arme-là : c’est l’amour !
Vous le savez très bien, frères et sœurs, aucune paix n’est possible s’il n’y a l’amour. La paix est non seulement une manifestation de l’amour, mais encore le lieu-même de l’amour, comme le sont pour le psalmiste les prés d’herbe fraîche, les verts pâturages où le pasteur chérit et soigne ses brebis. Car une chose est sûre et imparable : là où il n’y a pas d’amour on ne trouvera que de la haine. Et puis encore, mes sœurs, mes frères, n’allons pas imaginer des degrés à l’amour pour nous disculper face à ces manques d’amour que nous excusons trop facilement. Oui, frères et sœurs, s’il n’y a pas l’amour : eh bien il y a la haine, et c’est tout ! Là où il n’y a pas d’amour vécu, le loup entre dans la bergerie et nous devenons des complices de son action ; nous devenons de mauvais pasteurs pour nos frères et sœurs, nous les chassons hors du bonheur, nous les dispersons dans des lieux ténébreux, nous les tuons avec l’épée de la haine, par manque d’amour, ni plus ni moins !
Le Dieu qui sauve c’est Jésus, l’Emmanuel, “Dieu-avec-nous”
On ne peut y aller par quatre chemins, frères et sœurs, car il n’y a qu’un chemin que nous, chrétiens, nous connaissons tous, et qui se nomme Jésus. C’est lui le « Germe juste » dont le prophète Jérémie annonce la venue, lui que Dieu suscitera pour rassembler les brebis dispersées par la haine, chassées par la jalousie ou abandonnées par orgueil. Celui qu’Isaïe a nommé l’Emmanuel, “Dieu-avec-nous”, que Jérémie appelle “Le-Seigneur-est-notre-justice” et que l’ange Gabriel annonce comme le “Dieu qui sauve” : c’est lui, Jésus !
Mes sœurs, mes frères, Dieu, notre Dieu, est le Dieu qui est avec nous, notre paix et notre chemin vers le salut. Dieu est amour ; il est avec nous et nous apprend l’amour, élément premier et fondamental de notre vie chrétienne. C’est donc avec l’amour que nous pouvons vivre dans l’harmonie que procure la paix.
Les gestes, les mots et les sentiments justes pour vivre la paix
Ce Dieu est notre justice, aussi, c’est-à-dire qu’il nous apprend les gestes, les mots et les sentiments justes pour vivre la paix et être rassemblés, paisiblement, autour de Celui qui est à la fois l’Agneau et le Pasteur. Un lieu de paix total : sinon il n’en est pas un ! …
Enfin, ce Dieu est celui qui nous sauve, nous réconciliant les uns les autres avec lui en nous rassemblant « en un seul corps par le moyen de la croix », disait encore saint Paul. En effet, Jésus est venu pour nous apprendre l’amour qui sauve, en tuant la haine par son sacrifice d’amour en sa vie offerte pour nous. Par sa croix il nous apprend le pardon, le seul moyen pour nous de manifester la paix et de la vivre : le moyen essentiel pour lutter contre la haine, afin de restituer au monde l’entier de l’amour, et rassembler l’universalité des brebis autour du seul berger.
Ainsi soit-il !
16e dimanche du temps ordinaire
Lectures bibliques : Jérémie 23, 1-6 Psaume 22 / Éphésiens 2, 13-18 / Marc 6, 30-34
UE: interdire le voile n’est pas discriminatoire
Un prêtre schwytzois plaide contre la vaccination des personnes en âge de procréer
Le Dalaï Lama fête ses 86 ans et sa succession fait débat

Homélie du 11 juillet 2021 (Mc 6, 7-13)
P. Jean-René Fracheboud – Chapelle de La Pelouse, Bex, VD
Chers frères et sœurs,
Je me suis endormi sur le sable à mille miles de toute terre habitée. Au lever du jour, une drôle de petite voix me réveille: S’il te plaît, dessine-moi une église.
Je saute sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. Je frotte bien mes yeux. Je vois un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considère gravement. Il me répète alors, tout doucement comme une chose très sérieuse : S’il te plaît, dessine-moi une église.
Chers amis, vous reconnaissez là une paraphrase du Petit Prince de Saint-Exupéry. J’emprunte à un confrère de la région lausannoise, décédé depuis quelques années, l’abbé Gilbert Marguet, cette savoureuse adaptation du Petit Prince.
«Dessine-moi une église!»
Quand un mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir. Je sors de ma poche un papier et un crayon et je dis au petit bonhomme que je ne sais pas dessiner.
Ça fait rien, dessine-moi une église, dit le Petit Prince
Alors, je dessine un clocher avec un tas de cloches. Il me regarde attentivement et me dit:
Non non, c’est pas ça que je veux!
Je refais mon dessin avec le clocher, une vaste nef, des fenêtres ogivales. Mon dessin est encore refusé. Il me dit:
Celle-là est trop vieille. Je veux une église qui dure longtemps!
Je refais une autre église avec beaucoup d’or et d’argent et toute étincelante de richesse, de beauté.
Non non, dit le Petit Prince, celle-là est très malade. Dessine-moi une église!
Faute de patience, je griffonne un autre dessin: je griffonne un petit enfant dans les bras de sa mère; un papa qui pose sa main sur l’épaule de la maman; un homme âgé qui s’appuie sur une canne; un jeune qui a le visage tout noir de l’Afrique; une grande fille aux yeux bridés. Je dessine un tas de monde qui se parle, se donne la main, s’écoute et sourit. Je suis bien surpris de voir s’illuminer le visage de mon petit bonhomme. Il me dit avec enthousiasme:
C’est tout à fait comme cela que je la veux cette église!
Frères et sœurs, c’est à nous aujourd’hui de dessiner l’église de Jésus-Christ! Vous le savez que trop…. Nos communautés, paroissiales, diocésaines, religieuses traversent actuellement des turbulences. Les révélations douloureuses de tous les abus d’autorité qui dérivent en abus sexuels nous laissent sans voix. Un cléricalisme rampant et sournois continue de ternir l’image de l’église.
Beaucoup s’en vont et cherchent ailleurs des raisons de vivre et d’espérer. Et la pandémie que nous avons subie ne fait qu’accentuer ce qui apparaît bien comme un naufrage.
Reconnaissons-le ! Beaucoup d’autres institutions, le politique, l’économie, le culturel subissent la même érosion.
Alors que faire? Fermer les yeux… fuir… tout laisser tomber? Non, il y a mieux à faire et à vivre. Il y a un formidable défi à relever : laisser le Christ, dans la force de l’Esprit, modeler son église, dessiner son église à travers nos vies, nos visages et nos engagements de baptisés, l’église de toujours, mais dans l’aujourd’hui de notre temps et le réalisme de ce monde bouleversé et bouleversant, et en même temps fascinant.
La liturgie de ce dimanche, les textes proposés à notre attention priante, nous offre 3 belles balises, 3 points d’ancrage pour vivifier nos communautés et leur redonner du souffle et de l’ambition.
Premier point essentiel: retrouver la dimension prophétique de l’évangile et de l’Église.
A la suite d’Amos et de tous les prophètes, il s’agit de retrouver une Parole de Dieu qui à la fois ouvre un avenir de salut et à la fois dénonce vigoureusement les entraves, les scléroses, les sévices du mal. On n’aime pas les prophètes car ils dérangent. Le prêtre de Béthel, Amazias, dit à Amos: «Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda»… Fous le camp, va prophétiser ailleurs…
Mais la réponse d’Amos est claire: «Le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau et c’est lui qui m’a dit ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël’.»
Le Christ poussera à l’extrême cette Parole prophétique, créatrice en allant jusqu’à l’extrême de la CROIX et de la Résurrection. Est plantée à tout jamais l’insurrection de l’Amour vainqueur face aux inerties multiples des enfermements, y compris celui des religions, des liturgies sans âme et des injustices notoires.
Aujourd’hui, plus que jamais, il y a urgence à faire retentir le cri prophétique du Christ vis-à-vis de tous les drames qui empêchent les hommes et les femmes de vivre dignement. Oui, l’église à dessiner, à esquisser, à bâtir, est une église prophétique, et le Seigneur en est l’animateur.
Deuxième point, deuxième balise: l’église n’a pas d’autre prétention que de rendre visible l’éternel dessein d’amour de Dieu sur toute l’humanité.
C’est la fresque grandiose de la 2e lecture, l’hymne de S. Paul aux Éphésiens.
L’église est appelée à donner à voir, dans la fragilité, la somptuosité de ce Dieu qui voit grand pour l’homme et qui s’acharne envers et contre tout à tout orienter vers une plénitude et un achèvement. Le terme de l’histoire, c’est quand tout basculera dans l’accomplissement de l’amour en Dieu.
Nos églises, quand bien même elles sont secouées et bien imparfaites, sont un début de réalisation de ce qui sera demain dans la beauté et la gloire de Dieu. En terme théologique, cela s’appelle la dimension sacramentelle de l’église.
L’humble ébauche de notre manière d’être ensemble au nom du Christ Jésus, nos manières de prier, de nous engager pour les plus pauvres ne sont pas banales. Elles disent un commencement qui annonce la consécration finale de la vie, de nos vies en DIEU. Cette prise de conscience est immense. Elle est le secret de nos fidélités. Puissions-nous continuer à dessiner cette église, même dans la tourmente et les dérisions trop faciles.
Troisièmement: l’Église à dessiner est une église riche de sa pauvreté.
Là, nous rejoignons l’évangile du jour, l’envoi en mission des Douze «…deux par deux, il leur donna autorité sur les esprits impurs. » C’est leur unique force, la densité en eux de l’autorité d’amour du Christ.
Par ailleurs, ils sont envoyés les mains nues, sans gadgets, sans artillerie lourde, sans moyens, sans ressources exceptionnelles. Un bâton et des sandales, c’est tout. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, pas de tunique de rechange… Rien d’autre, sinon en eux, au plus profond d’eux-mêmes le rayonnement mystérieux de la grâce de leur Seigneur.
Dans l’envoi de Jésus se dégage une perspective de réussite possible : « Si dans une maison, vous trouvez l’hospitalité, restez-y. » Mais l’éventualité d’un échec, – le non-accueil, la fermeture du cœur, l’obstination -, est aussi envisagée d’une manière réaliste. En ce cas, «… partez et secourez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » L’offre d’amour, la bonne nouvelle du Christ, ne peut se transmettre que dans la liberté.
Les envoyés, les missionnaires sont appelés à grandir en liberté, quelle que soit l’issue heureuse ou malheureuse de leur prédication. A l’image de leur maître, le Christ, rien ne pourra les ébranler dans leur évangélisation. Le petit bonhomme est toujours là… Il m’interpelle encore et encore:
Dessine-moi une église!
Les uns avec les autres, osons sortir de la page blanche, osons l’aventure. Osons donner de la couleur, du relief à ce dessin à esquisser jour après jour. Osons dessiner l’église de Jésus-Christ dans la chair de notre chair,
- une église prophétique,
- une église qui fait signe plus que nombre,
- une église qui n’est pas en surplomb détenant une vérité toute ficelée,
- une église humble qui marche au pas de la modernité,
- une église en sortie, qui n’a rien à vendre et rien à prouver,
- une église sans complexe et sans arrogance,
- une église envoyée aux périphéries qui porte un trésor infini, inouï dans des vases d’argile.
Je l’aime cette église et j’ai hâte d’y travailler, avec vous !
Amen
15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Lectures bibliques: Amos 7, 12-15 / Psaume 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14 / Éphésiens 1,3-14 / Marc 6, 7-13