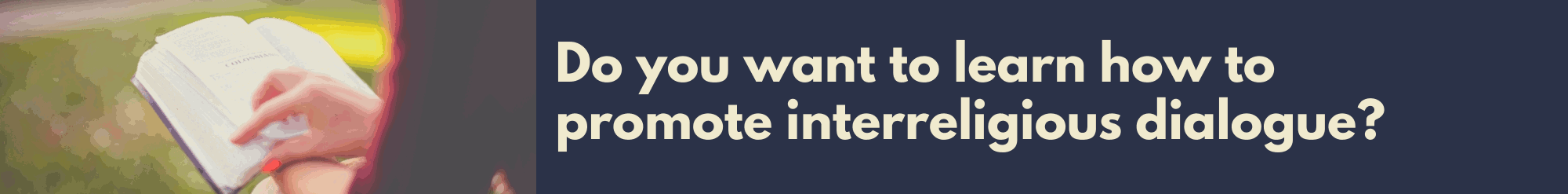
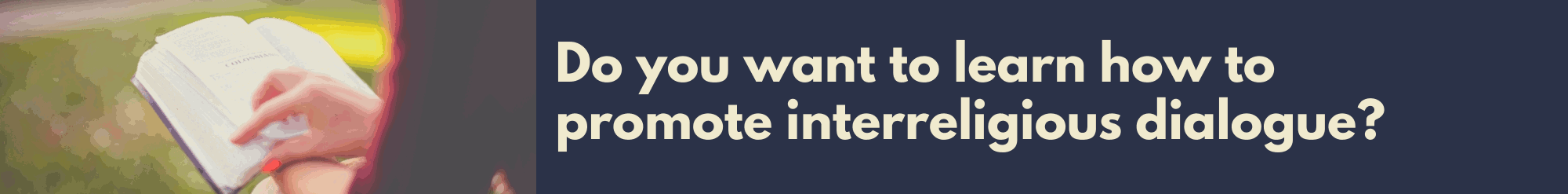

Homélie du 20 juin 2021 ( Mc 4, 35-41)
Dimanche des réfugiés
Jésus nous dit de passer sur l’autre rive. Aller de l’autre côté du lac… c’est une invitation au changement.
Il est facile aujourd’hui de penser avec cet Évangile à tous les migrants qui traversent la Méditerranée en quête d’une vie meilleure, mais ne pensons pas tout de suite à eux.
Tout d’abord il est important de se poser la question : changer pourquoi ?
Le risque est de ne pas bouger alors que notre monde s’en va ailleurs.
Parfois nous avons l’impression que l’Église reste immobile quand toute la société va d’un autre côté.
Comme première réponse on pourrait dire que changer, passer sur l’autre rive, peut être une tentative de suivre notre monde, notre humanité. Comme nous le dit assez souvent le pape une tentative pour rester avec nos brebis. Même si ce changement nous demande un effort et même d’affronter des difficultés.
Pour les Apôtres aussi ce n’était pas un voyage facile. Il s’agissait d’aller vers la région dite de la Décapole, c’est-à-dire vers des terres païennes que les Romains occupaient et qui dérangeaient aussi les bons Juifs parce qu’elles étaient des terres sans dieu, sans foi.
Invités à regarder plus loin
Passer sur l’autre rive, avec confiance, est une proposition pour nous tous !
Dans tous les changements de la vie nous sommes invités à regarder plus loin.
En italien : Aujourd’hui peut-être que nous sommes dans cette situation où nous n’avons pas envie de changer, parce que nous croyons qu’il y a déjà assez à faire, qu’il y a assez de difficultés. Peut-être que nous sommes d’excellents météorologues et nous avons déjà vu la tempête arriver… faisons confiance et regardons de quel côté de la barque se trouve Jésus. Appelons-le et prions-le ! qu’il nous donne confiance, courage et force pour vivre ces changements.
Prendre Jésus dans notre bateau
Pourquoi alors un tel voyage ?
Et en plus voilà qu’arrive aussi une tempête. Il y en a toujours dans nos vies. Exactement quand nous entreprenons un voyage difficile, quand nous nous dirigeons vers l’inconnu, on dirait presque qu’on a cherché les problèmes : voici la tempête ! Le passage, le changement, n’est jamais facile. Et il peut même être plus compliqué que prévu.
La condition pour faire ce voyage est de prendre Jésus dans notre bateau. Et de le prendre tel qu’il est : fatigué, endormi, mais il est là, il est présent ! il est avec nous.
Il peut nous arriver de vouloir choisir le Jésus dont nous avons besoin. De le manipuler pour qu’il fasse ce qu’il faut ! qu’il résolve les problèmes avant qu’ils arrivent.
Aujourd’hui j’aimerais remercier Dieu pour la tempête. Parce que s’il y a une tempête ça veut dire que nous avons osé, que nous sommes sortis de nos sécurités ; s’il y a une tempête ça veut dire qu’il y a de la vie, que nous sommes en vie et que nous ne nous laissons pas vivre! Ça veut dire que nous sommes en train de changer !
Dommage qu’il arrive souvent que nous accusions Jésus pour cette tempête. Les apôtres aussi le font : « cela ne te fait rien qu’on soit perdus ? ».
En réalité, Jésus est l’Emmanuel, il est « le Dieu avec nous » ! et voilà que sa Parole menace le vent et la mer ils se fit un grand calme.
Les migrants
Mais revenons au thème de cette journée : les migrants.
Ils ont traversé la mer, ils ont essayé de traverser la Méditerranée.
Beaucoup sont morts, torturés, étouffés, dans les vagues, ou par le froid ou par la fatigue.
Pensons que ces gens ne sont pas le problème : ces gens sont notre tempête !
Ces gens sont ceux qui nous poussent à entamer la quête d’un autre monde. Ces gens nous demandent de réfléchir à ce qu’est vraiment la justice, à faire basculer la logique que l’argent va vers l’argent et les riches seront toujours plus riches. Disons-le ouvertement : les riches c’est nous !
Ce qui est triste c’est que nous ne nous faisions aucun souci. Les disciples crient, ont peur, appellent Jésus. Aujourd’hui nous sommes déjà dans cette tempête, mais cela ne nous touche pas.
Prenons Jésus dans notre barque, acceptons de vivre des temps difficiles (désormais ils sont bien là), et commençons ce voyage… nous avons un grand chemin à parcourir, et n’oublions pas de prendre Jésus avec nous.
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – DIMANCHE DES MIGRANTS
Lectures bibliques : Job 38, 1.8-11; Psaume 106 (107) 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31; 2 Corinthiens 5, 14-17; Marc 4, 35-41
Aux États-Unis, Ed Litton n’est pas assez conservateur
L’Argovie inaugure son tronçon du « Sentier européen des huguenots »
Pakistan: état des lieux de la loi sur le blasphème

Homélie du 13 juin 2021 (Mc 4, 26-34)
Abbé Jean-Claude Dunand – Église N.-D. de l’Immaculée Conception, Nyon, VD
Quel geste fort que de se signer le front, la bouche et la poitrine avant la lecture de l’évangile. C’est se préparer à recevoir dans tout son être !
Dans cette lecture évangélique, Jésus cite deux paraboles pour nous parler du règne de Dieu. Il nous renvoie à l’expérience des gens qui travaillent la terre.
Faire confiance
Dès que l’agriculteur a jeté la semence en terre, un mystérieux processus commence. A l’œil nu, on ne voit rien mais la vie grandit. Une force intérieure permet à la semence de croître jusqu’à maturité. Si le ciel leur donne de l’eau et du soleil nécessaires, les arbres, les fleurs et les plantes pousseront et produiront.
Ce qui va advenir de la semence ne dépend pas, ou si peu, de l’agriculteur ou du jardinier. Il peut arroser, arracher les mauvaises herbes, mettre de l’engrais, mais il n’est pas le maître de ce qui se passe sous la terre. L’agriculteur doit faire confiance et laisser aller les choses d’elles-mêmes. A moins d’une catastrophe naturelle ou de conditions météo défavorables, il y aura une moisson à récolter. Peut-être modeste, peut-être exceptionnelle…
La croissance est l’œuvre de Dieu
Et que dire du règne de Dieu ? Il va grandir comme le blé qui surgit de la terre. C’est le Christ qui sème ce champ par nous. Nous recevons de lui la « graine évangélique », sa parole, et nous la transmettons. Le dynamisme de cette semence est entre les mains de Dieu et de sa grâce. Nous ne voyons pas nécessairement son action et nous pensons bien souvent que ces semences se perdent dans le grand champ des informations et des opinions de toutes sortes.
Beaucoup se découragent ayant de la peine à observer des germinations : où sont les enfants qui ont fait leur Première Communion, les jeunes leur confirmation, les couples qui ont reçu le sacrement du mariage, où sont les enfants et les familles, tant d’enfants en catéchèse ?
Avons-nous de bonnes semences ?
Et pourtant, des graines germent et grandissent un peu partout !
Mais la croissance, c’est l’œuvre de Dieu ! C’est lui qui donne la foi ! Alors, pourquoi nous inquiéter ? Faisons-lui confiance. La Parole fait son chemin en toute discrétion. Le règne de Dieu, secrètement, lève dans les cœurs, et il s’étend un peu partout. Comme l’agriculteur, nous n’avons pas la maîtrise de la croissance. Nous ne sommes pas les patrons de ce qui se passe dans le cœur de la personne qui reçoit la Parole.
L’avenir est plein de promesses
La « graine évangélique » semée en chaque humain possède en elle la force nécessaire pour se développer. Dieu travaille de façon cachée dans le champ où elle est semée. Et c’est une affaire de mûrissement, et parfois de longue, très longue maturité.
Rappelons-nous le début de l’Église : tout a commencé avec un enfant dans le dénuement d’une étable, qui est devenu un itinérant n’ayant pas d’endroit où reposer la tête, un humble prédicateur qui connaîtra du succès, mais finalement arrêté et jugé, il mourra sur une croix. Et tout cela a engendré une Église présente dans le monde, composée depuis de centaines de millions de croyants et croyantes de toutes nationalités. D’une humble graine est né un grand arbre. N’est-ce pas encourageant pour notre foi ? Les deux paraboles de ce dimanche nous incitent à l’ardeur et à la persévérance dans l’annonce de l’Évangile : l’avenir est plein de promesses. Faisons confiance à Dieu : le développement du Royaume est entre de bonnes mains. Occupons-nous de labourer et des semailles et laissons à Dieu le soin de l’impossible.
Même si la croissance est indépendante de notre volonté et de notre action, Dieu veut compter sur notre participation. Tout comme la terre ne peut produire de fruits si l’agriculteur ne l’ensemence, nous avons la mission de jeter en terre humaine la graine, d’annoncer la Parole à tout être humain. Faisons-le humblement, comme Jésus, en n’oubliant pas que lui aussi n’a pas converti tous ses contemporains.
Accueillons déjà pour soi la Parole. Préparons la terre… et ensemençons-là par notre témoignage car la Parole ne se sème pas seulement avec des mots : Jésus nous en a donné l’exemple.
Semons, mais pas dans le but que les graines produisent les fruits que nous voudrions, comme remplir nos églises. Semons pour que le monde devienne meilleur.
Semons avec patience : la graine ne produira pas instantanément.
Semons large : le règne de Dieu est une réalité ouverte à tous et à toutes.
Les semences sont petites, mais pleines d’avenir !
11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Ézéchiel 17, 22-24; Psaume 91, 2-3.13-14.15-16; 2 Corinthiens 5, 6-10; Marc 4, 26-34
Un fondamentaliste pourrait diriger l’Irlande du Nord
De l’Inde à la Terre sainte: l’étrange odyssée d’une minorité juive
L’Eglise catholique menacée par le pouvoir hong-kongais

Homélie du 6 juin 2021 (Mc 3, 20-36)
Chanoine Roland Jaquenoud – Abbaye de Saint-Maurice
« Il a perdu la tête ». L’évangile nous parle d’un moment de crise. Jésus a vécu jusqu’à 30 ans « de manière cachée ». A la maison sans doute, dans sa famille. Et célibataire en plus, ce qui à l’époque devait être tout-à-fait exceptionnel. Donc pendant trente ans, il n’a pas fait parler de lui. Et puis tout à coup, tout change. Il se met à proclamer la conversion et la foi en la bonne nouvelle. Il se met à guérir des malades, à chasser des démons. Les foules commencent à le suivre. Il fait beaucoup de bien. Mais voilà tout à coup que quelque chose cloche.
Jésus ne se contente pas de prêcher et de guérir. Il se met à fréquenter les pécheurs. Et des pécheurs notoires. Au chapitre 2 de saint Marc, il a appelé Lévi à le suivre. Lévi, le publicain, celui qui collecte des impôts au service de l’occupant romain, sur le dos de son peuple, des ses coreligionnaires, le traitre, le persécuteur. Un personnage peu recommandable, peu sympathique, presque détestable. Non content de l’appeler à le suivre, Jésus en fait un Apôtre, celui qu’on appellera saint Matthieu. Mathieu – Lévi, qui pour le moment n’est pas encore saint, fait fréquenter à Jésus les gens qu’il connaît : des gens peu fréquentables, le rebut de la société. Et voilà que Jésus mange et boit avec eux – L’horreur ! Et puis, on peut se demander s’il est bien en accord avec la loi de Moïse : il se met à faire des guérisons le jour du sabbat, ce qui est strictement interdit. Six jours pour faire des miracles ne lui suffisent pas ? Il faut aussi qu’il enfreigne le repos sacré du Sabbat ? C’en est trop. La page d’évangile que nous avons entendu aujourd’hui, qui est issue du chapitre 3 de saint Marc, reprend l’histoire justement au moment où tout cela devient insupportable, tant aux proches de Jésus, qui tentent de le saisir, qu’à l’establishment religieux du temps, les scribes, qui accusent Jésus d’être possédé par Béelzéboul, le chef des démons.
Le blasphème contre l’Esprit Saint
Et c’est dans ce contexte que Jésus prononce les paroles qui sont sans doute les plus dures de tout son ministère :
« Amen je vous le dis : tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’y aura jamais de pardon. Il est coupable pour toujours. »
Il y en a eu, des commentaires, sur ce péché impardonnable, sur ce blasphème contre l’Esprit Saint. De quoi s’agit-il au juste ?
On a expliqué que ce péché était le refus absolu et conscient de croire en Jésus. Peut-être, mais essayons de cerner notre texte au plus près.
On y voit un balancement, une opposition, entre péchés et blasphèmes d’une part, qui seront tous pardonnés, et qui nous ramènent directement à ces abominables pécheurs, genre Lévi, que Jésus s’est mis à fréquenter, et le blasphème contre le Saint Esprit d’autre part, qui, si on lit bien notre texte, désigne ceux qui accusent Jésus de faire du bien au nom de Béelzéboul, le prince du mal. Cette accusation est proférée par … les scribes, c’est-à-dire par l’establishment religieux de l’époque.
Et voilà que les gens « biens », les scribes, ceux qui lisent et connaissent l’Écriture, qui vont régulièrement au temple, deviennent impardonnables, tandis que les pécheurs et les blasphémateurs se voient promettre le pardon. Révolution totale.
Mes frères, mes sœurs, comme souvent, l’Évangile veut nous mettre en garde, nous, les croyants. Nous, pas les autres. Nous qui connaissons l’Écriture et qui prétendons savoir ce qui est bien et ce qui est mal, nous qui jugeons les autres au nom de celui qui a dit « ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ».
Et si le péché contre le Saint-Esprit, c’était cela cela : ne pas laisser Jésus aller vers celui que nous jugeons perdu, irrécupérable, abominable, justement parce que nous nous fermons à ce frère, à cette sœur en humanité, au nom de nos principes, de nos valeurs, parfois même de nos « valeurs chrétiennes » ?
Bien sûr, jamais nous ne nous permettrons de traiter Jésus de suppôt de Béelzéboul, nous sommes trop bons chrétiens pour cela. Loin de nous une telle pensée ! Mais n’avons-nous pas tendance à voir le diable là où Jésus ne voit que personnes à rejoindre, à aimer, à consoler, à guérir ? Nous ne nous rendons même plus compte que nous sommes, nous aussi, des personnes à rejoindre, à aimer, à consoler, à guérir.
Un devoir : faire la volonté de Dieu
Tout à l’heure, à la fin de l’Evangile, nous avons entendu comment la famille de Jésus, au nom de ses droits naturels, a tenté de s’en accaparer. « Ta mère et tes frères sont là. Ils te cherchent ». Nous avons aussi entendu la réponse de Jésus, cinglante : « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ».
Personne n’a de droit sur Jésus, ni sa famille naturelle, ni la famille spirituelle, mystique, que nous sommes, nous, les baptisés. Etre de sa famille ne nous donne aucun droit sur lui. Par contre, cela nous donne un devoir : faire la volonté de Dieu. Or, selon saint Jean, comme selon saint Paul, la volonté de Dieu se résume tout entière dans l’amour du prochain. Dans l’amour du prochain, non dans la défense de prétendues valeurs, souvent prétexte d’actes et de jugements dont on ne voit plus très bien ce qu’ils ont à voir avec l’amour.
Chers frères et sœurs, la Parole de ce jour est dure. Mais comme toute parole dure, elle n’a qu’un rôle : essayer de nous faire sortir de notre zone de confort, cette zone de confort que l’on peut cultiver même dans la foi. Nous avons besoin d’être renouvelés en profondeur. Nous avons besoin d’être convertis. Laissons-nous faire. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, entendue tout à l’heure, saint Paul nous disait « Nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Jésus est mort et ressuscité pour cela. Laissons-le nos renouveler, même en nous adressant parfois des paroles dures. Amen.
10e dimanche du temps ordinaire
Lectures bibliques : Genèse 3, 9-15; Psaume 129; 2 Corinthiens 4, 13 – 5,1; Marc 3, 20-36


