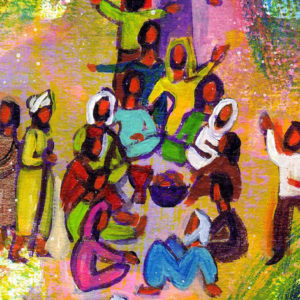
Homélie du 25 août 2019 (Lc 13, 22-30)
Mgr Charles Morerod – Basilique Notre-Dame, Lausanne
Il y a des textes de l’Evangile qu’on écoute plus volontiers que d’autres, il y en a qui nous rassurent, d’autres qui nous dérangent et nous inquiètent, et nous avons bien sûr tous tendance à mettre l’accent sur ceux que nous préférons. Pas seulement cela, mais aussi à se dire – et là je pense surtout à des générations qui précèdent la mienne : « On nous a trop éduqués par la peur, on nous a traumatisés. Maintenant je suis heureux – moi aussi d’ailleurs mais il faut comprendre comment – d’avoir un Dieu qui nous aime ». Et puis on se demande ce que signifie « juger » pour Dieu.
Dieu veut que nous soyons avec lui
En fait, pour voir l’Evangile, il faut le prendre tout entier et quand on entend un texte comme celui-là, « la porte est étroite », « beaucoup d’invités, peu d’élus », rappelons-nous plusieurs choses en même temps : d’abord, Jésus nous dit par ailleurs que la porte, c’est lui. Regardons son attitude vis-à-vis de nous. Il nous dit aussi que si on est avec lui, son joug est léger car il le porte avec nous. Et puis, finalement, on voit que si certains ne viennent pas, il en appelle d’autres. Ce n’est pas dit dans l’évangile d’aujourd’hui, ça l’est dans d’autres, mais on l’entend dans la première lecture, dans l’Ancient Testament (Isaïe) ; Dieu, connaissant leurs actions et leurs pensées, dit que si on ne veut pas le suivre il en invitera d’autres : « Je vais rassembler toutes les nations de toutes langues ». Il ajoute même : « Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux ». Or pour être prêtre et lévite, il fallait appartenir à la famille, au clan de Lévi ; mais Dieu dépassera cette limite. En d’autres termes :« Si vous ne voulez pas être avec moi, j’irai en prendre ailleurs ». Il y a là un grand signe d’espérance qui nous montre une chose : C’est que Dieu veut que nous soyons avec lui. Mais comment ?
On peut poser la question de ce comment en disant : « Pourquoi est-ce que Dieu nous a faits ? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu’il y ait des êtres à son image et à sa ressemblance ? Et qu’est-ce que cela dit à propos de Dieu lui-même ? » Il n’a pas besoin de nous. Il pourrait ne pas nous créer. S’il nous crée, c’est parce qu’il veut que nous soyons heureux en étant avec lui. Comme Dieu est bon et qu’il aime, il veut faire partager à d’autres – et nous y sommes invités – la joie de son amour. Ça, c’est un signe fondamental d’espérance. S’il ne voulait pas cela, il ne prendrait pas la peine de nous faire.
Mais ensuite, qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Qu’est-ce que cela signifie, aimer Dieu, aimer Dieu pour lui-même et répondre à son amour ? Il y a une image de l’amour qui est, je pense, un bon exemple de ce qu’il faut éviter. Vous savez peut-être qu’on peut faire des robots domestiques qui tiennent compagnie à des gens. Ces robots peuvent avoir forme humaine ou d’un chien ou d’un chat. Ils ont été bien programmés pour, avec leurs capteurs, voir d’abord les signes faciaux de la personne en face, interpréter, grâce à leurs programmes, comment va cette personne et puis, toujours selon leurs programmes, répondre à l’autre d’une manière qui va lui faire plaisir. C’est une illusion, mais ça peut marcher. D’ailleurs c’est une compagnie d’autant plus agréable qu’on peut la programmer un peu autrement ou bien la débrancher quand on part en vacances. C’est donc une espèce de réponse automatique programmée qui n’implique, de la part de ce robot, absolument aucune liberté et aucun choix. Il n’en a pas besoin. Il est dirigé par ses programmes. Est-ce que c’est ainsi qu’est Dieu ? Et est-ce qu’il veut que nous – image et ressemblance de lui-même – nous soyons cela ? En d’autres termes veut-il que, de toute façon au bout du compte, comme il nous a programmés, nous soyons avec lui, indépendamment de ce que pourrions souhaiter ? Est-ce que c’est ça notre idéal humain et, si j’ose dire, notre idéal divin ? Ce programme automatique est-il de l’amour ?
Pas d’amour sans liberté
En fait Dieu sait – et sait mieux que nous – qu’il n’y a pas d’amour sans liberté. Et qu’on peut lui répondre ou ne pas lui répondre. Qu’on peut lui répondre « oui » ou lui répondre « tu ne m’intéresses pas » ou lui répondre « je ne veux pas être avec toi ». Et qu’on peut ensuite changer, bien sûr, durant cette vie. Heureusement que Dieu est ainsi. Mais cela implique bien sûr que nous puissions lui dire « non ». Et cette possibilité de dire « non » est fondamentale. Et en plus – on peut l’observer un peu : quand on voit comment Jésus s’adresse à nous après notre mort (ça on le voit dans un autre texte qu’on appelle le Jugement dernier), on voit que tout le monde est surpris parce qu’à certains, il dit, un peu comme dans l’Evangile d’aujourd’hui :
- « Tu n’étais pas avec moi ».
- « Mais oui, j’étais avec toi ».
- « En fait, non. J’avais soif, tu ne m’as pas donné à boire ».
A d’autres il dit :
- « Tu étais avec moi ».
- « Mais quand est-ce que j’étais avec toi ? ».
- « J’avais soif, tu m’as donné à boire ».
Je reste marqué par une expérience que j’ai faite où, alors que je m’étais perdu après avoir longuement couru et marché dans un endroit très chaud qui n’était pas la Suisse, de rencontrer finalement une serveuse de restaurant qui servait le petit déjeuner à des lève-tard et qui, quand je lui ai demandé mon chemin, m’a offert une bouteille d’eau et m’a accompagné pour que je voie où je devais aller. Elle m’a donné à boire et elle a fait deux mille pas avec moi alors que je lui en demandais mille. Je me suis dit : « Elle vit l’Evangile. Est-ce qu’elle le sait ? » Peut-être pas. Mais c’est aussi là qu’on répond à Dieu. Et si nous en sommes conscients, si nous connaissons l’Evangile, eh bien prenons-le au sérieux. Souvenons-nous de ce que le Seigneur nous dit : « Comment vous êtes avec moi ? Eh bien suivez-moi, écoutez-moi et regardez ceux qui sont autour de vous. Comme vous les traiterez, vous me traiterez moi-même ».
Il n’y a pas très longtemps, j’ai entendu une histoire magnifique que je garde dans la discrétion. Quelqu’un m’a dit : « J’ai vu devant la porte d’une église un homme complètement désemparé loin de chez lui et je me suis senti obligé à retourner vers lui et à rester, et finalement même à lui trouver un endroit où passer la nuit. Et quand je l’ai quitté, je l’ai vu complètement transformé et je me suis dit : Je ne savais pas, maintenant je suis devant le Seigneur ».
Voilà comment Dieu nous invite à utiliser notre liberté en suivant ses impulsions. Si nous croyons que le Christ est la porte et que ce qui est impossible pour nous n’est pas impossible pour Dieu, eh bien, disons-lui simplement :
« Ce qui me semblerait être la porte large et facile, c’est de tout diriger moi-même, toute ma vie, celle des autres peut-être, mais c’est une illusion. Seigneur, c’est toi la porte. Cette porte me semble étroite. Je sais que ton joug est léger. Aide-moi, que j’en sois conscient ou non – car toi tu le peux – à être avec toi. Et je sais que si je suis avec toi, toi qui nous aimes et qui m’aides à t’aimer librement, eh bien ce sera vraiment une bonne nouvelle pour le monde. Car le monde a besoin d’avoir des disciples du Christ, qui choisissent cette porte étroite qui implique aussi même d’aimer nos ennemis et de leur pardonner. ».
Beaucoup de disciples du Christ qui est la porte étroite et dont le joug est léger, c’est la Bonne Nouvelle.
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lectures bibliques : Isaïe 66, 18-21; Psaume 116, 1, 2; Hébreux 12, 5-7.11-13; Luc 13, 22-30

Bel et bon
Les chrétiens de Hong Kong contre Pékin
Mariage homosexuel et Église protestante: l’analyse de Michel Kocher

Quand on a tout perdu, une vie nouvelle devient possible
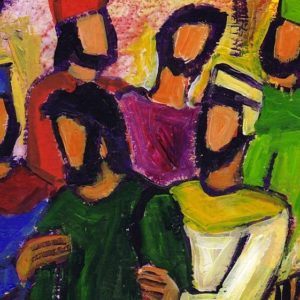
Homélie du 18 août 2019 (Lc 12, 49-53)
Chanoine Frédéric Gaillard, diacre – Hospice du Grand-Saint-Bernard, VS
Il était une fois une personne qui eut un songe.
Elle était au bord de l’océan avec le Seigneur sur une grande plage du Brésil.
Des pas dans le sable représentaient toute sa vie passée. Souvent il y avait deux paires de traces (les siennes et celles du Seigneur)… parfois une seule paire de traces !
Alors cette personne qui songeait se tourna vers le Seigneur et l’interpella :
« Tu vois Seigneur, chaque fois que j’avais des gros coups durs, des difficultés… quand j’étais au fond du trou, abandonné, tu étais absent ; j’étais seul, livré à moi-même ! » Le Seigneur répondit : « Quand c’était trop difficile, quand tu étais au fond du trou, je te portais. »
Au fond du trou
Chers frères et sœurs présents dans cette église du Grand-Saint-Bernard, chers auditrices et auditeurs de cœur et d’esprit en lien avec nous ici-haut par la magie des ondes, combien de fois n’avons-nous pas fait l’expérience d’être abandonnés du Seigneur quand nous étions au fond du trou !
A l’exemple du prophète Jérémie (dans la 1ère lecture) qui fut jeté dans la citerne, combien de malades, de déprimés, de prisonniers se sentent parfois complètement abandonnés de tous, seuls, sans moyen de s’en sortir, désespérés.
La Bonne Nouvelle d’aujourd’hui nous invite à garder l’espérance.
Cette lecture de Jérémie, je la mets volontiers en lien avec l’épisode dans la Genèse où Joseph fut jeté aussi dans une citerne par ses frères ! Vous connaissez la suite ?… Il fut vendu comme esclave puis devint « le sauveur » de ses frères !
Jésus est venu habiter la souffrance de sa Présence
Mais je voudrais partager un peu plus aujourd’hui sur JÉSUS, le Sauveur par excellence. IL vient de Dieu et retourne à Dieu. Jésus a pris chair de la Vierge Marie. Il est venu parmi nous. Il a fait sûrement beaucoup de miracles, il a guéri bien des personnes, il a consolé bien des gens tristes mais il n’est pas venu supprimer toutes les souffrances. Il n’est pas venu expliquer la souffrance mais il est venu l’habiter de SA Présence.
Oui Jésus a passé aussi par la souffrance, le sentiment d’être abandonné. Au fond du trou, sur la Croix, n’a t-il pas crié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Mais la foi chrétienne ne s’arrête pas là : après la croix, il y a la Résurrection !
Passer de la mort à la vie en Christ
C’est ce que nous célébrons dans chaque sacrement : le Christ Ressuscité.
Tous les sacrements pourraient être commentés, mais aujourd’hui je ne parlerai seulement que sur celui du Baptême.
Le baptisé passe à la suite du Christ de la Mort à la Vie par la Croix.
Le Baptême signifie que toute vie humaine vient de Dieu et retourne à Dieu par la Mort et la Résurrection du Christ Sauveur !
La prière chrétienne
C’est le même mouvement aussi dans la prière chrétienne : elle vient de Dieu et retourne à Dieu.
Trop longtemps j’ai cru que la prière vient de l’homme, informe Dieu et revient sur l’homme : non, non, non.
Écoutons le cœur du Psaume 39 entendu aujourd’hui : « Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. »
Oui ! La prière chrétienne vient de Dieu et retourne à Dieu… en passant par le cœur et la vie du priant pour le transformer petit à petit.
Mais sachons que si je chute, si je suis au fond du trou, le Seigneur est là pour m’aider à me relever. Le plus important dans la vie chrétienne n’est donc pas de ne pas tomber, de ne pas faire d’erreur, de ne pas douter… mais de se relever et de se laisser relever en Ressuscité.
20ème dimanche du Temps Ordinaire
Lectures bibliques : Jérémie 38, 4-6.8-10; Psaume 39, 2, 3, 4, 18; Hébreux 12, 1-4; Luc 12, 49-53

Evangile de dimanche: Embrasons le monde!

Homélie TV du 15 août 2019 (Lc 1, 39-56)
Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay – Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation
Mère aimante, Marie veille sur ses enfants
Dans la salutation de Marie à Elisabeth, le Salut est annoncé à tous et à toutes les générations futures ! Le Salut, qui a pris corps en Marie enceinte de l’enfant Jésus, vient à la lumière quand ces deux femmes se saluent mutuellement : « lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. » (Lc 1, 44) Elisabeth, remplie de l’Esprit Saint, reconnaît la venue du Sauveur tant attendu : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 43).
Dans le mystère de l’Incarnation, Dieu vient à la rencontre de notre humanité et le premier geste de celle, par qui se réalise ce projet de Dieu, est d’aller à la rencontre de cette autre femme, âgée, enceinte de celui qui désignera le Sauveur à tous, Jean-Baptiste. Ainsi, dans l’évangile de Luc, commence l’annonce du Salut à travers le simple geste d’une salutation : le Salut commence déjà quand nous saluons l’autre dans ce qu’il est. Marie vient au-devant de chacun de nous pour annoncer que Dieu réalise sa promesse : « Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » (Lc 1, 54-55). Comme une mère aimante, apportant une bonne nouvelle à ses enfants, Marie annonce à tous l’amour de Dieu, manifesté en Jésus.
Marie au milieu de tous
Souvent dans les grands sanctuaires comme celui du Puy, où depuis plus de quinze siècles des foules de pèlerins viennent prier la Vierge noire, il semble au premier abord que c’est nous qui venons à Marie. Mais il n’en est pas ainsi, c’est elle qui vient à notre rencontre, c’est elle qui, comme avec Elisabeth, vient nous annoncer les merveilles que Dieu accomplit en son Fils, c’est elle qui nous dit, comme aux noces de Cana : « Faites tout ce qu’il dira. » (Jn 2,5). Ainsi, le moment fort de la fête de l’Assomption, c’est lorsque la statue de la Vierge sort de la cathédrale pour aller, en procession, dans les rues du Puy à la rencontre de la foule venue la célébrer et la prier. C’est une manière simple et belle de signifier Marie au milieu des gens, Marie avec tous, Marie avec ceux qui croient et ceux qui doutent, Marie à la rencontre des plus petits et des malades en fauteuil roulant qui l’attendent, à l’ombre, au coin d’une rue. Marie n’est pas une mère distante qu’on ne peut approcher, elle nous est donnée par son propre Fils pour qu’elle devienne notre mère. Comme le rappelle le pape François dans sa récente lettre aux jeunes, Marie « est aujourd’hui la Mère qui veille sur ses enfants, sur nous ses enfants qui marchent dans la vie souvent fatigués, démunis, mais souhaitant que la lumière de l’espérance ne s’éteigne pas.»
L’Assomption est une joyeuse prophétie
« Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.» (Lc 1, 48-49) Si Marie, à l’aube du Salut, annonce les merveilles de Dieu, la fête de son assomption auprès de Dieu nous entraîne à percevoir la plénitude définitive du Salut dans laquelle elle est entrée et à laquelle nous sommes appelés. Marie est la première des disciples et, comme une mère aimante, elle nous donne une image de notre avenir et de la réalisation de la promesse de Dieu. L’Assomption de Marie est une grande et joyeuse prophétie : le chemin qu’elle a ouvert est celui de tous ceux qui croient à l’accomplissement des paroles qui leur sont dites de la part du Seigneur. L’Assomption manifeste ainsi la volonté de Dieu d’associer l’humanité à la Pâque du Fils bien-aimé pour que nous entrions, à sa suite, dans la vie éternelle.
Marie, modèle de l’Eglise
Le mystère de Marie et celui de l’Église sont étroitement liés l’un à l’autre et on ne peut saisir l’un sans accueillir l’autre. La figure de Marie, mère aimante, est ainsi le modèle de l’Eglise. « L’Église aime tous ses enfants, mais elle s’occupe et soigne avec une affection toute particulière ceux qui sont les plus petits et sans défense : il s’agit d’un devoir que le Christ lui-même confie à toute la communauté chrétienne dans son ensemble. » nous dit le pape François. Le Cantique de Marie, que nous aimons si souvent chanter, proclame : « Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés… » (Lc 1, 51-53) Mais ces mots résonnent de manière insistante et grave, en cette période où la vie de l’Eglise est traversée par une grave crise : des petits et des humbles y ont été abusés. Alors le chant de Marie fait retentir dans l’Eglise « la douleur des victimes d’abus, qui est une plainte qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a été ignorée, silencieuse ou passé sous silence » comme le souligne le pape François. Aussi, plus que jamais, l’Eglise doit trouver le chemin qu’elle ne doit jamais quitter pour être, à la suite de Marie, mère aimante, attentive aux plus petits, aux plus faibles, aux humbles qui ont une place toute exceptionnelle dans le cœur de Dieu.
Marie, mère aimante, nous montre la route pour devenir des disciples missionnaires, porteurs de la Bonne Nouvelle, et témoins de l’espérance. Demandons à Notre-Dame du Puy de nous accompagner dans notre vie chrétienne pour que nous sachions, comme elle, accueillir la force de l’Esprit Saint pour laisser vivre le Christ en nous, à la gloire du Père ! Amen.
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Lectures bibliques : Apocalypse 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab; Psaume 44, 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16; 1 Corinthiens 15, 20-27a; Luc 1, 39-56


