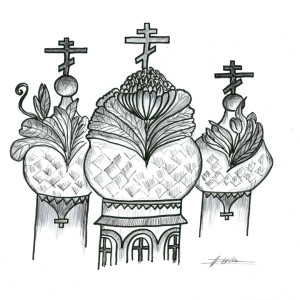Homélie TV du 28 février 2016 (Lc 13, 1-9)
Abbé Flavio Gritti, mission italienne – Notre-Dame de l’Assomption, Le Locle
… Matteo, Sarah, Noémie, Alberto,
Richard, Carlos, Gregory, Noah, …
Est-ce que quelqu’un s’est senti interpellé ?
Est-ce que j’ai réveillé quelqu’un ?
ou bien je vous ai dérangé dans vos pensées?
…
C’est l’effet d’entendre son nom !
Quand on nous appelle, nous avons besoin de répondre !
En effet, nous tous avons un nom…
et c’est la belle découverte que Moïse fait dans le texte
que la liturgie nous propose aujourd’hui: même Dieu a un nom!
A cette époque, on n’avait pas le droit
de s’adresser à Dieu comme à un ami,
il est Dieu; pas un pote comme les autres.
Son nom était imprononçable !
Il était tout simplement le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob,
il était le Tout-Puissant.
Le privilège de Moïse a été celui de recevoir en premier
le Nom de Dieu: un nom qui est sacré.
« Même Dieu a un nom! »
Alors ce mystère du nom de Dieu est intéressant même pour nous,
même aujourd’hui !
Il s’agit du verbe être, conjugué dans une forme
qui est assez étrange pour nous occidentaux !
Ce verbe est au même temps: passé, présent et futur.
Vu comme ça, ça ne veut rien dire,
mais il nous ouvre à l’éternité de Dieu.
Moïse a la responsabilité de connaître Dieu…
de vivre une relation personnelle avec Lui.
Dieu est là… pour le peuple, pour nous.
A partir de ce moment, toute l’humanité a la possibilité
de communiquer avec Dieu.
Il nous offre l’opportunité de parler avec lui,
de le sentir présent à nos cotés !
Dans ce parcours de carême, nous sommes invités à Le chercher,
tout en sachant qu’il est disponible et veut se faire trouver.
Comme Moïse, osons demander à Dieu:
T’es qui ? Comment tu t’appelles ?
Ai-je le droit de te parler ? Tu m’écoutes ?
Se préparer à vivre une rencontre vrai et réelle avec Jésus
lors de la Pâque, nous invite à redécouvrir son visage,
un visage qui a surmonté la mort et qui,
à travers la résurrection de Jésus, nous ouvre à l’éternité de Dieu.
Nous n’avons pas reçu son nom, mais nous avons vu son visage,
le visage du Christ.
Est-ce que nous le connaissons vraiment ?
Le Carême : voici le temps favorable pour nous approcher de Lui.
Dans l’Evangile aussi, Jésus veut nous présenter ce visage.
Il est le visage de celui qui donne le temps pour se réconcilier…
comme nous dirait le pape cette année:
il nous montre le visage de la miséricorde.
Et tout ça est encore plus fort,
par rapport à ce que Moïse a vécu !
(Italien) :
Ma in questo percorso,
noi come comunità siamo invitati
a scoprire e riscoprire che l’identità stessa di Dio
è quella della misericordia, quella dell’amore.
Quella di colui che ci da il tempo di riconciliarci con lui.
Quante volte fatichiamo a uscire dalla nostra sterilità,
a uscire dai nostri vizi, dai nostri problemi…
quante volte abbiamo bisogno di uno stimolo
in più per prenderci in mano e camminare una strada migliore.
Quante volte la vita stessa ci mette di fronte
a delle difficoltà che ci obbligano
a cambiare passo nel nostro cammino.
Questo è il tempo quaresimale.
Lo sguardo della gente che esprime un giudizio,
che cerca un senso per le disgrazie del tempo presente,
vede il castigo e la punizione
ma si dimentica che il Signore offre ancora del tempo,
il tempo necessario per vivere
un’altra stagione della vita che ci permetta di “portare frutto”.
Siamo quotidianamente in questo tempo.
Siamo avvolti in questa grazia
e non è a caso se nella nostra sapienza
diciamo che finché vita c’è speranza… perché è vero.
Finché il Signore ci offre del tempo possiamo camminare,
possiamo crescere, possiamo maturare,
possiamo AVVICINARCI A LUI.
Allora non fermiamoci,
non diciamo semplicemente è stato sempre così…
oppure, le cose non cambiano mai, o…
non dipende solo da noi… ecc.
Recuperiamo un po’ di entusiasmo
per prendere in mano la nostra vita
e per andare con un passo più deciso
alla scoperta di questo volto di Dio.
Il tempo della quaresima ci propone di guardare avanti,
e di scoprire che alla fine della quaresima c’è una croce,
segno del suo amore,
ma che il cammino continua verso una tomba vuota.
Anche lì non c’è stata una parola ultima…
il tempo ha dato ragione alla speranza del Figlio
nel progetto del Padre… e… anche noi siamo Figli!
Traduction :
Dans ce parcours de Carême,
en tant que communauté, nous sont invités
à découvrir et à redécouvrir l’identité de Dieu
est celle de la miséricorde, de l’amour.
Celle de celui qui nous donne le temps de se réconcilier avec lui.
Combien de fois nous nous efforçons de sortir de notre infertilité,
de sortir de nos vices, nos problèmes …
combien de fois avons-nous besoin d’un stimulus
pour se prendre en main et réorienter notre chemin.
Combien de fois la vie nous confronte
à des difficultés qui nous forcent
à un changement radical.
C’est cela le temps du Carême.
« Une saison de la vie, qui nous permet de porter du fruit »
Les regard des gens qui expriment un jugement,
qui recherchent d’un moyen d’expliquer le malheur,
Ils voient le châtiment et la punition
mais ils oublient que le Seigneur offre plus de temps,
Un temps nécessaire de vivre
une autre saison de la vie,
qui nous permette de porter du fruit.
Nous sommes toujours dans ce moment.
Nous sommes enveloppés dans cette grâce
et ce n’est pas un hasard si, dans notre langage
nous disons que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir … car c’est vrai.
Tant que le Seigneur nous donne ce temps, nous pouvons cheminer,
nous pouvons grandir, nous pouvons mûrir,
Nous pouvons nous approcher de lui.
Donc, ne nous arrêtons pas,
ne disons pas simplement: il a toujours été ainsi …
ou bien: les choses ne changent jamais, ou …
ça ne dépend pas que de nous … etc.
Retrouvons un peu l’enthousiasme
Afin de prendre le contrôle de nos vies
et aller d’un pas plus ferme
à la découverte du visage de Dieu.
Le temps du Carême nous offre la possibilité de regarder droit devant,
et de découvrir à la fin du carême, il y a une croix,
le signe de son amour,
mais que le voyage se poursuit vers un tombeau vide.
Là non plus, il n’y a pas eu de dernier mot.
Le temps a donné raison à l’espérance du Fils
dans le projet du Père et nous aussi, nous sommes Fils !
3e dimanche du Carême
Lectures bibliques : Exode 3,1-15 ; Psaume 102; 1 Corinthiens 10,1-6.10-12; Luc 13,1-9

Homélie du 28 février 2016 (Lc 13, 1-9)
Abbé J. J. Lafargue – église St-Nicolas de Myre, Hérémence VS
SI TON DIEU EXISTAIT VRAIMENT, Y’AURAIT PAS TOUTES CES GUERRES DANS LE MONDE…
Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase, chers Amis.
C’est la phrase-type que les gens sans arguments opposent au croyants.
« Si ton Dieu existait vraiment, y aurait pas toutes ces guerres dans le monde ! »
C’est exactement comme d’aller trouver un enfant qui vient de tomber en s’écorchant le genou, et de lui dire : « Si ton père existait vraiment, tu ne serais pas tombé. »
On est au niveau zéro de la réflexion, là, faudrait peut-être le rappeler un jour à ces gens qui nous disent « S’il existait vraiment, ton Dieu… » C’est à côté de la plaque.
Nous, les Chrétiens, nous croyons en un Dieu-Père. Ce n’est pas un Superman, un père. Ça c’est ce que l’on croit quand on a trois ans.
Un père, ce n’est pas quelqu’un qui télécommande la vie de son fils pour qu’il ne lui arrive strictement rien. Les parents, dans cette assemblée, savent très bien qu’ils font tout leur possible pour leurs enfants, mais qu’ils sont absolument incapable de leur empêcher tout mal. Un Dieu-Père ne peut empêcher son enfant de faire le mal ou de le subir. Nous sommes libres…
Un père, en revanche, tout comme une mère, SOUHAITE qu’il n’arrive rien de mal à son enfant, et il va essayer de lui offrir les meilleures conditions, lui donner une éducation, lui apprendre une éthique. C’est ce que Dieu fait avec nous. Il nous a donné des commandements, à nous de choisir.
Si l’enfant, devenu ado, passe son temps à faire l’inverse de ce que ses parents lui ont appris, forcément il risque de lui arriver des bricoles.
Or, vis-à-vis de Dieu, nous sommes souvent des ados, chers Amis. Nous passons notre temps à faire tout le contraire de ce que la religion nous avait patiemment appris, et ensuite on s’étonne que le monde n’aille pas très bien ! Exactement comme un ado qui n’a pas étudié pour son examen et qui revient en disant : « C’est dégueulasse, on m’a interrogé sur le seul sujet que j’avais pas bien étudié ! »
« Se demander ce que nous pouvons faire pour Dieu »
Faut peut-être un jour devenir adulte, y compris dans la Foi. Ça veut dire se demander ce que nous pouvons faire pour Dieu plutôt que de se lamenter sur ce que nous croyons que Dieu aurait dû faire pour nous.
Devenir adultes, c’est ce que Jésus suggère à ses interlocuteurs dans l’Evangile d’aujourd’hui. Ils étaient venus le trouver pour se plaindre. Et Jésus leur demande s’ils croient vraiment que les victimes d’attentats ou de décisions iniques étaient des gens plus pécheurs que les autres.
Sérieusement chers Amis ! Vous croyez que les victimes d’un tremblement de terre, par exemple, ont été punies par Dieu ? Evidemment que non ! Les victimes du tsunami étaient-elles vraiment plus pécheresses que les autres ? Stupidité !
On rigole, mais c’est une réflexion qu’on entend régulièrement. Encore récemment, après les attentats de Paris, un prêtre français a osé suggérer que les victimes étaient pécheresses à cause du style de musique qu’elles écoutaient au Bataclan ce soir-là, et que Dieu avait puni ces gens.
On est au niveau zéro de la réflexion, là ! C’est grave de dire des choses pareilles quand on est théologien !
Et Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui, place clairement le débat ailleurs : il ne s’agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou mauvaise, il s’agit de nous convertir NOUS. « Cessez de récriminer, comme le disait Paul dans la seconde lecture ! » Cessons de demander des comptes à Dieu, regardons ce que nous pouvons changer en nous.
« Cessons de demander des comptes à Dieu »
On pourrait commencer par convertir notre façon de penser. Et notamment de convertir notre façon de penser Dieu.
On le voit encore trop souvent comme un vieillard sadique à grande barbe blanche. Non. Dieu est Amour.
Son nom est « miséricorde » comme le disait Benoît XVI, et comme l’a répété le pape François dernièrement.
Dans la première lecture, Moïse demande à Dieu son nom. Et la réponse est magnifique : « Je suis. » Dieu parle au présent, chers Amis. Il ne dit pas « j’ai été le Dieu de tes ancêtres », ou « je serai le Dieu de ton avenir », non. Il dit « Je suis ».
C’est le Dieu de la vie, de ce qui est. Et non pas le Dieu de la mort, de ce qui a été, le Dieu qui punirait de qu’on a fait, nos actes passés. Dieu vit au présent et il nous invite à faire de même.
A nous de grandir en humanité, et de vivre de telle manière qu’à la vue de nos actions, il soit impossible de croire que Dieu n’existe pas. Alors plus personne ne viendra nous dire « s’il existait vraiment, ton Dieu… »
3e dimanche du Carême
Lectures bibliques : Exode 3,1-15 ; Psaume 102; 1 Corinthiens 10,1-6.10-12; Luc 13,1-9

L’Erythrée et les Erythréens
« L’Eglise avec les femmes »
[rts:audio:7498346]

Londres et Verdun
International Christian Fellowship s’est installée à Bulle
[rts:video:7513154]

Homélie du 21 février 2016 (Lc 9, 28b-36)
Abbé Vincent J.-J. Lafargue – Église St-Nicolas de Myre, Hérémence/VS
Chers Amis,
Je suis un grand amateur de bandes dessinées, le saviez-vous ? Et dans les bandes dessinées, lorsque quelqu’un a soudain une idée géniale, vous savez, il y a cette petite ampoule dessinée au-dessus de la tête, qui s’allume accompagnée d’une onomatopée genre « Tilt ! », ou alors avec le mot grec « Eurêka ! » – « J’ai trouvé », en grec.
C’est la légendaire parole d’Archimède au moment où il a découvert sa loi sur la poussée que subit tout corps plongé dans un liquide, une loi que l’humoriste Pierre Desproges avait mis à notre portée en décrétant que lorsqu’on plonge un corps dans liquide, notamment dans un bain, le téléphone sonne ! Ça n’a rien à voir avec Archimède, mais c’est un théorème que nous avons tous vérifié au moins une fois !
Revenons à l’ampoule qui s’allume. Quand on découvre quelque chose, on a l’esprit qui s’éclaire, on se sent illuminé… illuminés dans le bon sens du terme évidemment ! C’est ce que veulent représenter les dessinateurs avec la petite ampoule qui s’éclaire au-dessus de la tête d’un personnage.
« Les disciples voient la gloire de Dieu au travers du visage de Jésus »
Mais la présence de Dieu – qui est lumière – est infiniment supérieure à une découverte de l’esprit – même si l’esprit est celui d’Archimède ! Cette présence-là éclaire non pas au-dessus de la tête mais bien dans le visage. C’est le récit de la Transfiguration que nous venons de ré-entendre.
Les disciples qui contemplent Jésus voient la gloire de Dieu au travers de son visage, comme une lumière qui l’éclairerait de l’intérieur.
Et nous connaissons bien cette lumière, à notre échelle humaine. Quand nous disons à quelqu’un qu’il a de la lumière dans les yeux, qu’il a le visage rayonnant, c’est un peu de cette lumière divine qui transparaît.
« Dieu habite en chacun des visages que nous croisons »
Et comme nous autres Chrétiens sommes citoyens des cieux, comme le rappelait Paul dans la deuxième lecture, nous devrions refléter au moins un peu de cette lumière sur nos visages. On n’y arrive pas toujours !
Nous devrions aussi rechercher cette lumière sur le visage de nos contemporains – je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage, disait le psaume.
Dieu habite en chacun des visages que nous croisons, en tant que Créateur de toute humanité, nous devrions nous en souvenir.
Trouver Dieu sur le visage d’un être aimé, c’est facile. Mais trouver Dieu dans le visage défiguré, ou dans le visage de celui qui nous énerve, ou encore dans le visage publiquement condamné, voilà qui est plus difficile. Pourtant Dieu s’y trouve, aussi. Et nous devons accueillir cette personne comme nous accueillerions Dieu lui-même.
La première lecture nous rappelait que les descendants d’Abraham sont aussi nombreux que les étoiles du ciel.
Les étoiles… encore une référence à la lumière qui brille.
Et vous savez comment on dit « étoile » en anglais ? Star, bien sûr. Nos médias, nos magazines, nos journaux ont tendance à mettre plus facilement en avant ce qui brille, les stars.
Mais la lumière divine brille sur chaque visage. Un bon journaliste chrétien devrait être celui qui va justement nous montrer ce qui brille dans un visage anonyme, sur un inconnu.
La lumière divine brille en chaque visage, à nous de la découvrir.
« Les Chrétiens devraient être des gens qui se laissent traverser par la lumière »
Et à nous aussi de refléter cette lumière sur nos propres visages, en sortant de la messe tout à l’heure, au travail dans notre semaine, en famille ou dans nos loisirs.
Les Chrétiens devraient être des porteurs de lumière, des gens qui se laissent traverser par la lumière, transfigurer.
Alors que trop souvent, les Chrétiens ont des têtes de Carême sans Pâques, comme dit le pape François !
Comme les enfants aiment beaucoup tout ce qui brille – il n’y a qu’à les regarder devant un feu d’artifice par exemple – et qu’ils sont souvent de bien meilleurs théologiens que nous, je vous laisse pour terminer cette anecdote racontée par mon ami Cédric :
Un jour, lors d’une cérémonie dans une église, une petite fille contemplait les vitraux colorés et baignés de lumière. Tout à coup, elle demande à sa Maman qui sont ces personnes dessinées sur les vitres.
Comme les personnages avaient manifestement des ailes, la Maman répond que ce sont des anges.
Quelques jours plus tard, en classe à l’école, le mot « ange » apparaît dans une lecture.La maîtresse demande alors à ses élèves si l’un d’eux sait ce qu’est un ange.
La petite fille, qui avait vu les anges représentés dans l’église sur les vitraux quelques jours auparavant, répond avec sa logique d’enfant :
Moi je sais, maîtresse ! Les anges ce sont les personnes qui sont traversées par la lumière!
2e dimanche du Carême
Lectures : Genèse 15,5-12.17-18; Psaume 26; Philippiens 3,20 – 4,1: Luc 9, 28b-36
The World of Dany – Combats