
Homélie du 15 mai 2022 (Jn 13, 31-35)
Chanoine Joseph Voutaz – Eglise Saint-Etienne, Sembrancher, VS
L’évangile d’aujourd’hui nous offre ce que Jésus appelle-lui même un « commandement nouveau ». Dans ce passage bien connu, Jésus est très solennel et ce qu’il dit semble lui tenir absolument à coeur !
Mais je l’avoue : lorsque j’écoute cet évangile, la première idée qui me vient à l’esprit c’est de dire à Jésus : « Regarde, ça ne marche pas ! Ce que tu nous dis, c’est irréaliste, impossible ! Tu as vu l’état de notre monde ? Tu as vu qu’en ce moment même, à quelques milliers de kilomètres, des frères chrétiens se battent entre eux sauvagement ? Cette guerre nous fait si mal… »
Et puis, plus profondément, si je veux être honnête, J’avoue que moi le premier je n’arrive pas à aimer… je ne fais pas mieux. Certes, je suis prêtre, je veux donner ma vie pour Dieu… mais j’ai tellement de peine à aimer vraiment ! C’est facile d’en parler en théorie, quand je suis en chaire, mais dans le concret du quotidien… aïe !
Jésus donne le commandement de l’amour juste avant sa mort
Alors comment faire, comment aimer ? Reprenant l’évangile, j’ai été frappé par le moment où Jésus nous donne le commandement de l’amour. Quand Jésus le prononce, il n’est pas sur une chaise longue, il ne parle pas du haut d’une chaire. C’est juste avant sa mort. Il sent que l’étau se resserre. Judas (nous dit le texte) est déjà sorti pour le trahir… Jésus va être vendu pour une somme dérisoire.
Je réalise ainsi que Jésus ne nous fait pas une théorie, un cours de morale. Il vit une situation concrète et difficile, désespérée même. Il nous livre alors une parole qui nous dépasse totalement et qu’il va signer par le don de sa vie. Le commandement nouveau est ainsi totalement lié à la croix, au fait que Jésus soit allé jusqu’à l’extrême de l’amour. Sur la croix, Jésus donne librement sa vie et nous dévoile l’amour incommensurable du Père.
Jésus ouvre un chemin nouveau, inédit
A ce moment-là, il y a quelque chose qui a totalement changé dans l’histoire de l’humanité. Pour la première fois, quelqu’un de trahi, abandonné, mis à mort de manière totalement injuste a pu aimer jusqu’au bout, sans aucune retenue. Et le don de Jésus a conduit au dimanche de Pâques et à la résurrection. Jésus a ouvert un chemin tout à fait nouveau, inédit. Lui seul pouvait le faire. Comme nous le disons dans la liturgie, « la mort a été vaincue par la vie. Quel changement ! Quel miracle !
Alors, qu’est-ce qui est « nouveau » dans ce commandement que Jésus nous donne ? » J’y vois trois choses, trois niveaux de compréhension
La première chose nouvelle, c’est la personne de Jésus même, son don d’amour, sa présence. Le texte le manifeste par un petit mot : « comme » : « … comme je vous ai aimés ». Souvent on se dit que ce comme nous invite à prendre l’exemple sur Jésus. C’est vrai, mais si on en reste là, on risque d’être assez vite découragés ! Et moi le premier ! Nous sommes si pauvres !
L’assurance que Jésus sera toujours là
En fait, derrière ce comme se cache la présence de Jésus. Quand Jésus nous dit : « … comme je vous ai aimés », il veut nous dire : Je suis là, je te donne mon coeur, ma force. Aie confiance, tu peux t’appuyer sur mon amour. Ce « comme… » est donc bien plus qu’une invitation à suivre l’exemple : c’est l’assurance que Jésus sera toujours là. Nous ne sommes plus livrés à nos propres forces, mais nous agissons désormais « Par Lui, avec Lui et en Lui »… cette formule doit bien vous rappeler quelque chose, non ?
La deuxième chose qui est nouvelle, c’est l’amour même. Je m’explique : chaque fois que nous décidons d’aimer, chaque fois que nous empruntons cette route que Jésus a ouverte, celle de l’amour jusqu’au bout, alors quelque chose change. L’amour, la décision d’aimer ouvre des routes insoupçonnées, des horizons nouveaux.
Le choix d’aimer, qui est parfois difficile et même héroïque, nous donne des énergies nouvelles et nous remplit d’une force que nous ne soupçonnions même pas ! Et quelque chose change vraiment. Par exemple, chacun(e) d’entre nous a pu être témoin de pardons donnés qui ont complètement débloqués des situations que nous pensions désespérées. Et la haine a fait place à la lumière. Oui si le manque d’amour nous tue, le choix d’aimer apporte partout clarté, joie et paix. Saint Augustin le dit dans une très belle formule : « Le péché m’avait vieilli, mais ta grâce me renouvelle ! »
La résurrection de Jésus c’est l’amour en marche
La troisième chose nouvelle, c’est l’espérance que donne ce commandement. Si, par la grâce de Jésus, de sa mort et de la résurrection, il me devient possible d’aimer, alors le monde va pouvoir changer ! La transformation du monde par l’amour n’est plus une chimère irréalisable ! C’est possible ! La résurrection de Jésus, c’est l’amour en marche !
Nous l’avons entendu dans la deuxième lecture : « J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. ». Si, les chrétiens, nous acceptons vraiment d’aimer, alors le monde va changer. Non par nos forces, mais avec la force de Jésus ! Non par nos idées, mais par la volonté de Jésus.
On dit parfois : « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse ». Quand un prêtre ou une figure médiatique connue est empêtrée dans une histoire d’abus, ça nous scandalise et ça nous fait bien mal. Mais cela ne peut pas couvrir le nombre incroyable des petits actes d’amour accomplis dans le silence du quotidien et qui sauvent le monde. Il y a tellement et tellement d’actes d’amour cachés… Ils ne feront jamais la une des journaux. Et pourtant c’est par eux que Jésus réalise un monde nouveau !
J’aimerais résumer et conclure. Ce qui est nouveau dans ce commandement, c’est d’abord Jésus. C’est lui qui nous donne la force, par sa présence de chaque instant dans notre coeur. Ce qui est nouveau ensuite, c’est chaque acte d’amour. Chaque fois que nous décidons d’aimer – plutôt que de faire la guerre – quelque chose change dans le monde, qui devient meilleur. Ce qui est nouveau, enfin, c’est l’espérance que nous recevons en aimant. Quand nous regardons une personne avec regard qui l’espère, en abandonnant nos jugements, alors nous lui permettons de changer !
Nous allons maintenant célébrer l’eucharistie qui est vraiment le sacrement de l’amour. Que le Seigneur nous donne à travers la communion la force de sa présence, pour que nous puissions aimer en actes et en vérité.
Et toi qui nous écoutes à la radio, nous te prenons aussi dans notre prière. Quels que soient tes joies ou tes peines, tes soucis du moment, que le Seigneur renouvelle ton coeur par sa présence et son amour. Sois béni ! Amen
5e DIMANCHE DE PÂQUES
Lectures bibliques : Actes 14, 21b-27; Psaume : 144, 8-9, 10-11, 12-13ab; Apocalypse 21, 1-5a; Jean 13, 31-33a.34-35
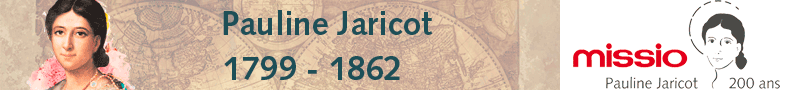
Bannière Pauline Jaricot
Aux Etats-Unis, le « Satanic Temple » défie la liberté religieuse
La ville étasunienne de Saint-Louis se bat pour accueillir des réfugiés afghans

Homélie du 8 mai 2022 (Jn 10, 27-30)
Chanoine Joseph Voutaz – Eglise Saint-Etienne, Sembrancher, VS
Nous sommes aujourd’hui le 4ème dimanche de Pâques. Nous appelons ce dimanche le dimanche du Bon Pasteur. Pourquoi ? Parce que l’évangile nous présente la figure de Jésus comme celle d’un bon berger, un pasteur qui nous fait du bien, qui est plein d’affection pour nous, et qui prend soin de nous.
J’aime cette image de Jésus comme berger. Dans notre région, on parle d’aller « en champ les vaches » lorsque nous menons paître les troupeaux dans les champs. Nous sommes en Valais, c’est le pays de la race d’Hérens et des reines à corne ! Pour moi, ce sont des souvenirs d’enfance concrets, et qui me touchent !
Un coeur débordant de bonté
Quoi qu’il en soit, cet évangile nous propose trois attitudes du Bon Pasteur qui peuvent nous toucher et qui nous montrent qu’être un bon pasteur, ce n’est pas d’abord une histoire de compétences, mais une affirmation d’un cœur qui est débordant de bonté et qui sait comment nous aimer.
La première chose est que le bon pasteur connaît ses brebis. Dans la Bible, ce verbe est tellement riche de significations ! Pour l’Écriture, connaître quelqu’un c’est l’aimer, savoir qui il est, le comprendre par l’intime, mesurer sa valeur. Quand Jésus dit qu’il nous connaît, cela veut dire qu’il sait qui nous sommes. Il est au courant de notre histoire personnelle, de nos souffrances, de nos moments pénibles. Mais il ne nous juge pas ! Il nous aime avec tout cela ! Il regarde avec beaucoup de compréhension nos misères !
Souvent quand nous disons de quelqu’un « Ah oui, je le connais », c’est un jugement. On croit avoir fait le tour de sa personnalité, mais en fait on le juge à bon marché… « Oui, je le connais celui-là… ». Mais quand Jésus dit Je connais mes brebis, c’est tout le contraire : Sachant nos difficultés, il prend soin de nous. Il ne va pas nous accuser, mais nous soutenir, nous épauler. Je pense ici à une phrase de sainte Thérèse de Lisieux qui m’éclaire beaucoup : « Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est juste, c’est à dire qu’il tient compte de notre faiblesse ! »
La deuxième chose que nous pouvons retenir : Jésus nous donne la vie, et la vie éternelle. Le plus grand désir de Dieu, son plus grand rêve, c’est de nous communiquer la vie débordant de son cœur ! Lorsque Jésus apparaît aux disciples après Pâques, il a soin sans cesse de redire : « La paix soit avec vous », comme pour nous dire : Je sais que votre cœur a besoin de paix. Je sais que vous recherchez la vie, le bonheur, je veux vous la donner à tout prix. C’est très beau. Jésus nous donne la vie et la vie éternelle, la vie en plénitude !
La vie éternelle va nous combler
J’aime beaucoup dire, quand je célèbre un enterrement, que la vie éternelle, ce n’est pas une simple survie, qu’on espère vaguement… On aimerait bien que cette vie se prolonge. On n’aimerait pas que ça s’arrête. Non, c’est infiniment plus que cela ! Dit de manière plus savante : il y a un saut ontologique entre la vie que nous menons maintenant et la vie éternelle. On ne peut pas soupçonner, on ne peut pas imaginer à quel point la vie éternelle va nous combler, dépasser nos attentes. Comme disent nos amis vaudois : on sera déçus en bien, et cela de manière inimaginable !
De plus, cette vie éternelle, Jésus veut nous la donner dès maintenant. C’est cela qui est important. Ce n’est pas une vague promesse pour le futur. Jésus nous donne dès aujourd’hui la vie éternelle, même si nos soucis demeurent, même si parfois nos vies sont en clair-obscur. Quand nous avons Jésus dans le cœur, nous goûtons déjà quelque chose de cette plénitude inouïe que nous vivrons dans l’éternité.
Il faut le dire, nous avons parfois transformé le christianisme, c’est à dire la suite de Jésus Vivant, en quelque chose de triste. Nous l’avons parfois perverti dans une morale étriquée, dans un devoir pénible que nous accomplissons tant bien que mal en traînant les pieds. Alors que Jésus nous propose vraiment une présence chaleureuse au fond du cœur, une grande libération ! Avec Jésus, c’est vraiment la vraie vie, c’est la liberté du dimanche de Pâques, le printemps qui jaillit du tombeau !
Il y a un troisième point : Jésus nous dit que nous sommes dans la main, de Dieu. Le texte nous le répète par deux fois. « Personne n’enlèvera mes brebis de ma main » et plus loin, « Personne n’enlèvera les brebis de la main de mon Père ». Je trouve que cette formule est particulièrement touchante. Il y a quelque chose de si beau ! Nous sommes les chéris de Dieu. Dans cette marche que nous faisons sur la terre, et qui parfois est difficile, nous pouvons nous dire : Il y a comme un cœur qui bat pour moi! Quelqu’un qui me comprend et me soutient indéfectiblement !
La main du Père est protection, assurance
Alors, confiance ! Il y aura toujours avec moi cette main du Père, cette protection, cette assurance. Je serai toujours écouté, soutenu, encouragé. Oui, nous ne sommes pas loin de la main du père et c’est là notre confiance chrétienne. Il nous faut nous y accrocher avec beaucoup de fermeté, de décision. Le père est là, le père m’aime. Il me connaît il me soutient dans le secret, aussi discret soit-il, dans mes épreuves, dans ma maladie, dans ma vieillesse.
Je pense à vous nos auditeurs et auditrices de ce matin. Peut-être êtes-vous fatigués, découragés, atteints dans votre santé ? J’aimerais vous dire, pauvrement, mais avec beaucoup de force et de confiance : le Père est avec vous, il vous aime… confiance en Lui !
Je vais conclure. Ce dimanche du bon berger est traditionnellement dans notre église le dimanche ou nous prions pour les vocations, c’est à dire pour ceux qui sont appelés, à la suite de Jésus, à devenir prêtres au service de l’Église.
Alors oui, certainement, prions pour les vocations, pour que des prêtres surgissent dans notre Église. Nous en avons tellement besoin. Mais prions vraiment pour que ces prêtres ne soient pas des fonctionnaires mais des bons pasteurs, qu’ils aient un cœur brûlant de passion pour leurs brebis. Comme dit le pape François, de manière si belle et si imagée : que les pasteurs que Dieu veut nous donner aient vraiment l’odeur des brebis sur eux. Qu’ils aient l’odeur des brebis, c’est à dire qu’ils aient la passion, qu’ils connaissent les gens à qui ils sont envoyés, leurs joies et leurs peines, leurs angoisses et leurs questions.
Qu’ils donnent leur vie pour eux. Qu’ils n’aient pas d’abord des soucis de sacristie, des soucis de naphtaline, mais qu’ils aiment généreusement le troupeau qui leur est confié, et qu’ils le placent dans les mains du Père !
Frères et sœurs, priez pour les vocations, et priez pour vos prêtres, nous en avons besoin ! Et moi, qui ai été appelé, je demande au bon Berger de vous bénir tendrement.
Et moi, qui ai été appelé, je demande au bon Berger de vous bénir tendrement. Que sa joie soit votre joie ! Amen !
4e DIMANCHE DE PÂQUE
Lectures bibliques : Actes 13, 14.43-52; Psaume : 99, 1-2, 3, 5; Apocalypse 7, 9.14b-17; Jean 10, 27-30
Réseau mondial de prière du pape
Une prophétie palestinienne prédit la fin d’Israël pour juin

Bannière UNIfr mai + juin

Homélie du 1er mai 2022 (Jn 21, 1-19 )
Chanoine Alexandre Ineichen – Basilique de Saint-Maurice, VS
Ici dans la Basilique, au loin sur les ondes, Jésus dans l’Évangile nous interrogera : «M’aimes-tu ?» Pour nous, avec nous, Simon-Pierre y répondra. Nous voici donc rassemblé ce matin car nous avons répondu à l’appel de Dieu. Nous avons comme Simon-Pierre revêtus nos habits et avons plongé dans l’eau du lac, revêtus nos habits blancs et avons plongé dans l’eau qui régénère. Par le baptême, nous avons voulu mourir et ressusciter avec le Christ. Au début de cette célébration, nous tous, nous voulons nous souvenir de notre réponse, par l’eau de Pâques, nous voulons mourir au péché et vivre en Dieu.
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » En ce troisième dimanche de Pâques, c’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ces disciples, aujourd’hui donc, Simon-Pierre, celui qui a renié le Christ trois fois, mais celui qui par trois fois aussi lui témoigne combien il l’aime, Simon-Pierre, à qui le Seigneur donne les clés du Royaume et qui doit affermir dans la foi, ses frères c’est-à-dire nous-mêmes, Simon-Pierre est bien le disciple par excellence, non seulement parce qu’il fera paître les brebis du Maître, mais aussi parce qu’il répondra au Conseil suprême et au Grand Prêtre qui l’interrogent en disant : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Or, nous savons tous, en particulier nous habitants d’Agaune, de Saint-Maurice, que cette injonction mènera saint Pierre jusqu’au sacrifice suprême comme Jésus le lui avait annoncé. En effet, c’est parce que nos martyrs saint Maurice et ses compagnons, parce que les martyrs de tous les temps ont préféré obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes qu’ils furent conduit à donner leur vie à la suite de Jésus.
Martyr, obéir, à notre époque, ces mots sont galvaudés et sont souvent entendus comme synonyme de fanatique, de discipliné, mieux de manipulé. Il est donc nécessaire de bien comprendre les paroles de Simon-Pierre pour qu’à sa suite nous préférions obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Nous sommes amis de Jésus
Premièrement, l’obéissance que Jésus demande n’est pas celle de l’esclave vis-à-vis de son maître dont la volonté est toute puissante et remplace celle du serviteur. Mais si l’Evangile est bonne nouvelle, c’est parce qu’il nous dit que nous ne sommes plus appelés serviteurs, ignorant la volonté du maître, mais ami de Jésus. Par trois fois aujourd’hui, Jésus interroge Simon-Pierre parce qu’il veut lui laisser l’entière liberté pour répondre à son appel.
Deuxièmement, l’obéissance n’est pas un simple conformisme, une acception générale de quelque manière de vivre qui nous ne oblige pas, mais qui soulage notre conscience, qui conforte nos préjugés, qui ne bouscule pas trop notre train-train quotidien, ni notre portemonnaie. Devons-nous comprendre le passage de notre Evangile où Jésus annonce à Simon-Pierre que bientôt ce n’est plus lui qui mettra sa ceinture et qu’il ne pourra plus aller là où il voudrait ? Non, car ce serait réduire l’Evangile a une collection de bons sentiments et de considérations générales prêtes-à-porter.
Troisièmement, afin de n’être ni esclave de nos opinions préconçues, ni prisonnier d’une volonté extérieure, ne devrions-nous pas nous mettre d’accord les uns les autres et signer un contrat social qui nous obligerait. Nous obéirons alors à des lois, des coutumes, des constitutions que nous aurions nous-mêmes établies, en toute liberté et dans l’intérêt de tous. Il nous faudrait alors obéir aux hommes plutôt qu’à Dieu, mieux pourquoi ne pas inviter alors Dieu lui-même à être signataire de ce contrat. Mais une telle obéissance ne peut se conclure qu’entre égaux.
Comment Dieu peut-il conclure une alliance avec l’homme ? Cette alliance, ne serait-elle pas trop disproportionnée, déraisonnable, peut-être même à notre désavantage ? Si le Verbe s’est fait chair, si Dieu est devenu l’un d’entre nous en Jésus-Christ, c’est pour que nous puissions – il est vrai – honorer cette alliance. Mais le chemin est long, difficile, peut-être même impossible.
Obéir à Dieu, c’est aimer de toute sa force, de toute son âme…
Reste alors la dernière compréhension de l’obéissance : celle que nous avons envers celui qui détient l’autorité, non celle de la force, qu’elle soit physique ou psychique, mais celle de la vérité. Oui, Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie. Par sa parole, Jésus nous dévoile Dieu et montre le visage du Père. En interrogeant Simon-Pierre, en nous interrogeant : m’aimes-tu ?, le Christ ne veut pas s’imposer par la force ou par un quelconque conformisme, voire une alliance, un contrat que nous aurions signé et que nous devrions honorer, non, au contraire, Jésus veut par sa parole nous donner en toute la liberté de répondre avec Simon-Pierre : Seigneur, tu le sais, tu le sais que je t’aime. Par ailleurs, la manifestation Dieu est certes d’abord extérieure dans le ministère de Jésus comme dans l’action de l’Eglise, mais elle est surtout intérieure car Dieu – comme le dit saint Augustin – est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. C’est par l’écoute attentive du maître intérieur que nous pourrons en toute occasion répondre en vérité à la fameuse proposition du même Augustin : Aime et fais ce que tu veux, et dire avec saint Pierre parce que le Christ l’aime et sait que le disciple l’aime aussi : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. ». Obéir à Dieu de cette manière, c’est aimer de toute son âme, de toute sa force et de tout son coeur Dieu et son prochain comme soi-même.
3e DIMANCHE DE PÂQUES
Lectures bibliques : Actes 5, 27b-32.40b-41; Psaume 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13; Apocalypse 5, 11-14; Jean 21, 1-19


